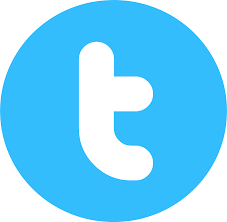La crise que traverse l’économie mondiale ne doit pas conduire nos sociétés à renoncer aux principes de l’économie de marché, mais au contraire à en mener une réforme profonde. C’est l’idée centrale que veut défendre l’Institut de l’Entreprise, le think tank dirigé par Michel Pébereau, dans son étude « Après la crise, renouer avec les fondamentaux de l’économie de marché », parue en avril dernier.
Les auteurs y explorent les origines d’un tsunami financier qui, parti de son épicentre dans un sous compartiment du marché hypothécaire américain, a ravagé l’économie planétaire. Premier incriminé, les Etats-Unis qui ont mené pendant 20 ans une politique monétaire expansionniste, caractérisée par des taux d’intérêts trop bas. Elle s’est accentuée dans les années qui ont suivi l’explosion de la bulle internet (2000), les attentats du 11 septembre et de la récession qui s’en suivit. Elle servit à relancer l’économie, financer l’effort militaire en Afghanistan puis en Irak. Elle soutint aussi une politique visant à favoriser l’accès des ménages américains à la propriété immobilière.
Parallèlement, les économies émergentes, asiatiques principalement, ont commencé à amasser au cours de la dernière décennie, d’importantes réserves de change en dollars.
Ils comptaient ainsi se prémunir en cas de crise, telle que celle de 1997, mais aussi maitriser les fluctuations de leurs monnaies face au dollar, et ainsi la compétitivité de leurs industries exportatrices. Ils ont été imités à partir de 2004 par les pays pétroliers, inondés de devises.
Ces réserves sont constituées de titres de dette en dollars. Leur formation a logiquement provoqué un afflux de liquidités sur le marché américain. Une situation qui a permis aux ménages américains de s’endetter à faible coût puisque, de surcroit, les taux d’intérêt de la banque centrale américaine (FED) étaient faibles. Cette conjonction néfaste a précipité la formation de déséquilibres financiers majeurs, dont l’envolée irrationnelle des prix de l’immobilier américain.
Outre la responsabilité d’une politique monétaire opportuniste et laxiste, les auteurs mettent en cause le rôle de l’industrie financière. Cette dernière a en effet failli à sa mission première, distinguer les bonnes des mauvaises créances, laissant s’échapper dans le système financier des créances hypothécaire sur des ménages surendettés à haut risque de défaut, les « actifs toxiques ». Un usage excessif de la titrisation, qui consiste à transformer un actif financier en un ‘titre’ échangeable sur un marché, a ensuite accélérer la diffusion de ce poison sur tous les marchés.
Les banques centrales et les agences de notation, convaincues elles aussi de la nature extensive et toute puissante des marchés, ont échoué dans leur rôle de superviseur. Enfin, les nouvelles normes comptables, entrées en vigueur en 2005, en assimilant la valeur juste d’un actif à sa valeur de marché, ont contribué à l’apparition de bulles spéculatives.
Les auteurs réfutent toutefois l’idée que la crise actuelle démontrerait un dysfonctionnement des mécanismes de marché. Les titres de dettes « toxiques » n’avaient en réalité pas les caractéristiques de produits de marché. En particulier, ils n’étaient pas suffisamment liquides. Lorsque les acteurs ont réalisé l’illiquidité de ces actifs, les « pseudo-marchés » sur lesquels s’échangeaient ces titres, ces « illusions de marché », se sont d’eux-mêmes effondrés.
La crise systémique a quant à elle pu être évitée grâce à une intervention coordonnée des banques centrales et des gouvernements (baisse des taux d’intérêts, recapitalisation des banques, plan de relance…).
Loin d’être une sorte de crépuscule du capitalisme, la crise que nous vivons doit plutôt être comprise comme la conjonction de trois crises. La première est bancaire, la seconde immobilière et la troisième cyclique, liée à un ralentissement naturelle de l’économie après une longue période de croissance.
Partant de là, il importe, selon les auteurs, de combattre l’aspiration de certains à un « grand bond en arrière », que l’on comprend antilibérale.
Le premier danger serait de céder à la tentation protectionniste, y compris dans sa dimension financière. Les auteurs rappellent les conséquences dramatiques qu’eut le repli sur elles-mêmes des économies occidentales, au lendemain de la crise de 1929.
Autre tentation, le rejet de l’innovation financière, celle là même qui poussa à l’extrême la pratique de la titrisation et la création de produits financiers que la sophistication a rendus opaques et incontrôlables. Les auteurs rappellent que la titrisation de la dette, par la mise en concurrence entre banques, a permis d’abaisser significativement le coût de l’endettement pour les entreprises. Quant aux produits dérivés, ils leur offrent la possibilité de mutualiser et de couvrir leurs expositions aux risques financiers, telles que la volatilité des cours des matières premières et des devises.
L’enjeu consiste moins à accroître, qu’à améliorer la réglementation. En élargissant le périmètre de contrôle des superviseurs du système financier auquel échappent encore certains acteurs, ainsi qu’en renforçant leur pouvoir et leurs compétences. Leur mission est de garantir la liquidité et la confiance sur les marchés, qui sont bien des actifs à protéger, et non des hypothèses acquises, comme voulaient le croire les tenants d’une conception extensive du marché.
L’information sur les produits financiers doit être rendue plus transparente et les règles comptables (normes IFRS) et prudentielles (règles de Bâle II) réformées. En outre, les agences de notation, qui devront appliquer des méthodes d’évaluation différenciées en fonction des émetteurs de dette. Enfin, l’Institut suggère la création d’un organe unique européen de superviseurs, coordonné avec la banque centrale européenne (BCE), chargé notamment de surveiller et de prévenir la formation de bulles spéculatives sur certains marchés.
Pour les auteurs, l’enjeu est de « retrouver l’inspiration originelle du capitalisme », réaffirmant leur conviction que la création de valeur vient moins des grandes politiques macro-économique que de l’initiative micro-économique et de l’esprit d’entreprise. Ils rappellent les obligations citoyennes de l’entreprise, dans la répartition de la valeur ajoutée, entre travail et capital ou dans sa responsabilité environnementale. Ils invitent également les politiques à encourager le capital-risque.
Outre ces considérations, ils soulignent que, pour sortir de la logique de l’endettement et renforcer leurs fonds propres, les entreprises auront besoin de drainer une épargne stable placée dans des actifs de long terme, tels que les actions.
A ces fins, ils plaident notamment pour l’établissement d’un statut spécifique d’actionnaire de long terme qui irait de pair avec la création de nouvelles normes comptables. Ces dernières s’efforceraient d’évaluer les performances, les risques et la solvabilité dans une perspective de long terme. Plutôt que de s’attacher à produire une photographie instantanée de la valeur d’une entreprise, comme le font les normes actuelles. Soutenu par des incitations fiscales, cet actionnariat stable, durable et attaché à l’entreprise sera le vrai garant de son indépendance.