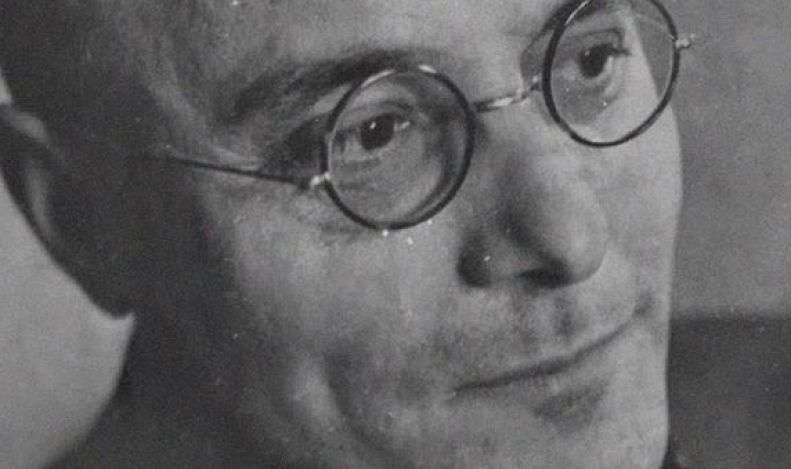La pensée de Karl Polanyi retient à nouveau l'attention, pour comprendre et lutter contre ce qui s'apparente de plus en plus à un nouvel effondrement social et politique de nos sociétés.
On peut se demander si l’action de Donald Trump et de ses soutiens ne propulse pas désormais Karl Polanyi au rang des meilleurs analystes de la situation actuelle, lorsqu’il explique que les dysfonctionnements de l’économie de marché livrée à elle-même finissent par provoquer des catastrophes politiques, qui sont la marque d’un effondrement de la société, et que la seule manière d’en sortir est alors de réformer l’économie pour lui redonner son assise sociale.
Nicolas Postel et Richard Sobel, professeurs d’économie à l’université de Lille et chercheurs au Clersé, lui ont consacré un petit ouvrage, qui, en cherchant à montrer l’actualité de sa pensée, suggère autant de pistes de recherche et d’intervention.
Nonfiction : Karl Polanyi définit le capitalisme comme un régime économique spécifique et problématique, et lui oppose d’autres moyens d’organiser la subsistance des membres de la société. Peut-être pourriez-vous commencer par expliquer en quoi, selon lui, ce régime est spécifique, et en quoi il est problématique ?
Nicolas Postel, Richard Sobel : Pour Polanyi, toute société doit formuler une réponse à la question de la « subsistance » qui forme selon lui la question économique. Pas de société donc, sans économie. Karl Polanyi propose ainsi une définition de l’économie (dans Commerce et marché dans les premiers empires qu'il publie en 1957) comme « procès institutionnalisé d’interaction entre l’homme et son environnement qui se traduit par la fourniture continue des moyens matériels permettant la satisfaction des besoins ».
C’est une définition essentielle qui repose sur trois points saillants.
L’économie est institutionnalisée. Ceci signifie que la réponse que donne toute société à la question de la satisfaction des besoins est d’abord collective, sociale, politique. Il n’y a pas d’économie « avant » les institutions collectives ; l’économie n’est donc pas « compréhensible » par des métaphores du type de celle qu’affectionne pourtant l’économie dominante : celle d’un individu rationnel, asocial. Non, dit Polanyi. L’économie c’est toujours d’abord une réponse marquée par un prisme social et collectif. Il n’y a rien avant la société. L’homme est un animal social, et la question économique est d’emblée une question sociale et jamais individuelle.
Ensuite, cette question elle est aussi, remarque Polanyi, celle de l’insertion de la communauté humaine dans la nature, dans son « environnement ». La question écologique nous semble nouvelle, mais elle ne l’est pas : c’est la question économique par définition. Lorsque la communauté humaine apparait, il lui faut assurer les conditions de sa reproduction en harmonie avec l’environnement dans lequel elle vit et qui la définit. Elle ne peut donc évidemment pas s’en s’extraire.
Enfin, cette question c’est celle des besoins, pas du désir illimité d’accumulation. « De quoi avons-nous besoin ? » reprenait récemment Bruno Latour. C’est la question économique, et nous l’avons oublié. Elle a été ensevelie sous deux siècles d’accumulation matérielle illimitée, aiguillonnée par la satisfaction des désirs, notamment mimétiques, qui en eux-mêmes sont sans limite.
Cette définition de Polanyi relativise l’expérience du capitalisme. Avant le capitalisme, différentes réponses sociales, cohérentes avec la ou les représentations sociales en vigueur, ont coexisté : économie domestique (autarcie), réciprocité (pour des sociétés de groupes symétriques en interaction), redistribution (un organe central, jugé légitime, récupère ce qui est produit et le redistribue selon des critères jugés eux aussi socialement légitimes) et commerce (aux « marges » de la société – le mot donnera « marché » – et de manière résiduelle, des groupes échangent des biens et services qui permettent de diversifier l’alimentation selon des tarifs négociés entre eux, de gré à gré). Ces formes économiques coexistent dans le temps très long, pendant des millénaires, et assurent la reproduction humaine, au long cours, et de manière résiliente : sans abimer la nature au point de menacer ce cycle reproductif.
Ces formes anciennes existent encore aujourd’hui : dans nos sociétés tout n’est pas assuré par le marché, la famille assure une large part des fonctions de subsistance, l’Etat social assure une autre part de nos besoins collectifs, de nombreuses formes de solidarité ont perduré, et une part des ressources circulent dans des formes de commerce de proximité (que l’on pense au circuit court). Mais elles sont considérées comme des archaïsmes et des freins à la modernité marchande capitaliste qui au contraire prétend s’extraire des « carcans sociaux » et imposer à la société et à la nature un principe unique d’accumulation. Toujours plus ! Nos sociétés se sont engagées à partir de la fin du XVIIIe siècle dans une course pour s’affranchir des « limites et freins naturels et sociaux » et faire émerger une société d’individus économiques connectés par des marchés, eux-mêmes régulés par la concurrence pure et parfaite. Ce mythe, celui du marché autorégulateur, prétend ainsi non seulement extraire l’économie de la société et des limites naturelles, mais plus encore asservir la société et la nature à un objectif économique d’accumulation.
Si l’on veut saisir ce problème à partir d’un symptôme simple, remarquons notre difficulté à parler de l’humanité et de la biosphère autrement que comme des « ressources humaines » et des « ressources naturelles ». Ressources ? Pour quoi ? Pour qui ? Pour l’économie ! C’est-à-dire pour l’accumulation illimitée de richesse. Il y a là une inversion de causalité assez incroyable, quand on prend le temps d’y réfléchir : l’économie n’est plus au service de la société : c’est la société qui doit être mise au service de l’économie !
La particularité du capitalisme est qu’il transforme tout en marchandise, et cela vaut notamment pour la terre, le travail ou encore la monnaie, qui deviennent de ce fait appropriables par certains, tandis que le plus grand nombre en voit leur usage restreint. L’histoire du capitalisme peut alors être vue comme une progression de cette marchandisation. Là aussi, pourriez-vous en dire un mot ?
Ce que dit Polanyi de la « marchandisation du monde » est plus précis que ce qui en est en général retenu. Polanyi analyse en effet les conditions de possibilité du capitalisme : pour qu’il « fonctionne » il faut traiter la « terre » (la biosphère), le travail (la vie humaine) et la monnaie (notre mesure commune) « comme si » ces piliers de la société étaient « produits en vue d’être vendus » (et étaient donc « des marchandises »). C’est important de réserver le concept de marchandise fictive à ces trois marchandises – et seulement à celles là – car Polanyi signale ici ce qui « doit » être traité comme marchandise (dans le capitalisme) et qui « n’est pas de l’ordre du marchand ».
Bien des choses circulent sur le marché sans avoir été conçues pour être vendues : les connaissances, le droit, les organes... Mais le capitalisme peut se passer de ces formes extrêmes de marchandisations propres aux excès du néolibéralisme. En revanche, pour la terre, le travail et la monnaie, sans cette fiction, le capitalisme cesse de fonctionner !
Plus qu’une progression continue en revanche, il faut voir l’histoire du capitalisme sur ces 250 dernières années comme des à-coups qui procèdent par une plus ou moins grande « institutionnalisation » des trois marchandises fictives. Cela sous l’effet conjoint, et contradictoire, de la pression à la marchandisation qu’exerce le système économique et du « contre mouvement » qui résiste, dans l’agriculture, dans le monde du travail, sur le front des souverainetés monétaires. La diversité, historique et spatiale, des formes que prend le mode de production capitaliste, qui est extrêmement divers, est la résultante de ces deux mouvements contraires, de cette dialectique permanente. C'est, au fond, la compréhension de cette dialectique et l’attention qu’on porte à l’équilibre des forces qui est important. Lorsque la force du processus de marchandisation avance sans frein, c’est, assurément, la catastrophe qui survient.
Après le fascisme et la Seconde Guerre mondiale, les sociétés occidentales ont connu une période de démarchandisation importante, même si celle-ci n’a été que partielle. Pourriez-vous en dire un mot ?
Le fascisme pour Polanyi est le produit du libéralisme exacerbé de l’après Première Guerre mondiale, de l’effondrement des forces de résistance au marché. La société menacée de dissolution ne disparait jamais. L’économie ne peut pas « sortir du social », mais lorsque le mythe a produit ses effets les plus violents, les acteurs sont atomisés (on pourrait retrouver ici le concept d’anomie du Durkheim) : l’espace collectif de délibération disparait ; le principe sacro-saint d’efficacité marchande balaye tout, et renvoie chacun à la nécessité d’être compétitif et performant. Alors, la société se resserre et réagit sous des formes dysfonctionnelles, maladives et effrayantes. Le fascisme, le totalitarisme sont ainsi selon Polanyi : « la réalité d’une société de marché ». Plus de marché, plus de concurrence n’entraine pas plus de démocratie comme certains le prétendent, mais au contraire l’effondrement démocratique et le totalitarisme. On notera l’actualité de cette analyse.
Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, Polanyi écrit son ouvrage (The Great Transformation, 1944) pour indiquer que, instruites de l’épouvantable atrocité de la Seconde Guerre mondiale et de l’horreur nazie, les démocraties européennes vont opérer leur « grande transformation » et « démarchandiser » leur rapport au travail et à la monnaie. Il publie son livre la même année que les célèbres accords de Philadelphie (mai 1944) et de Bretton Woods (juillet 1944) qui instaurent un rapport « régulé politiquement » au travail et à la monnaie. Le droit du travail doit beaucoup à l’esprit de Philadelphie comme le souligne Alain Supiot, et le système monétaire international, qui s’invente à Bretton Woods, est un régime contrôlé politiquement par les démocraties occidentales, et notamment les USA. Polanyi voit donc juste, oui, il y a une grande transformation, et les quarante années de croissance forte après la Seconde Guerre mondiale, qui vont amener une amélioration rapide et inédite de la condition salariale au point de superposer dans la tête des occidentaux « hausse du PIB » et « hausse du bonheur », sont le fruit de cette démarchandisation. Une période, en Occident, de paix, de démocratie, de concorde relative malgré la permanence du double mouvement.
Mais cette démarchandisation est – évidemment – partielle : rien sur la nature, et rien sur le contenu du travail. Le régime de croissance dit « fordiste » qui caractérise les Trente glorieuses est une période de prédation et de destruction accélérée de la nature. Toutes les populations du monde subissent alors et souffrent de l’accumulation de richesse en Occident. Ce sont nos « Trente glorieuses » mais trente années d’enfer pour les 4/5e de l’humanité… Peu glorieux donc, en fait. Et nous en payons le prix climatique et écologique aujourd’hui. Et si les formes d’emplois sont démarchandisées (par le CDI, la protection sociale, les règles collectives salariales qui font du salaire autre chose qu’un prix concurrentiel), le travail ne l’est pas complètement puisqu’il demeure homogénéisé et traité comme une quantité dans le cadre du taylorisme – un régime particulièrement dur de mise au travail.
Le moment déclencheur de la crise du fordisme est la fin du système de changes fixes, avec la fin des accords de Bretton Woods, qui va permettre à la finance de reprendre la main, dans un régime fragilisé, par ailleurs, par d'autres évolutions. Les travailleurs (et étudiants) de mai 68 finissent par rejeter le taylorisme et ne veulent plus « perdre leur vie à la gagner », les pays producteurs de pétrole réclament leur du et dans le sillage de la décolonisation naissent les mouvements « tiers-mondistes » qui dénoncent cette logique d’accumulation occidentale, le Club de Rome signale qu’il faut décélérer (dès 1972). Si la finance reprend la main aussi facilement c’est aussi parce que les forces sociales du « double mouvement » contribuent, elles aussi, à dénoncer le maintien d’un rapport marchand au travail et à l’environnement durant cette période. L’assise sociale de ce compromis temporaire s’affaisse donc.
Polanyi n’a pas connu la poussée néolibérale à partir des années 1980 et la remarchandisation qui la caractérise, ni a fortiori la multiplication des crises que l’on connaît depuis 2010, qui s’est alors accompagnée d’une très préoccupante montée de l’extrême droite. En quoi les concepts qu’il a forgés peuvent-ils nous aider à comprendre cette nouvelle phase ?
Nous vivons, des temps polanyiens. La vague néolibérale et l’instauration d’une nouvelle phase du capitalisme à partir des années quatre-vingt nous a ramenés au bord de l’effondrement. Le néolibéralisme s’appuie sur les idées de Hayek, opposant de Polanyi dans les années vingt, et va se traduire par un violent retour de bâton en matière de droit du travail – c’est la fameuse flexibilisation, qui est un autre mot pour la marchandisation –, une pénétration extrêmement profonde de la logique libérale d’un pilotage de l’économie par les marchés financiers (la fameuse « notation » des politiques économiques par des agences privées veillant aux intérêts des actionnaires en est le signe ultime) et enfin l’extension d’une logique marchande au « vivant » (marché de droit à polluer, compensation carbone, politique de brevet appliqué aux semences, etc.). Le marché reprend alors complètement en main les trois marchandises fictives. On prête à Laurence Parisot, alors présidente du Medef cette formule : « La vie, la santé, l'amour sont précaires, pourquoi le travail échapperait-il à cette loi ? » ; on ne saurait mieux résumer la logique de remarchandisation. L’effondrement actuel, de la biodiversité, de la qualité du lien social, de nos régimes politiques est l’effet direct de cette remarchandisation, de l’affaiblissement terrible du double mouvement.
Le mouvement syndical en France est ignoré par le pouvoir d’Etat et considéré comme un archaïsme malheureux comme l’a démontré la manière dont a été menée la récente « réforme » des retraites, par exemple. On a le sentiment que la logique marchande de concurrence se déploie sans frein, partout, et notamment là ou elle n’était pas présente, par exemple dans le service public. On ne doit pas alors être surpris que cela nourrisse les mouvements totalitaires d’extrême droite, notamment en Europe et aux Etats-Unis. C’est pour nous une clé de lecture essentielle et complètement oubliée. L’offre politique tend à se simplifier entre un choix pour le libéralisme – économique et politique – ou pour l’extrême droite. C’est tout à fait délétère, les seconds tours d’élection en France n'offrent le choix qu'entre l’extrême droite ou des politiques qui la nourrissent politiquement.
Quelles solutions la pensée de Polanyi nous suggère-t-elle ? Quelles évolutions vous paraissent-elles devoir être intégrées à l’analyse, concernant en particulier la crise écologique, que Polanyi n’avait pas prévue, l’état stationnaire dans lequel le capitalisme semble s’être installé, ce qui n’était pas le cas précédemment, ou encore la nécessité d’une intervention de l’Etat qui fasse une plus grande part à l’autonomie des acteurs ?
Polanyi ne nous livre pas de solutions clés en main mais il montre un chemin, une manière de s’extraire de la prégnance de la logique concurrentielle. Penser avec Polanyi aujourd’hui c’est en effet saisir que le cœur de l’affaire est de défendre la démocratie contre l’établissement d’un principe de concurrence généralisée qui détruit la société et nourrit le totalitarisme. Il ne faut pas laisser le discours de la protection à l’extrême droite. La protection contre la logique concurrentielle, et non contre « l’étranger ».
Cette défense de la démocratie elle ne peut plus s’arrêter à la frontière des entreprises considérées comme des zones de non citoyenneté dans lesquelles règne le pouvoir sans partage des actionnaires. Elle ne peut pas non plus se contenter d’être une sorte de délégation générale et systématique à un Etat central omniscient qui « parlerait » au nom du peuple. L’Etat, en Europe, vient tout à fait à l’appui des logiques concurrentielles marchandes et n’a que très peu intégré la nécessité de démarchandiser notre rapport au vivant. La transition écologique sera donc démocratique ou elle ne sera pas.
Les solutions sont là, à portée de main. Les formes anciennes d’économie n’ont pas disparu. La moitié des richesses en occident sont socialisées, le secteur de l’ESS (économie sociale et solidaire) est vigoureux, la sphère domestique est un espace qui apparait aux acteurs comme une sphère désirable, à préserver. Les formes économiques anciennes de redistribution, réciprocité, économie domestique sont donc encore là. Mais on les invisibilise, on les considère comme néfastes, on veut les réduire en baissant les impôts, en coupant les aides au tiers secteur, en augmentant le temps de travail au détriment du temps domestique. Il faut au contraire s’en inspirer pour penser un développement humain qui ne passe plus par l’accumulation productive et l’extension marchande.
Il faut compter autrement nos richesses : le PIB n’est plus du tout un indicateur corrélé positivement au bien-être, la performance financière d’une entreprise ne dit presque rien de sa performance concrète au plan social et environnemental (c’est même souvent l’inverse). Des formes nouvelles de comptabilité sont disponibles, et l’Etat pourrait s’en saisir lorsqu’il prétend mener une politique de l’offre…
Des formes nouvelles de production plus efficaces au plan social et environnemental existent, et l’Etat pourrait les valoriser. Un consensus de plus en plus fort existe en Europe pour remettre la main sur l’arme monétaire et en faire un usage politique et collectif. Mais cette volonté de démarchandiser la monnaie est menée (notamment par la BCE) en sourdine, de manière discrète, honteuse et sans en faire un sujet politique, alors que le contraire serait tout à fait possible.
Il faut que l’Etat reconnaisse la vertu des initiatives et des expérimentations locales, qu’il quitte une posture descendante. L’imaginaire des politiques publiques et de ceux qui les mènent, politiquement et administrativement, et encore très largement dominé par deux dogmes : le marché dit "la" vérité, et plus de marché, c’est plus de démocratie. La lecture de Polanyi est un formidable antidote au relatif abrutissement auquel mènent ces deux dogmes qui bloquent nos imaginaires collectifs. Avec Polanyi il nous faut goûter à nouveau au plaisir de la délibération démocratique, refonder les institutions sociales de contrôle de l’économie, et parvenir à nous entendre sur ce dont nous avons vraiment besoin. Remettre l’économie à sa place, celle d’un outil, et parvenir à nous réinterroger sur les fins. En finir, en ce sens, avec « l’économisme » pour mieux refaire de l’économie.
Pour prolonger :