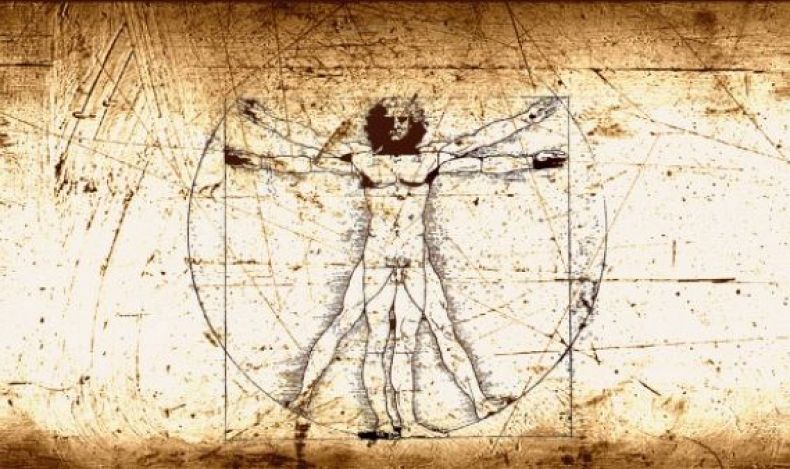Posthumanisme, Humanité(s), humanisme(s)... Jean-Yves Goffi démêle le sac de noeuds des idées et des projets qui placent l'homme en leur centre.
Les mots « humanité » et « humanisme » sont depuis longtemps entrés dans le langage commun : celui de l'école, de la politique et même parfois de l'entreprise. L'un comme l'autre désignent de toute évidence des attitudes qui placent au centre de leurs préoccupations l'« homme », celui-là même dont on défend, dont on célèbre ou dont on conteste les Droits ces jours-ci. Aussi proches qu'elles puissent être, toutes ces notions font pourtant résonner des nuances irréductiblement singulières. Les « humanismes » et les « humanités » se présentent sans doute avec les couleurs pâles et jaunies des images anciennes, revivifiées sous les traits d'un « post-humanisme » ou d'« humanités numériques ». L'« humanité » au singulier tonne avec la puissance des grands mots. L'« homme » évoque peut-être davantage la nudité d'une condition précaire débarrassée de ses atours. Reste que les nuances d'une notion à l'autre demeurent le plus souvent obscures, confuses.
A l'heure où elles semblent revenir au-devant de la scène – scène technologique du transhumanisme, scène éducative des humanités numériques, scène éthique et politique de l'humanitaire ou des débats sur les droits de l'homme – le philosophe Jean-Yves Goffi fait le point sur le sens des mots et ce qu'ils recouvrent. Il revient d'abord sur l'héritage et le devenir des « Humanités » à l'ère du numérique, puis sur les mutations du (ou des) humanisme(s) jusqu'à nos jours, et enfin sur le rapport complexe de l'homme à l'animal auquel il a consacré une étude incontournable.
* En fin d'article, Nonfiction vous propose également une sélection d'articles traitant des mutations et enjeux de l'« humanité » à l'époque contemporaine.
LE DEVENIR DES HUMANITES
La réforme en cours du lycée prévoit une suppression des « séries » (S, L, ES...) au bénéfice de « parcours ». Cette évolution implique aussi une refonte du baccalauréat, dont le nom est issu du terme latin médiéval baccalarius qui signifie : « jeune qui aspirait à devenir chevalier ». Pour vous qui avez été formé aux Humanités, que reste-t-il de l'ancienne chevalerie dans ce rite de passage moderne, qui vient désormais sanctionner un « parcours » singulier ?
« Formé aux humanités », c'est un bien grand mot ! J'ai commencé mes études secondaires au début des années 60 dans ce qui menait alors vers la série A ; au programme, des langues anciennes et modernes (pour moi : latin-anglais) puis, à partir de la 4 e, du grec. Mais bien sûr, il y avait aussi des mathématiques, de la physique, de l'histoire, etc. Il existait une série A' qui comportait en outre un enseignement renforcé dans les matières scientifiques et qui permettait encore, si je me souviens bien, de faire médecine après le baccalauréat. Cela n'est évidemment plus pensable aujourd'hui. Donc, j'ai été « initié » au latin dès la 6 e, avec assez rapidement des extraits du De Viris Illustribus, sans que je sache bien, encore aujourd'hui, s'ils provenaient de Cornelius Nepos ou de l'Abbé Lhomond. Nos professeurs de latin étaient assez directs, pour ne pas dire directifs : il y avait un texte à traduire, alors on traduisait et c'était avant tout une façon d'appliquer ce que l'on avait appris en grammaire : les déclinaisons, les conjugaisons, puis les verbes déponents, etc. Il y avait aussi du thème, bien plus difficile à mon sens. C'était assez scolaire, très scolaire même. En terminale, j'ai eu affaire à des professeurs plus subtils, qui considéraient, pour filer la métaphore que vous évoquez, que nous étions devenus sinon un chevalier, du moins un écuyer capable de porter l'écu d'icelui ; en conséquence de quoi, nous avons étudié le Banquet et les Lettres à Lucilius dans le texte, un bon souvenir.
Maintenant, sans même envisager le contenu du programme, on peut relever, comme vous faites, ses présupposés ou ses prémisses : qu'on parle de « parcours choisis par chaque lycéen en fonction de ses goûts et ambitions » renvoie à l'idée selon laquelle l'individu est acteur de sa propre formation tout au long de sa vie. La formule est impressionnante, mais que veut-elle dire pour un adolescent ? Il ne va pas du tout de soi que l'on ait affaire, avec les lycéens, à des individus autonomes, conscients de ce que sont leurs goûts et capables d'articuler leurs ambitions de façon cohérente. Pour ce qui me concerne, mes goûts d'adolescent me portaient certainement plus vers les Yardbirds ou les Kinks que vers autre chose. J'ai du mal à comprendre quel parcours j'aurais pu bâtir sur ces fondements. Quant aux ambitions, c'est encore autre chose. Lorsque j'ai enseigné dans le supérieur, j'ai toujours dispensé des cours aux étudiants de première année (en logique, calcul des propositions ; et en philosophie générale). Au moment de remplir les traditionnelles fiches de début d'année, il leur était demandé de préciser ce qu'ils voulaient faire une fois leurs études terminées – leur projet professionnel, pour parler le jargon. Un pourcentage important n'en avait aucune idée précise. On répondra que, justement l'école est faite pour aider les jeunes esprits à préciser tout ça, dans une atmosphère de bienveillance et de compréhension. Mais il y a tout de même lieu de croire que l'on verra, pour paraphraser Nietzsche, chacun aller « de son plein gré », s'il en est capable, dans les filières promettant les débouchés les plus prestigieux et les plus lucratifs.
Je voudrais évoquer rapidement une anecdote ; après tout, exempla docent et l'anecdote peut s'apparenter à la littérature des exempla. J'ai eu récemment l'occasion, à l'invitation de collègues qui enseignent en classe préparatoire et dans le secondaire, de parler à des élèves de lycée du transhumanisme, sujet sur lequel je travaille actuellement. Il s'agissait d'ouvrir de la sorte des journées philosophiques devant se dérouler pendant plusieurs jours à Uriage (en Isère). La conférence se passait à Grenoble, dans un lycée prestigieux. Elle avait lieu dans une salle de chimie (paillasse, évier, prise pour le bec Bunsen), les dernières travées étant surélevées pour que les élèves assis aux derniers rangs puissent voir les manipulations. Ce jour-là, il y avait deux classes de lycées du centre-ville et une classe de lycée de banlieue. Les élèves sont entrés dans un silence respectueux, les collègues les ayant préparés à cette cérémonie. Que s'est-il passé alors ? Évidemment, les élèves du lycée de banlieue sont allés s'asseoir au fond et ceux des lycées de centre-ville aux premiers rangs. Personne ne leur avait dit de faire comme ça, mais chacun connaissait d'avance sa place ! On se serait cru dans un sketch introductif : « Bourdieu pour les nuls ». Évidemment aussi, une fois la conférence terminée, les questions ont fusé des premiers rangs ; les élèves des derniers rangs m'ont posé leurs questions par procuration, par l'intermédiaire de leurs professeurs, alors qu'ils étaient tous sortis. Donc, une balade, un parcours vague et superficiel ? J'en doute fortement : « Chacun ira, de son plein gré s'il en est capable, dans les filières promettant les débouchés les plus prestigieux et les plus lucratifs », cela veut dire que les familles de tous ces lycéens supposés conscients et autonomes auront un mot à dire dans cette affaire, en fonction de leur connaissance des codes et des réseaux. Je ne parle, même pas, bien sûr, de la possibilité de constituer tous les parcours envisageables dans les lycées de petites villes. Bref, comme dit Tancredi dans le Guépard : « Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi » (« Si nous voulons que tout reste tel qu'il est, tout doit changer »).
Hegel soulignait déjà l'importance de la grammaire pour la pensée , lui qui concevait l'école comme une formation au « beau » plutôt qu'à l'utile. Suffit-il de travailler la grammaire pour devenir proprement humain ? Est-ce cela l'humanisme ? Et quel sens cela peut-il avoir d'élargir de telles humanités au numérique ?
Par cette formule, Hegel s'inscrit dans une tradition humaniste qu'il n'est pas question ici de présenter en détail, je n'ai pas les compétences pour cela, mais dont il est possible de donner une idée. En premier lieu, l'humanisme n'est pas une école philosophique qui articulerait ou développerait des concepts constitués, pour l'essentiel, depuis l'éternité et seraient simplement en attente d'une formulation adéquate. C'est, comme tout le reste, l'effet d'une construction et l'on peut citer des noms illustres pour jalonner cette construction : J. Burckhardt, H. Baron, W. Jaeger, E. Garin, P.O. Kristeller, St. Toussaint, R. G. Witt et bien d'autres encore. Pour indiquer une ligne directrice – je le répète, il ne s'agit pas de faire œuvre d'érudition –, deux textes me semble utiles. En gros, il s'agit de suggérer la constitution et les limites de ce que j'appellerai « l'humanisme lettré ».
Le premier est un extrait des Nuits Attiques d'Aulu-Gelle. Aulu-Gelle est un érudit du IIe siècle de notre ère et ses Nuits Attiques constituent un recueil de notes ou de fiches traitant d'une grande abondance de sujets très divers. Au XIIIe livre, il va expliquer que le terme « humanitas » ne signifie pas ce que croit le vulgaire, mais que ceux qui parlent un latin authentique lui donnent un sens plus précis . Pour l'homme du commun, l'humanitas c'est la φιλανθρωπία (philanthropia) des Grecs et le terme désigne alors une tournure d'esprit bienveillante et bien disposée envers tous les êtres humains, sans distinction. Mais pour ceux qui font plus attention, le terme traduit le mot grec παιδεία (paideia) et désigne alors le fait d'être formé (le terme employé est : « eruditio ») et éduqué (le terme employé est : « institutio ») in bonas artes. On a là, une expression difficile à traduire : certains lisent « arts libéraux », d'autres « culture », d'autres « les vertus ». Quoi qu'il en soit, ceux qui désirent et recherchent sincèrement les « bonas artes » sont humains au plus haut point (« hi sunt vel maxime humanissimi »). Et comme parmi tous les êtres dotés d'une âme, seuls les êtres humains sont capables de se mettre en quête de ce type de savoir, on l'appelle « humanitas ». Bien entendu, Aulu-Gelle ne se présente pas comme l'inventeur de cette interprétation : il renvoie à Varron et à Cicéron comme à des prédécesseurs illustres. L'idée est, au total, assez facile à saisir : un certain rapport à la culture, au sens normatif du terme, est constitutif de l'humanité. Ici, l'humanité n'est pas envisagée comme une donnée biologique, mais comme le fait de s'être dégrossi, de s'être élevé au-dessus de la rudesse et de l'immédiateté naturelles ; c'est aussi l'ensemble des moyens qui permettent un tel travail sur soi.
Le second texte montre les limites d'une telle façon d'envisager les choses. Il s'agit de la lettre de Machiavel à Francesco Vettori du 10 décembre 1513. Cela peut sembler étrange, à première vue, de se référer à Machiavel pour faire comprendre ce qu'est la tradition humaniste. N'est-il pas un maître en manipulation et en dissimulation, enseignant la duplicité et le parjure, comme on le présente à l'ENA et dans les Écoles de commerce ? Lévi-Strauss, une caution philosophique sans doute plus sérieuse, ne le tient-il pas pour un esprit malfaisant ? En fait, Machiavel maîtrise très bien les codes de l'humanisme et cette lettre – écrite en italien – décrit la vie qu'il mène à la campagne suite à sa relégation après une conjuration dirigée contre les Médicis où il avait été impliqué. Il y oppose la journée, consacrée à des occupations triviales, à des distractions communes et à des querelles mesquines, et la soirée où, revêtu de vêtements « dignes de la cour d'un roi ou d'un pape », il entre dans les antiques cours des Anciens et leur demande les raisons de leurs actes. Et eux, par humanité, ils lui répondent. En fait, Machiavel explique à son correspondant qu'il lit le soir, dans sa bibliothèque, les historiens de l'Antiquité. Mais qu'ils lui répondent « per humanità » est intéressant. Il veut peut-être dire que les historiens répondent avec bienveillance à ses questions ; mais il veut peut-être dire aussi que si leurs écrits ne restent pas muets lorsqu'il les interroge, c'est parce qu'il a assez de savoir et de culture pour entendre ce qu'ils ont à dire. Il est donc, en un sens, bien plus humain dans son commerce avec les Anciens que dans la pouillerie de ses journées d'oisiveté forcée. Libéré de la vie naturelle et de ses petitesses, il peut déployer les talents qu'il a développés en s'instruisant. Si cette lettre – dont le véritable objet est peut-être de solliciter un appui afin de retourner aux affaires ! – est conforme aux canons de l'humanisme lettré, elle en marque aussi les limites : le dialogue infini entre les textes anciens et le lecteur contemporain ne peut pas être une fin en soi. On verra bientôt une réflexion s'instaurer (ou un discours se mettre en place) dont l'objet sera de comprendre ce qu'est le propre de l'être capable d'« humanitas ». On passe alors d'un humanisme lettré à un humanisme anthropologique. Mais c'est une autre histoire !
Quant aux humanités numériques, je dois dire que je n'ai pas trop réfléchi à la question. Un parcours de l'ENS les présente comme « Un ensemble de méthodes et d’outils que l’on peut appliquer à l’enseignement et à la recherche en littérature et en sciences humaines et sociales, et qui permettent d’enrichir les objets d’étude, d’en faciliter la diffusion, l’analyse et l’archivage par le biais des technologies issues de l’informatique ». Je n'ai pas de problèmes avec cela, si ce n'est que je me méfie toujours un peu des analyses qui présentent les techniques comme un ensemble de méthodes et surtout d'outils qu'il suffirait de mettre en œuvre pour obtenir ce que l'on voulait...
DES HUMANITES AUX HUMANISMES
Ainsi en Grèce et à Rome, on pratique les « humanitas » dans le lieu clos mais libre, dégagé en théorie de tout autre souci que celui du savoir, propre à l'école – étymologiquement la skolè, c'est le loisir de l'esprit. Ce qu’il faut biensûr nuancer par la puissante utilité sociale et politique de ce savoir en principe désintéressé… Puis surgit une vision humaniste que vous qualifiez d'anthropologique, à laquelle ce que l'on appelle « les grandes découvertes » vont d'ailleurs contribuer.
C'est encore l'occasion de noter qu'« humanités », « humanisme » et « humain », ce n'est pas la même chose. C'est l'origine italienne de l'humanisme qui va retenir ici l'attention. On considère, c'est sans doute un peu arbitraire, que Pétrarque (1304-1374) est le premier humaniste. Est-ce pour autant un homme de la Renaissance ? Je n'en suis pas sûr du tout, sauf à inventer des notions et des périodes comme « Première Renaissance ». On pourrait poser la même question à propos de C. Salutati (1331-1406), le chancelier humaniste de Florence et de bien d'autres encore. Le débat s'articule autour de la question : « Entre le Moyen Âge et la Renaissance, y a-t-il continuité ou rupture ? ». Une conception héroïque de l'histoire privilégiera les ruptures, une conception plus attentive aux détails sera aussi plus attentive aux continuités. Par conséquent, je ne suis pas très emballé par la formule « une vision humaniste anthropologique a surgi ». Il me semble qu'il y a d'abord eu des humanistes pour qui les Humanités visaient à se défaire non seulement de ce qu'il y a de superficiel et d'insignifiant dans l'affairement de la vie quotidienne, mais encore de la rudesse supposée de la langue des scolastiques, écrivant un mauvais latin, plein de barbarismes. C'est pourquoi les premiers humanistes ont attaché une grande importance à la recherche de textes latins perdus et à la reconstitution d'un latin correct, voire élégant. Ce n'est pas qu'ils aient été simplement des philologues scrupuleux, se contentant d'établir et de traduire des textes . Leur intérêt pour les disciplines « humanistes », en effet, était sous-tendu par une certaine conception de l'être humain et de la vie active.
Mais les premiers humanistes ne cherchaient peut-être pas à structurer ces intuitions aussi nettement que des penseurs plus tardifs (et peut-être plus connus) comme Marsile Ficin (1433-1499) ou Jean Pic de la Mirandole (1463-1494). L'un et l'autre ont cherché à rendre explicite ce qui faisait la spécificité de l'être humain, seule créature animée, capable d'action aussi bien que de contemplation ; c'est ce que j'ai appelé « l'humanisme anthropologique ». Ils ont largement puisé dans les ressources antérieures que le travail des humanistes lettrés avait mises à jour : philosophie platonicienne et néo-platonicienne, littérature relative à l'œuvre des six jours, Hermès Trismégiste, etc. Ils ne voyaient pas de difficultés majeures à concilier les traditions chrétiennes (patristique, médiévale) et les traditions non-chrétiennes (juive, arabe, grecque). Leur grande idée, c'est que l'être humain est un caméléon ou un Protée, capables de toutes les transformations et de toutes les métamorphoses (ou presque !). C'est la raison pour laquelle ils étaient fascinés par le Banquet de Platon où Éros est présenté comme un intermédiaire entre le mortel et l'immortel, le savoir et l'ignorance, chasseur habile, curieux de pensées et riche d'idées, etc.
Ainsi, Marsile Ficin écrit que l'âme humaine s'efforce de devenir toute chose, comme Dieu est tout : elle mène la vie du végétal, de l'animal, de l'homme, des démons, des anges et de Dieu lui-même en accomplissant tout par la grâce de Dieu . On assiste ici à une réappropriation de l'idée classique selon laquelle l'être humain récapitule la création.
Jean Pic de la Mirandole est encore plus audacieux peut-être en ce qu'il insiste sur la volonté humaine dans cette affaire : « Mais à l'homme naissant, le Père a donné des semences de toute sorte et des germes de toute espèce de vie. Ceux que chacun aura cultivé se développeront et fructifieront en lui : végétatifs, ils le feront devenir plante ; sensibles, ils feront de lui une bête ; rationnels, ils le hisseront au rang d'être céleste ; intellectifs, ils feront de lui un ange et un fils de Dieu » .
On pourrait multiplier les exemples avec des auteurs bien moins fréquentés que ceux-ci. Par exemple, Lodovicus Caelius Rhodiginus, de son vrai nom Lodovico Ricchieri, dans son Lectionum antiquarum libri sexdecim (qu’on pourrait traduire par Lectures antiques en seize livres ). En dépit de la présence, dans le titre, du mot « lectio » qui évoque l'enseignement médiéval, c'est indiscutablement un ouvrage humaniste.
Dans le premier livre de son œuvre, en effet, l'auteur affirme qu'il existe trois mondes (le supra-céleste, le céleste et le sublunaire), mais que l'homme constitue en fait un véritable quatrième monde parce qu'il y a en lui des images de chacun de ces trois mondes et qu'il est capable, dès lors, de passer de l'un à l'autre .
Toutefois, cette mobilité ou cette puissance de se métamorphoser ne sont pas absolues : le monde de M. Ficin, de Jean Pic de la Mirandole ou de Lodovico Ricchieri est encore un cosmos aux contours bien définis. Il n'est pas possible d'aller au-delà de l'union avec Dieu ; il n'est pas possible de régresser en-deçà des formes les plus basses de la réalité. Les humanistes sont des humanistes, pas des transhumanistes. Je m'accorde avec G. Hottois, pour des raisons qui ne sont probablement pas les siennes toutefois : le transhumaniste est bien un humanisme ! Mais il ne s'inscrit plus dans un monde fini, sphérique et centré. Le débat contemporain autour du transhumanisme gagnerait certainement en clarté si des distinctions élémentaires de ce genre étaient faites. Mais il semble que pour beaucoup de philosophes, la Lettre sur l'Humanisme de Heidegger soit l'alpha et l'oméga en matière d'humanisme ; je ne suis pas du tout convaincu que ce soit le meilleur moyen d'aborder la question.
Les découvertes techniques vont bousculer l'appréhension du monde. L'imprimerie, la boussole, le joug pour les animaux, quelques inventions parmi d'autres, qui vont transformer le rapport au travail, à l'écriture, à l'école et au politique. Les humanismes, y compris celui qu'aujourd'hui on nomme le transhumanisme, seraient-ils une figure du scepticisme, par leur usage du vraisemblable ou du probable ?
Il pourrait être utile d'avoir à l'esprit l'avertissement de P. Magnard : « Si l'on veut caractériser la Renaissance on doit le faire non par l'humanisme mais par la diversité des différents humanismes s'interpénétrant » . L'idée est tout simplement qu'il y a une histoire de l'humanisme.
J'ai essayé de montrer qu'on est passé d'un humanisme lettré pour lequel on devient un homme accompli en pratiquant les disciplines des humanités (histoire, rhétorique, politique, éthique) à un humanisme anthropologique où l'on se demande plutôt ce qui fait le propre de cet homme que l'on cherche à accomplir – et qui cherche à s'accomplir – par l'étude. Or, les humanistes dont j'ai parlé jusqu'alors ne sont certainement pas des sceptiques : bien au contraire, ils sont tellement assurés de leur démarche qu'ils ne relèvent pas de réelle tension entre les éléments de la foi chrétienne et l'héritage restauré des Anciens.
Marsile Ficin est tellement peu perturbé par les découvertes techniques, qu'il minimise d'ailleurs, qu'il estime que la découverte d'arts innombrables fait une des différences entre les hommes et les animaux : ces derniers ne réalisent avec le temps aucun progrès dans l'habileté de l'exécution, contrairement aux êtres humains. Il s'agit là d'un topos que Rousseau retrouvera – peut-être même à partir d'une lecture de Marsile Ficin – sous le nom de « perfectibilité ». En fait, pour répondre à votre question, il y a peut-être lieu de distinguer deux orientations (au moins !) de l'humanisme à partir des premiers textes où un humanisme anthropologique s'est manifesté. Dans tous les cas, on insiste sur la notion de dignité de l'homme. Mais selon une première orientation, on insiste sur la puissance de métamorphose et de mutation qu'elle comporte. C'est alors la prodigieuse diversité des conduites, des institutions, des mœurs et des représentations qui retient l'attention.
Plutôt que de scepticisme, on pourrait peut-être alors parler de relativisme ou, mieux, de perspectivisme : il n'existe pas de position en surplomb qui permettrait de dire si telle mutation, si telle métamorphose vaut mieux qu'une autre. C'est la capacité même de mutation et de changement qui a une valeur et cette capacité, tout homme (Tout homme, vraiment ? C'est là le problème...) est capable de la manifester. On retrouve peut-être ce genre d'inspiration chez Nietzsche. Selon une seconde orientation, on insisterait plus sur le fait que cette puissance est donnée à l'être humain seul, le reste des êtres de l'univers en étant dépourvus. Il y aurait donc d'une part des êtres « de nature » agis de l'extérieur par des lois physiques sur lesquelles ils n'ont pas prise ; et d'autre part des êtres « de liberté », capables de se représenter eux-mêmes et de se donner à eux-mêmes les règles rationnelles de leur agir. Les êtres de nature seraient toujours en extériorité : aussi loin qu'on déplie leurs organes, on ne saurait trouver en eux cette valeur intérieure absolue qui est celle des personnes. On retrouve sans doute ce genre d'inspiration chez Kant, pour qui l'humanisme comporte une dimension universelle.
« Former l'esprit à la retenue » constitue un programme intéressant pour l'humanisme de l'école, face aux certitudes et au manque de réflexion qui règnent dans les réseaux sociaux et ailleurs. Un exemple : Machiavel, dans le chapitre le plus « machiavélique » du Prince , écrit que les hommes jugent davantage aux yeux qu'aux mains, car il revient à tous de voir, à peu de sentir. Il est évident que ce passage distingue la réalité et l'apparence en politique. Mais comment ? Nous dit-il, banalement, qu'il faut se méfier des apparences et ne former que des jugements motivés et justifiés par l'épreuve des faits ?
En réalité, les spécialistes pensent aujourd’hui qu'il s'agit d'une allusion à un fabliau florentin de l'époque : la fable des grives. Des grives se sont prises dans des filets qu'un chasseur a tendus pour les capturer. Il fait un froid épouvantable et lorsque le chasseur arrive pour récupérer le produit de sa chasse, il a les yeux tout rougis. Une jeune grive dit alors aux autres : « Regardez, il a les yeux pleins de larmes ! C'est un homme bon ! Il va nous relâcher ». À quoi une veille grive expérimentée répond, pendant que le chasseur commence à étrangler les oiseaux pris au piège : « Innocente ! Tu ne sais donc pas qu'il faut juger aux mains et non aux yeux ? ». Cela change toute l'interprétation du passage de Machiavel. Il faut un minimum de patience et de lectures pour que le passage révèle, je ne dis pas son véritable sens, mais au moins un sens qu'il était difficile de repérer à première lecture. C'est cela que la fréquentation des textes, pas seulement de l'Antiquité d'ailleurs, peut apporter.
HUMANITE ET ANIMALITE
Tout cela reconduit irrésistiblement la question de l’homme à celle de son rapport à l’animal, que vous avez traitée dans Qu'est-ce que l'animalité. Vous écrivez dans cet ouvrage : « Ainsi, l'animalité ne renvoie plus à la figure de l'altérité, comme elle a toujours fait : elle ouvre sur une absence radicale de limites assignables, de telle sorte que le défi de Plutarque apparaît bien innocent » . Défi qui consistait à attribuer des qualités morales à l'animal. Pouvez-vous nous expliquer ?
Il est clair qu'en insistant sur la dignité de l'homme et en soulignant son statut particulier au sein de l'univers, statut qui consiste à n'avoir pas de place assignée à l'avance mais à se montrer capable de les occuper toutes, les humanistes ont contribué à approfondir le fossé entre les animaux et les humains. Tout un mouvement philosophique contemporain dénonce cette situation : il s'agirait là d'une forme conceptuellement insoutenable d'anthropocentrisme, entraînant des conséquences éthiques catastrophiques. Ainsi, l'animal ne serait jamais envisagé pour ce qu'il est en lui-même, mais toujours de façon négative, comme un ensemble de privations ou de déficiences : l'animalité serait ce qui reste quand on a mis de côté tout ce qui appartient de droit à l'homme et constitue l'humanité. L'animal serait ainsi sans outils, sans techniques, sans langage, sans liens politiques, sans pensée conceptuelle, sans arts, sans mémoire et sans histoire, sans religion, sans culte des morts, pauvre en monde, etc. Florence Burgat a écrit de très belles pages, informées, nuancées et éloquentes sur ce thème .
Mais cette accusation d'anthropocentrisme ne me paraît pas très bien fondée en ce qui concerne les premiers humanistes. E. Panofsky avance une remarque à la fois très fine et très profonde à propos de Jean Pic de la Mirandole et de ce « manifeste » de l'humanisme anthropologique qu'est le De la dignité de l'homme. Contrairement à ce qu'une lecture rapide, superficielle ou biaisée, voire ignorante, pourrait laisser supposer, il n'y est en aucune façon affirmé que l'homme est le centre de l'univers. Il est dit, ce qui est tout à fait différent, que l'homme a été placé (par Dieu) au centre de l'univers afin que, prenant conscience du lieu où il se trouve, il pût se tourner librement vers la direction de son choix . Cela signifie que Jean Pic de la Mirandole ne considère en aucune façon la terre comme un séjour agréable et confortable, où l'humanité pourrait prendre ses aises et jouir paisiblement de sa supériorité sur le reste de la création. Tout au contraire, c'est le lieu où va s'effectuer un séjour décisif. Comme dans le mythe d'Er qui clôt La République de Platon, l'individu doit opérer le choix de sa destinée : plante, bête, être céleste, ange et fils de Dieu. Il pourra même choisir de former avec Dieu un seul esprit.
Il faut remarquer que choisir de rester simplement un homme n'est pas une option réellement envisagée par Jean Pic de la Mirandole : on ne peut pas choisir d'accomplir pleinement son essence d'être humain, comme ce serait le cas dans une perspective essentialiste où le méritoire serait de « faire son métier d'homme », selon une formule que j'ai toujours trouvée un peu niaise. L'humanité apparaît ici comme l'effet d'un choix, pas comme un donné. Mais qui dit choix dit aussi possibilité d'erreur et d'aveuglement. Tout ceci, Jean Pic de la Mirandole l'exprime de façon imagée et peut-être naïve : l'homme est vraiment comparable à un végétal, à une bûche, s'il cède à ses désirs gloutons ; à une bête s'il est l'esclave de sa sensualité ; à un être céleste s'il mène la vie d'un philosophe cherchant à connaître par les causes ; à une divinité s'il se retire dans le sanctuaire de son esprit.
Mais sur la question de l'anthropocentrisme, on trouve quelque chose de très comparable chez Jacques Ellul, dans un contexte bien différent, cela va sans dire. On connaît Jacques Ellul comme penseur de la technique et comme inventeur du thème (plutôt malheureux !) de la technologie devenue autonome. Mais c'est aussi un profond théologien réformé. Or, commentant le récit du jardin d'Eden, il écrit : « Il ne nous est pas dit que l'homme occupait toute la création, mais qu'il avait une place limitée, cependant souveraine » . L'homme n'occupe pas toute la création ! Cela veut dire qu'un anthropocentrisme béat n'est pas du tout une attitude appropriée. Nous attribuons aux animaux des qualités morales dans les fables, parce que nous en avons déjà fait des êtres humains déguisés, parés de plumes, de poils ou d'écailles. En fait, depuis Darwin, on se doute bien qu'il existe une continuité et des différences entre les émotions des êtres humains et celles d'autres mammifères. Mais le point important n'est peut-être pas là. Un humanisme à la Jean Pic de la Mirandole n'a pas besoin d'entrer dans le détail : il lui suffit de savoir qu'une certaine inquiétude parcourt les divers degrés de la vie universelle. Cette inquiétude rend dérisoire la construction d'une forteresse anthropocentrée, à partir de laquelle les êtres humains, enveloppés dans leur ego, pourraient lancer des expéditions ou des razzias afin de dominer et d'exploiter le monde à leur guise. Il est douteux que l'école se charge d'enseigner un jour cette inquiétude.
Finalement, que nous reste-t-il de l’héritage humaniste ?
L'humanisme dont Marsile Ficin, Lodovico Ricchieri, Jean Pic de la Mirandole sont des figures emblématiques n'est pas le tout de l'humanisme. C'est une option qui n'a pas toujours été poursuivie, tant elle semblait ouvrir des perspectives vertigineuses. On a vu également émerger des humanismes beaucoup plus prudents, voire gestionnaires ou bien soucieux des droits de l'homme ou bien encore prônant une adhésion éclairée à l'ordre des choses afin d'agir sur celui-ci. À certains égards, J.P. Sartre est très représentatif d'une telle hésitation, entre l'intransigeant et – il faut bien le dire – un peu simpliste L'existentialisme est un humanisme et des œuvres plus nuancées comme la Critique de la raison dialectique.
Par ailleurs, on est toujours effleuré par le soupçon que derrière les brillants écrits humanistes se trouve une mise en scène rhétorique, une espèce de jeu. Par exemple, on a repéré depuis longtemps que Le Prince de Machiavel s'inscrit dans la longue lignée des « miroirs des princes », une littérature souvent édifiante de conseils ou d'avis aux gouvernants ; mais bien sûr, qu'il y occupe une place tout à fait singulière ! Bref, la littérature humaniste des renaissants s'accorde mal avec l'esprit de sérieux. Mais pourquoi écrire et penser cum grano salis serait-il condamnable ?
On peut remarquer aussi que les premiers humanistes s'opposaient au style rébarbatif et à la langue rugueuse des scolastiques. Cette opposition avait un sens : il s'agissait de constituer la langue et la culture d'un groupe social qui avait un rapport au réel différent de celui qui prévalait dans les Universités. Mais elle est devenue un topos plutôt désastreux. « Haro sur la scolastique ! » est devenu le mot d'ordre de tous ceux (et ils sont légion !) qui veulent se débarrasser de toute rigueur. Dire d'une pensée qu'elle est scolastique, c'est la condamner : lourde, abstraite, éloignée des beautés de l'ordinaire et des délices de la vie commune, elle ne peut que pontifier et énoncer des préceptes poussiéreux, sans aucune prise sur la réalité, si diverse et si complexe. Aussi voit-on paraître tous les jours de petits traités de ceci ou de cela, tous évocateurs de légèreté, ou émerger des objets philosophiques supposés inédits, comme les films de remariage ou les séries télévisées. Mais la scolastique est une magnifique entreprise d'interprétation de la réalité, qui est allée aussi loin qu'elle pouvait aller et a produit des chefs d'œuvre dans tous les domaines. S'en prendre à la pensée scolastique au nom de la nature infiniment ondoyante de la réalité, c'est s'en prendre à la pensée tout court, ce que les humanistes authentiques ne font pas.
Il ne faut pas oublier enfin que le premier philosophe à avoir théorisé de façon précise la différence entre la philosophie abstraite et profonde et la philosophie facile et claire, David Hume était non seulement un maître en l'une et l'autre, mais se voyait lui-même comme un ministre résident ou un ambassadeur des provinces du savoir auprès de celles de la conversation.
Merci à vous Jean-Yves Goffi.
A LIRE AUSSI SUR NONFICTION :
L’humanisme avant l’humanisme :
Wilfried Stroh, La puissance du discours. Une petite histoire de la rhétorique dans la Grèce antique et à Rome, par Philippe Rousselot
« Histoire de l’idée de progrès de l’Antiquité au XVIIe siècle », par Mathilde Herrero
L’humanisme à la Renaissance
Saverio Ansaldi, L'imagination fantastique. Images, ombres et miroirs à la Renaissance, par Christian Ruby
Nicolas de Cues, La Chasse de la sagesse, par Maryse Emel
Jean Delumeau, Le mystère Campanella, par Antoine Roullet
Erasme, Complainte de la paix, par Christian Ruby
Juste Lipse, Crucifixions, par Maryse Emel
Sur l'animalité
Florence Burgat, Penser le comportement animal. Contribution à une critique du réductionnisme, par Hicham-Stéphane Afeissa
Patrick Llored, Derrida et la question de l'animalité par Hicham-Stéphane Afeissa
Sur Machiavel en particulier
Patrick Boucheron, Un été avec Machiavel, par Jean Bastien
André Lo Ré, Pour en finir avec le machiavélisme. Une lecture de Machiavel pour notre temps, par Christian Ruby
« (Re)lire Machiavel : actualité d’une pensée politique aussi incontournable que méconnue », par Kalli Giannelos
L’humanisme aujourd’hui
Notre dossier « Rencontres d’Uriage : quel humanisme pour le XXIe siècle ? », par Maryse Emel
Milad Doueihi, Pour un humanisme numérique, par Philippe Aigrain
Marc Fumaroli, La République des Lettres, par Christian Ruby
Alexandre Gefen (dir.), Vies imaginaires. De Plutarque à Michon, par Christian Ruby
Alain Renaut, Un humanisme de la diversité. Essai sur la décolonisation des identités, par Alain Policar
Jean-François Braunstein, La Philosophie devenue folle. Le genre, l'animal, la mort, par Jean-Yves Goffi