Dans Interview (au Théâtre du Rond-Point jusqu’au 17 mars, puis en tournée), les comédiens Judith Henry et Nicolas Bouchaud interrogent l’entretien de presse. Ils l’interrogent à leur façon – à la façon dont les comédiens appréhendent le monde : en jouant la comédie. Pour Nicolas Truong, leur auteur et metteur en scène, le théâtre et l’interview sont deux univers qui se comprennent l’un l’autre dans l’élément de la parole et de la sensibilité.

Tous trois, ils sont allés « sur le motif ». Ils sont allés interroger les interrogeurs de profession, les observer, s’en instruire et les comprendre. Ils sont allés saisir, par empathie et par écoute, leur situation, leur expérience concrète. Et ils en sont revenus, avec leur petit trésor de comédien, qui est l’art d’imiter, la faculté d’émouvoir, le pouvoir de remuer ensemble notre sensibilité et notre jugement. Sur la scène, ils se présentent ainsi comme les héros de leur spectacle, et les voilà partis pour tourner autour de ce « beau danger », l’interview, selon que Michel Foucault l’a caractérisé autrefois , à la recherche d'un "discours frais", c'est-à-dire un moment authentique.
D’emblée, ce qu’ils veulent savoir, c’est quelle question il importe de poser. Quelle question peut conduire l’interviewé à parler. Ils vont ainsi faire un chemin rempli de sens, d’intervieweurs en interviewés et en interviews, et de questions en paroles.
Nicolas Truong, dont le métier est aussi d’interviewer , a bien voulu inverser les rôles pour Nonfiction.
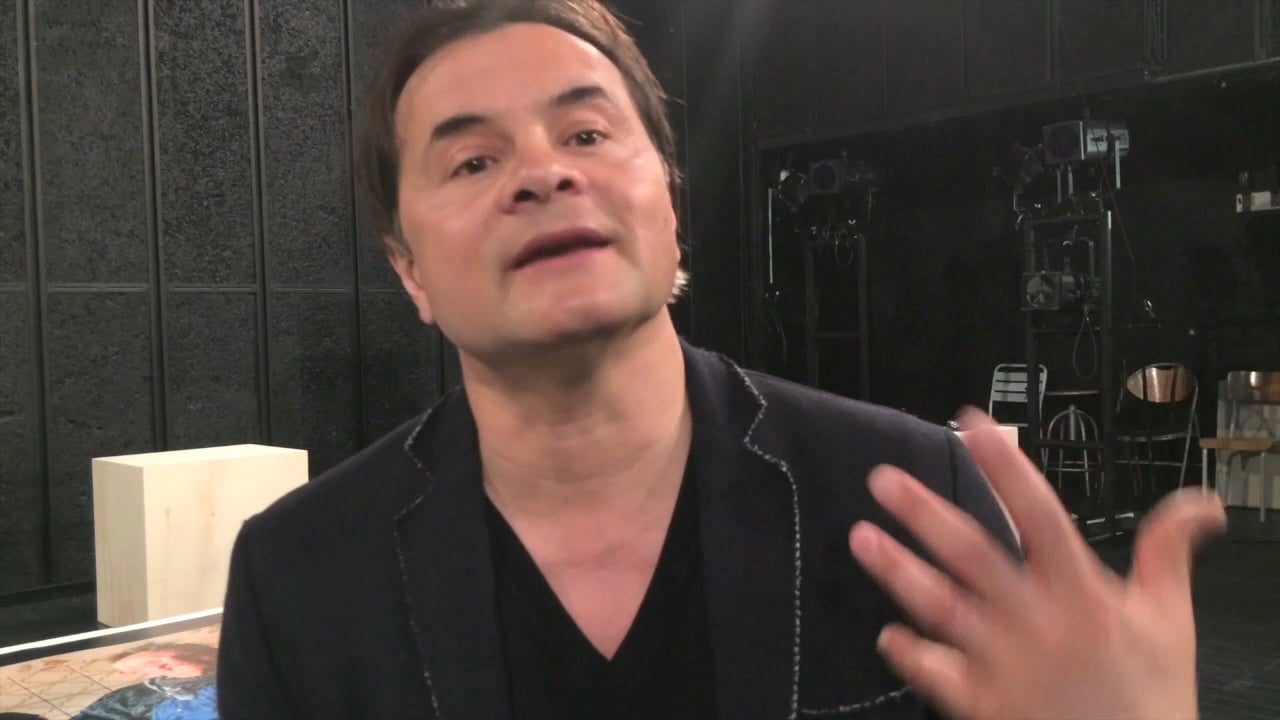
Nonfiction : Nicolas Truong, qu’est-ce que ça a de si important, une question ?
Nicolas Truong : Une question, c’est lié à la curiosité, à l’étonnement. C’est un des ressorts de l’activité humaine lorsqu’elle s’est affranchie des nécessités (se nourrir, travailler, etc.). La philosophie, comme chacun sait, débute avec le questionnement.
Mais la question, dès les commencements, c’est aussi une forme de subversion, contre ceux qui ont des réponses toutes faites, toutes prêtes, qu’elles soient théologiques, politiques, ou autres. Demander par exemple : « Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ? », c’est présupposer qu’on n’a pas nécessairement la réponse, et qu’un système quel qu’il soit, s’il en propose une, devra s’expliquer. Si Kant demande : « Que m’est-il permis d’espérer ? » ou « Que puis-je connaître ? », c’est qu’il y a quelque chose à chercher, dont on est curieux. C’est presque des questions d’enfant. Et les questions d’enfant, c’est parfois dérangeant.
Ainsi, la question n’est pas liée seulement à l’entretien de presse. Elle a une dimension philosophique, elle ouvre un champ d’investigation très large. Et c’est la raison pour laquelle elle est si importante.
Ce qui est remarquable aussi, c’est qu’une question oriente un entretien. À la question elle-même s’ajoute la façon dont on la pose, et à quel moment. Cette situation conditionne la conduite de l’entretien. Par exemple, vous pouvez demander à un comédien dans quel restaurant il préfère aller, ou ce qu’il ressent lorsqu’il va entrer en scène, ou encore comment un texte, physiquement, s’apprend, s’incorpore, devient une part de lui-même. Dans les trois cas vous orientez votre entretien, soit vers l’anecdotique, soit vers l’essentiel.
Et ce qui achève de rendre l’exercice subtil, c’est que ni l’anecdotique, ni la légèreté ne doivent être écartés par principe. Moravia a fait un entretien avec Claudia Cardinale, en 1961, qui est très intéressant de ce point de vue. Ses questions ne sont pas liées à la carrière ni à l’œuvre de Claudia Cardinale, ni même à son travail de comédienne, mais à des choses beaucoup plus simples, presque « phénoménologiques ». « Comment apparaissez-vous dans la journée ? », « Comment vous levez-vous le matin ? », « Quelles sont vos premières pensées? », etc. C’est un entretien très beau, où toutes les questions ont cette orientation singulière .
Il faut juste être attentif car on peut pécher par excès de maîtrise si, comme le montre Jean Hatzfeld, on a une façon de poser les questions qui induit les réponses. Par exemple : « N’est-ce pas que c’est terrible ce qui vous arrive ? ». Un « N’est-ce pas que... » suffit à ôter à une question son caractère questionnant. En revanche, vous pouvez poser des questions frivoles et légères, très drôles et très bien tournées, sur la vie quotidienne – il n’y a pas de honte – ou sur tout autre chose, du moment qu’il y a « la manière », qui va faire qu’elles sont intéressantes ou pas, habiles ou non, et suivies d’effets remarquables.
On peut, comme Jean Hatzfeld, quand il interviewe les bourreaux et les victimes du génocide rwandais, avoir sa liste de questions. C’est comme une batterie dont on dispose, mais on ne va pas forcément la suivre. Hatzfeld a cette intelligence-là, que tout intervieweur a expérimenté. Il a un point d’appui, un petit réservoir. Mais ce qui va compter vraiment, c’est l’opportunité de la question. C’est aussi tous les éléments particuliers au fait que ce sera un interview en direct à la télévision, ou à la radio plutôt que pour la presse écrite. Aujourd’hui, on pratique aussi l’interview par mail, ce qui suppose là encore une formulation très soignée, bien adaptée.
En ce sens, je vois une deuxième raison pour expliquer ce qu’une question a d’important, c’est qu’elle sollicite une parole. L’art de bien présenter cette sollicitation, c’est l’art de l’intervieweur.

Alberto Moravia, Claudia Cardinale
NF : Y a-t-il aussi, chez l’intervieweur, un engagement particulier, comme semble en témoigner Jean Hatzfeld, en consacrant plusieurs années de sa propre vie au génocide du Rwanda, en allant vivre là-bas, etc. ?
N.T. : Jean Hatzfeld, c’est vrai, paie de sa personne même l’intention de faire de bons interviews. Mais au fond, cela renvoie plutôt à ce que nous soulignons dans le spectacle, à savoir que l’entretien, tel que nous le concevons, demande un minimum de temps. Le temps nécessaire à réunir les conditions d’un questionnement adéquat. Ainsi, pour faire parler des rescapés, des victimes, et même des bourreaux de ce génocide, il lui fallait du temps, beaucoup plus de temps que ne l’autorise une activité journalistique ordinaire, qui lui aurait imposé de rentrer à Paris au bout d’une semaine, ou d’envoyer un "papier" dans l’urgence.
NF : L’intervieweur est-il à la recherche d’un secret ?
N.T. : Non, je ne le pense pas. La plupart des interviews qu’on entend le matin à la radio, on y cherche un scoop, une petite phrase, mais pas un secret. Il ne faut pas confondre la révélation d’une parole, et son authenticité, avec la révélation d’un secret, d'un savoir caché.
Notre propos, c’est de dire que l’entretien est un moyen de faire advenir des vérités le plus simplement du monde. Il suffit de questionner quelqu’un, ce n’est pas très compliqué. C’est un outil banal et banalisé, un genre où il ne se passe plus grand-chose aujourd’hui, tant il est répandu. Mais nous disons aussi qu’il lui reste toujours cette possibilité exceptionnelle de faire advenir des moments de vérité absolument étonnants. Le moment, par exemple, où un tueur génocidaire dit à Jean Hatzfeld ce qu’il a fait et comment. Le moment où la star de cinéma lâche quelque chose dans le vide. Celui où Serge Daney, dans son entretien avec Régis Debray, entre dans un monologue incroyable où il confie sa vie , et cet autre où Marceline Loridan, dans le film Chroniques d’un été , cesse de badiner avec les gens sur la place de la Concorde et se met, d’elle-même, à répondre à une question, à raconter sa déportation à Auschwitz, comment elle n’a pas revu son père, et ce qui s’est passé là. C’est un moment où la personne sort d’elle-même, par la parole qui surgit . Et cela arrive aussi avec des interviews drôlatiques comme celui de Françoise Sagan par Pierre Desproges. C’est un canular de Desproges qui ménage un moment précieux, car l’humanité de Sagan apparaît, d’une façon très belle .
Quelque chose se passe. Une révélation de la personne interviewée, de son œuvre. L’apparition d’une complicité. Quelque chose, encore une fois, se dit, se lâche, arrive. Mais la plupart des interviews ne relèvent pas de ça.

Marceline Loridan tenant le micro, dans Chronique d'un été.
NF : Comment s’explique que l’interview navigue entre bavardage, communication et expression ?
N.T. : C’ est un outil profondément démocratique. Il faut comprendre que lorsque l’interview est arrivé, notamment au XIXème siècle avec l’essor de la grande presse, les gens ne voulaient pas répondre. Si l’on demandait à un ministre : « mais pourquoi faites-vous la guerre ? », l’autorité répondait : « vous êtes qui, vous, pour poser des questions » ?
C’est donc au départ une conquête démocratique. Mais immédiatement, c’est aussi quelque chose de très intrusif.
Dès le début, tout y est : l’intention démocratique, le conflit avec l’autorité, la communication, la propagande servile, l’obscénité intrusive, le côté détestable du nivellement par le bas… Aujourd’hui, c’est la communication qui prend le dessus, et la langue de bois (les « éléments de langage »), non seulement dans la politique, mais aussi dans l’art.
Il ne se passe donc plus grand-chose aujourd’hui. Mais l’interview demeure un exercice fascinant, car ses outils sont d’une grande simplicité, et tout demeure possible. A priori, tant qu’il ne s’agit pas de télévision ou de radio, on n’a besoin de presque rien – c’est comme au théâtre.
Et c’est pourquoi, au début du spectacle, Judith et Nicolas arrivent comme des comédiens mis à nu, qui ont le trac. Judith dit ce texte de Foucault décrivant l’entretien comme « un beau danger ».
Le fait est que, comme au théâtre, il y a, dans un entretien de presse, un dialogue et un public. Ici même, nous ne sommes pas que tous les deux : il y a nonfiction, et il y a ses lecteurs. Je sais que l’entretien sera transcrit, recomposé, mais cependant je fais attention : je parle en sachant qu’il y a toujours un tiers qui est le destinataire de l’interview – le lecteur.
Comme au théâtre, il va se passer quelque chose. C’est ça qui m’intéresse, le duende , ces moments d’éclats, qui peuvent être dans la colère, dans la confidence, dans la confession, comme dans la rationalité la plus pure.
Notre question, par conséquent, c’est comment fait-on pour retrouver aujourd’hui cette fraîcheur ?
Le spectacle va ainsi de l’évocation de Chronique d’un été, au début, à celle des films de Claudine Nougaret et Raymond Depardon, à la fin, à cause de ce « discours frais » dont parlent ces derniers. Ce « discours frais » qui se trouve déjà dans Chroniques d’un été. Dans ce film, on a l’impression d’avoir affaire à des paroles d’avant l’ère de la communication. Les gens n’ont pas encore complètement intégré le langage médiatique. Il y en a même qui n’ont jamais vu de micro et qui en ont peur. Marceline Loridan leur pose une question, leur tend le micro, et ils se demandent ce que c’est, ils s’en écartent.

Pier Paolo Pasolini, Enquête sur la sexualité (Comizi d’amore), 1965
NF : Pour Interview, vous avez nécessairement été interviewé. Les intervieweurs ont-ils trouvé la bonne question à vous poser ?
N.T. : Il y a d’abord eu cette interview un peu particulière que fait le Théâtre du Rond-Point pour son dossier de presse, conduite par Pierre Notte. Particulière parce qu’elle est, fatalement, communicante. Mais c’est un effort de communication qui m’a conduit à la réflexion. L’interview a un effet réflexif sur l’interviewé, pour le moins. Je ne dis pas que je n’avais pas réfléchi au spectacle que je montais. Mais j’étais dans l’action. On travaille, on construit, on livre quelque chose, puis, après coup, l’interview nous incite à un retour sur ce qui a été accompli.
Ainsi, je ne peux pas vraiment distinguer quelles questions exactement ont marché, mais je sais que ces questions ont eu cette vertu introspective. Celle-ci : Qu’est-ce que c’est que de recevoir des questions quand on fait un spectacle qui s’appelle Interview ? Ça fait tout de même accoucher de quelque chose qu’on n’avait pas forcément vu, et ça dynamise la réflexion.
D’ailleurs, ce n’est pas toujours une question compliquée qui va déclencher la chose la plus intéressante. C’est parfois une question simple, qu’on n’aurait peut-être pas osé poser, surtout si c’est, par exemple, à Jean-Luc Godard. On s’autocensure parce qu’on se dit : « c’est trop simple », et on a tort.
NF : Venons-en au spectacle proprement dit. Pourquoi avoir mis sur le plateau des héros-comédiens partis à la recherche du « discours frais », plutôt que de mettre en scène, tout simplement, des interviews mémorables ?
N.T. : J’y ai pensé. Il y a beaucoup d’entretiens magnifiques, comme l’ultime interview de Pasolini . Mais il me semblait plus pertinent de questionner le genre.
Comme journaliste autant que comme spectateur de théâtre, je trouve que cette chose-là a été très peu questionnée. Faire des interviews au théâtre, prendre Marguerite Duras avec François Mitterrand, Michel Platini etc., cela a été fait, et très bien fait. Les entretiens que Pierre Bourdieu a mené pour la misère du monde , par exemple, ont beaucoup été représentés. Nicolas Bouchaud a fait un très beau spectacle, lui aussi, à partir de l’interview que Serge Daney a donné à Régis Debray.
L’originalité que j’ai voulu donner à ce spectacle tient à deux objectifs principaux, qui le démarquent un peu.
Le premier objectif – nous venons d’en parler beaucoup – consiste à faire réfléchir à ce que c’est que faire advenir la parole. On n’en parle guère. Et c’est, bien au-delà du métier que je pratique, une question importante, qui tourne autour de ce que nous considérons être le statut de la parole aujourd'hui, entre communication et expression.
Le second objectif, c’est d’essayer de créer quelque chose sur le plateau : les conditions (cette fois esthétiques) qui permettraient au public, au terme de ce temps passé avec nous devant le quatrième mur, de répondre vraiment à des questions, dans une interview. Nous essayons de faire en sorte que le spectacle crée un climat de confiance et d’attention, et qu’il donne quelque chose au public, qu’il lui témoigne d’avoir traversé une expérience ensemble. Mettre les personnes présentes dans la situation de pouvoir venir s’asseoir sur les deux chaises de Raymond Depardon, sur lesquelles nous terminons la représentation.
Avec la représentation d’une très belle interview, peut-être pourrait-on obtenir un effet du même genre. Mais pour moi, ça devait passer plutôt par la mise en espace de cette recherche menée par les comédiens.
Serge Daney, interviewé par Régis Debray
NF : Au-delà de ces deux objectifs (qu’on pourrait appeler l’aspect documentaire et l’aspect cathartique), avez-vous eu le désir de dire quelque chose sur vous ?
N.T. : Quand j’ai mieux regardé mon spectacle précédent, Projet luciole, je me suis aperçu que je n’avais pas vu à quel point ma vie était sur scène. C’est un spectacle sur la philosophie, sur la pensée critique, comment on rend compte, comment on se rend compte à soi-même, comment on aime quelqu’un, comment on quitte quelqu’un. C’était un spectacle sur les livres, aussi : comment les livres font partie de la vie. Les livres tombaient du ciel, on s’enlaçait avec, ou on se les envoyait comme des projectiles, etc.
Dans Interview, c’est la même chose, d’un autre point de vue. L’entretien, la rencontre, le rapport à la parole, ont construit ma personnalité dès le plus jeune âge. J’ai grandi dans un milieu où le rapport à la culture n’était pas une évidence, dans une banlieue parisienne. Pour aller voir les gens qui me plaisaient, et qui n’étaient pas immédiatement là, je me suis servi de la parole. J’ai un peu utilisé la « tchatche » de la banlieue. Non pas pour faire de « l’impro », même si j’ai parfois joué de la musique derrière des matchs d’improvisation théâtrale, mais pour aller voir les philosophes, les penseurs, les hommes politiques, et les musiciens. Je suis né à Paris, j’ai grandi dans la ville nouvelle de Saint-Quentin en Yvelines. J’ai passé mon bac à Paris. J’avais monté une revue au lycée dans laquelle je faisais beaucoup d’interviews, et c’est ça qui m’a conduit au journalisme.
Quand on fait le bilan, quand on regarde tous les entretiens qu’on a fait, comment on les a fait, qui on a interviewé, je pense qu’on peut dessiner une autobiographie, au travers des gens qu’on interviewe, de la façon dont on les interviewe, de ce qu’on fait ressortir des entretiens. Il y a quelque chose de soi qui se dessine à travers les autres. La façon dont on questionne les autres dessine une figure de soi – j’en suis convaincu.
De sorte qu’on distingue la question que pose l’intervieweur et le questionnement dans lequel il est lui-même. Il y a la question qu’on a posée parce qu’il y a quelqu’un qui a fait une pièce de théâtre, et sur ce sujet, on va essayer de poser les questions les plus pertinentes et les plus intéressantes. Mais il y a aussi, qui dessinent un portrait en miroir, tous les interviews qu’on a pu faire, la façon dont on les a conduites, les gens qu’on a rencontré, qui sont liés à notre questionnement.
L’intervieweur se situe dans un questionnement d’où il va chercher chez les autres, qu’il interviewe, non seulement la connaissance de l’autre, mais aussi quelque chose de lui-même, qui fait que ce qui parle de l’autre parle aussi de lui-même.

Jean Hatzfeld
NF : Le héros de la pièce, et l’agent actif de l’interview en général, c’est donc l’intervieweur, et non pas l’interviewé ?
N.T. : Le héros, mais au sens antique du terme. Le héros mais pas la star.
Quand on réussit bien une interview, surtout en public, on est exténué, comme un comédien. C’est un art de la conduite, où l’on trouve quelque chose de soi-même.
Mon intérêt, qui motive la création du spectacle, ce n’est pas simplement que l’interview soit un genre amusant. Ce n’est même pas qu’il s’agisse d’un genre en perdition, qui n’est devenu que communicationnel, et par là moins intéressant qu’autrefois. Mon intérêt profond est ailleurs. Il est dans le fait qu’il s’agit d’un art de la rencontre. Grâce à ce moyen, on rencontre des gens qu’on ne connaît ni d’Eve ni d’Adam, on les rencontre pour parler d’un film ou d’un programme politique, mais on peut aussi bien les rencontrer tout court. On peut tomber amoureux des gens, on peut s’engueuler avec eux, on peut nouer une relation un peu singulière. L’interview donne l’occasion de faire des rencontres humaines. C’est pourquoi le spectacle, à la fin, le propose à tous.
L’intervieweur peut donc bien être considéré comme un héros en ce sens-là, mais pas comme une star, car il s’agit de s’effacer. Or il y a des intervieweurs-stars, qui font de l’interview un « show », en y faisant preuve d’une maestria incroyable, et ne s’effacent pas du tout.
Régis Debray dit qu’une interview réussie devrait permettre les conditions d’un monologue. Un monologue de l’interviewé, dans lequel se dessine, mais seulement en creux, un certain portrait aussi de l’intervieweur.
C’est en ce sens que Jean Hatzfeld, par exemple, obtient une certaine reconnaissance et une célébrité, la faveur d’une estime générale qui toutefois demeure en négatif des récits de ses interlocuteurs au Rwanda. D’ailleurs, le nom de Jean Hatzfeld se trouve maintenant lié, au sens fort du terme, au génocide du Rwanda, indissociablement, comme s’il en était le porte-parole.
Il y a donc une part biographique plus importante qu’on ne croit dans la pratique de l’interview – à condition qu’on ne fasse pas cela occasionnellement.

NF : Vous nous faites comprendre ici une idée de l’interview. Mais au théâtre, où généralement on raconte une histoire, comment fait-on pour raconter une idée ?
N.T. : Donner corps aux idées et faire du théâtre avec des idées, c’est bien tout l’enjeu. Il n’est pas nécessaire, pour cela, de raconter des histoires, au sens de nouer une intrigue, de faire agir et parler des personnages, comme on peut l’attendre d’une pièce en général.
Dans le Projet Luciole, on partait d’une lettre de jeunesse de Pasolini. Dans cette lettre, il évoque la beauté des lucioles. Elles symbolisent le désir, la ruralité, la résistance aussi, face aux lumières aveuglantes du fascisme triomphant, à l’époque, en 1941. 34 ans plus tard, en 1975, alors qu’il est devenu le poète et le cinéaste qu’on connaît, il écrit un texte dans le Corriere della serra qu’on appelle « l’article des lucioles », où il dit : c’est terminé, les lucioles sont parties de la nuit italienne, c’est fini. Notre mouvement dramaturgique, dans cette pièce, consiste alors à traverser toute la pensée contemporaine, qui juge précisément que les lucioles se sont éteintes, avec « la merdonité de la modernité », comme dit Leiris. On traverse la pensée catastrophiste, pessimiste, et puis petit à petit on remonte. Judith et Nicolas le font comme un couple.
Pour Interview, c’est la même chose, il y a un chemin plutôt qu’une intrigue. Effectivement, je fais partie de ceux qui pensent qu’on peut faire du théâtre avec des idées. C’est un peu mon défi. Pour le mettre en œuvre, il faut figurer une narration sans intrigue, c’est tout à fait possible. Des comédiens se lancent sur la scène comme ils se lanceraient dans un interview. Plusieurs questions jalonnent l’itinéraire de leur aventure (« Êtes-vous heureux ? », « Quel est votre nous ? » etc.). Ils s’adressent aux anthropologues, puis aux reporters, puis aux documentaristes.
NF : Y a-t-il une progression vers la vérité ? S’agit-il d’une quête initiatique ?
N.T. : Il y a une progression, c’est sûr. L’idée c’est qu’on avance. Dans un premier temps, les comédiens vivent en parallèle le risque de la scène et le risque de l’entretien, un « beau danger », un risque amusant, non pas terrifiant, mais un risque tout de même. Il y a un beau danger de l’entretien, comme dit Michel Foucault, on ne sait pas où on va aller et c’est exactement là qu’en sont les comédiens. Donc il y a ce prologue.
Après il y a Chronique d’un été. On les voit jouer et rejouer des rushs de Chronique d’un été, et remettre ça au présent. La parole des années 60, dans ce film, nous paraît très belle parce qu’elle représente un « Âge d’or » – mais comment fait-on pour faire revenir ça aujourd’hui ? se demandent les comédiens.
On va voir Edgar Morin, comment on fait le duende, etc. Quelle serait la question aujourd’hui : « Quel est votre « nous » ? » Puis une ponctuation, une petite bande sonore, qui figure l’état du « nous » aujourd’hui, un « nous » un peu fracturé…
Alors aujourd’hui quand on est journaliste, en effet, pour bien faire, on est reporter. C’est là que se pratique le sport de « faire parler les gens ». Pour Florence Aubenas, on donne quelque chose de soi, pour Hazfeld il faut se laisser entrer précisément dans l’histoire…
Et puis ensuite, retour à des questions, les questions de Max Frisch. Et l’on arrive à ce moment particulier qui est comme « le fantôme du spectacle ». Arrivent, un peu comme dans un rêve, ces interviews un peu « mainstream » qu’on connaît tous (Pivot, ou d’autres). Ils arrivent comme les fantômes de ces entretiens qu’on ne nomme jamais dans le spectacle, car ils sont omniprésents (quand on dit interview, on pense d’abord à Pivot-Duras, Ardisson-je-ne-sais-qui, plutôt qu’à Jean Rouch ou à Raymond Depardon). Ainsi, ces interviews « mainstream » s’invitent dans le spectacle, mais de façon caricaturale et onirique.
Et la leçon de ces entretiens-là, c’est que ce qui compte, ce n’est pas ce qui se dit, c’est les rapports, c’est un certain jeu.
Puis, après l’interview de Vincent Lindon, le charme se brise. Et l’on revient à quelque chose qui avance encore. Au terme de cette Odyssée, on va vers le silence, la disparition même de la question, la disparition même de l’intervieweur au profit d’un art de la patience, d’un art de l’attente. C’est Nougaret et Depardon qui expliquent : « on attendait une minute, deux minutes, trois minutes, quatre minutes ! »
Ils cherchent la pépite, tous. Edgar Morin recherche le moment de duende. Florence Aubenas recherche le moment où la personne va tout dire, même si c’est seulement au moment de la question « à la Columbo », la dernière, là où il n’y a plus de carnet, quand il n’y a plus rien, et que tout sort de manière magnifique. Jean Hatzfeld cherche la vérité des âmes.

NF : Est-ce que d’autres modèles narratifs étaient possibles (roman policier, comédie à mariage…) ?
N.T. : Tout est possible. Ce qui me plaît en faisant du théâtre avec des idées, c’est qu’il y a tout à inventer.
NF : Projet luciole était déjà de l’ordre d’une quête initiatique – il y a quand même chez vous un goût pour cette structure-là.
N.T. : Effectivement, la traversée, la quête de quelque chose, c’est ce qui reste des Lucioles dans Interview. On partait d’une question : mais pourquoi Pasolini s’est-il trompé ? Des lumières il n’y en a peut-être plus beaucoup mais elles sont encore là. Donc comment va-t-on les chercher, les trouver ? Pour Interview, c’est semblable : comment la parole est-elle encore possible ? Se parler vraiment, c’est encore possible, mais il faut peut-être aller très loin, il faut peut-être disparaître totalement. C’est peut-être le silence qui fait advenir la parole, plutôt que la parole elle-même, parole mise en scène par l’interviewé et l’intervieweur.
NF : Je verrais aussi, chez Nougaret et Depardon, dans la mesure où vous les placez à la fin du spectacle, le lieu commun de toute quête initiatique, à savoir : ce que l’on va chercher très loin est déjà là, mais il faut faire un long chemin pour s’en apercevoir.
N.T. : Oui, c’est très simple, il suffit de prier deux passants en conversation de continuer leur dialogue dans une caravane et de les filmer. Mais on sait que c’est éminemment délicat, en réalité, car cela repose sur la sympathie, l’empathie. Sur la faculté d’obtenir que les gens viennent là. Ce n’est pas si simple de faire venir des gens dans une caravane, de les filmer, pour qu’ils disent des choses aussi simples sur leur vie, des choses aussi belles, comme ça. C’est un long travail, une longue pratique. Et c’est le résultat d’une vie entière.

Raymond Depardon et Claudine Nougaret sur le tournage de leur film documentaire Les Habitants.
NF: Avez-vous recherché une gestuelle particulière à l’imitation des interviews ?
N.T. : Il y a la mimique dubitative, les mains, les regards, les gestes du quotidien. Il y a la fausse sortie de Florence Aubenas, et la pose des intervieweurs "mainstream".
Sur le jeu de ces interviews, ce qui comptait plus que tout, c’est comment les corps se tiennent. Comment Pivot, par exemple, joue beaucoup sur le ton, ce ton bâcleur.
Ce qui compte aussi, c’est la position du corps. Le journaliste du Spiegel qui se tourne vers Heidegger, qui vient le chercher, qui se met presque à genou. Il y a effectivement une gestuelle de l’interview, c’est très physique.
On peut traduire une situation par quelqu’un qui se tiendrait très penché en arrière, sur la défensive, et se sentirait attaqué parce que l’interview ressemble à un interrogatoire de police, ou bien représenter, au contraire, une forme de drague, une interview séductrice.
NF : Le théâtre, au fond, est-il un moyen de connaissance archaïque, qui donne à savoir par le moyen de cette fameuse mimesis qu’on confie aux comédiens ?
N.T : Oui, il y a un effet de révélation par la mise en espace sur le plateau. Quand vous vous retrouvez avec une interview, que vous la visionnez, puis que vous la décryptez, dont ensuite vous n’avez plus que le texte, et que vous vous mettez à la jouer, c’est très étonnant, parce que ce qui surgit n’est pas exactement ce que vous avez vu.
L'acculturation au plateau d'un interview radiophonique ou écrit a un effet de révélation. On voit surgir, par exemple, l’obscénité de Bernard Pivot vis à vis de Marguerite Duras, au sujet de l'alcoolisme de cette dernière. On voit aussi le consentement de Duras à jouer ce jeu-là. Et quand Pivot lui demande si elle est prête à tout, elle répond « Oui, puisque je suis là. ». Bien sûr que je suis prête à tout, vous le voyez bien, puisque je suis là, en train de faire le singe à la télévision, puisque vous êtes là devant moi, à me faire parler de l’alcool, du vin rouge et j’en passe.
NF: Généralement, dans une quête initiatique, le héros rencontre des alliés et des ennemis. L'intervieweur a-t-il des ennemis ?
N.T : Non, je dirais qu’il a des faux amis, simplement. Il n’y a pas à juger. Ce n'est pas ce qui m'intéresse. S'il y a donc des faux amis, c'est tout ce qui, du côté de l'intervieweur, de l'interviewé et de l'interview, empêche la parole d’arriver. La parole est alors cadrée, formatée etc. Il y a des émissions où rien ne peut arriver, sinon des petits scandales qui vont faire le buzz. Voilà de faux amis de l'interview.
La brieveté n'est pas un faux ami. Nous pensons que c’est le temps long qui favorise la parole, mais parfois il y a des choses qui arrivent comme ça. J’ai le souvenir de Gérard Filoche, sur LCI, qui est là juste au moment de l’affaire Cahuzac, interviewé sur un plateau -- et qui se met à pleurer. C’est le militant, socialiste depuis des années, qui a une énorme boule dans la gorge, qui dit "c’est toute ma vie", et qui est submergé par l'indignation, par le dégoût, la déception. Il n’y a pas eu deux heures d’interview pour le mettre en confiance et l'amener là .
Donc il y a bien des faux amis, mais je ne peux pas dire que l’ennemi c’est la télévision, que l’ennemi c’est la brieveté etc. Je dis simplement que l'avénement d'une parole authentique est de plus en plus rare. Et c’est pourquoi on reste bienveillant, on ne pointe personne du doigt. Ces faux amis, d'ailleurs, on n’a pas besoin de les jouer, car on les entend en creux. Quand on entend Florence Aubenas parler de la façon dont elle interviewe, toutes les autres façons, on les a à l'esprit, on les connaît, car on les entend tous les matins.
NF: Ce récit initiatique a aussi la dimension d'un road movie. En quoi ces lieux que vous faites surgir à l’imagination du spectateur peuvent-ils compléter la bonne compréhension de ce que c’est qu’une interview ?
N.T : Effectivement, j’ai vraiment pensé le spectacle comme un road movie, une sorte de quête et de voyage. Il y a la rue, la salle à manger, une boîte de nuit, la porte d’un pavillon de banlieue, la machine à café, un « quelque part au Rwanda », un plateau de télévision, un studio radiophonique, un commissariat de police, une caravane transformée en studio, etc. Ce sont les lieux de l'exercice.
Ces lieux ne sont pas symboliques de l’interview.
Par exemple je voulais choisir Svetlana Alexievitch , que j’avais déjà interviewée, mais que je n’ai pas pu réinterviewer pour le spectacle. Si cela avait été, on serait allé à Tchernobyl. Là, avec Jean Hatzfeld, on va en Serbie, au Rwanda. Les lieux, en eux-mêmes, n’ont donc pas de signification symbolique.
En revanche, ces lieux sont importants pour figurer que l’interview est un voyage. Ça fait voyager, mais c’est aussi un voyage.

NF: Comment avez-vous traité le temps de l’interview ?
N.T.: Le temps de l’interview épouse la durée du spectacle. Encore une fois, la durée du spectacle se développe en tension vers sa fin, où il arrive que les gens pourraient venir sur les chaises, et parler. Créer (même en fiction dramaturgique), minute après minute, le climat et la confiance entre les comédiens et la salle, pour que le public se mette à parler, à la fin, telle est la configuration temporelle.
NF: Il y a donc une unité de temps, au sens de la règle des trois unités. Ici c'est le temps réel de la représentation. Et il y a une unité de lieu d’une certaine manière, qui est inscrite sur ce plateau où évoluent les comédiens, où ils font advenir une série de lieux imaginaires sans pour autant qu’on quitte jamais ce lieu réel où ils évoluent.
Il se trouve qu'entre la création du spectacle en Avignon l'été dernier, et sa recréation aujourd'hui au Rond-Point, vous l'avez aussi recentré sur son unité d'action.
N.T. : En effet, dans la version 1, il y avait deux thèmes : 1/ l’interview 2/ notre questionnement actuel. On allait de « quel est notre nous ? » à « que sentons-nous venir ? ». Le second thème amenaient les comédiens à jouer l'ultime entretien de Pasolini, et un entretien avec l'historien Patrick Boucheron , au sujet de la fameuse fresque de Sienne "du bon et du mauvais gouvernement".
Dans la version 2, le spectacle s’est reserré et recentré sur le thème de l’interview, et Depardon a remplacé Pasolini.
NF: Pourquoi cette nouvelle version?
N.T. : Je me suis aperçu qu’on parlait encore mieux de la situation présente à travers ce chemin autour de l’interview, plutôt que d'en parler explicitement, en jouant Pasolini. Dans la première version, on travaillait la situation de l’entretien, puis, à partir de Pasolini, on faisait un grand entretien sur la situation présente. Je me suis aperçu que c’était beaucoup plus cohérent de continuer cette quête et que nos préoccupations actuelles apparaissent à travers la situation dans laquelle les intervieweurs font parler les gens. Donc toute la situation contemporaine, on l’a quand même, sans faire cette plongée pasolinienne, où finalement on écartait les spectateurs de notre premier sujet, contrairement à ce qu’on avait commencé avec eux, à savoir un rapprochement -- on les avait mis au travail avec nous, pourquoi ne pas s'y tenir?
NF: Avez-vous ressenti la nécessité de vous plier à cette règle de l’unité d’action ?
N.T.: C’est sûr. Et ça ne s’est pas fait tout seul. J’ai voulu recommencer et changer pour continuer sur l’axe qui est le meilleur. Et je dois un grand coup de chapeau à la MC 93 qui a produit le spectacle. À Avignon, en effet, le spectacle a plu au public, il a été acheté, il tourne. J’ai demandé à ce qu’on puisse retravailler au Rond-Point, pour refaire ce que vous avez vu. C’est vraiment rare. Hortense Archambaud, qui dirige la MC93, a compris que je pouvais trouver une cohérence plus grande. Elle a accepté de me laisser le retravailler. Ce n’est pas évident, budgétairement parlant. Pourquoi refaire une pièce qui marche, a été achetée et qui tourne ? C’est tout à son honneur de productrice.
NF : Comment ça se passe une crise pareille ? A quel moment vous vous rendez compte que la règle n’est pas respectée, et que c'est un véritable dommage pour la pièce ?
N.T.: Pour le coup, c’est comme une révelation. On monte le spectacle, on travaille, puis Pasolini arrive et là, on ne peut pas s'empêcher de sentir qu'il y a "un loup". Personnellement, j’étais "en apnée". Je ne trouvais pas la meilleure façon de traiter ce passage avec Pasolini.
Puis j'ai mieux perçu que jusque là j'avais réuni les conditions d'un mouvement vers le spectateur. Que nous questionnions le public sans démagogie. Nous sentions le spectateur réactif à cette proposition. Et il se passait que tout à coup on le renvoyait à son siège. On le réassignait à une place parfaitement passive. Or, ce n’était pas du tout le principe du spectacle.
En me mettant à la place du spectateur, je voyais une action qui m'intéressait de plus en plus, et puis tout à coup le fil se coupait, et je me retrouvais à regarder une très belle interview qui me raconte des choses très intéressantes sur la situation présente, mais qui, au fond, ne correspond plus du tout à ce qui était en question. Quelque chose s'était rompu avant qu'on ait pu aller jusqu'au bout.
Or, aller au bout, c'était aller jusqu’à la disparition. Questionner la question, questionner le questionnement jusqu’à découvrir la disparition de la question.
Mais je ne pouvais m'en rendre compte que dans le travail concret. Je n’ai pas la science de la mise en scène que peut avoir Peter Brook ou un autre grand maître. J’ai besoin de voir. De faire et de voir. Je ne peux pas dire avant : ça ne va pas marcher. Il y a des gens qui ont une telle idée de la structure qu’ils ont presque la vision complète et précise de ce qui doit se passer sur la scène. Moi non.

NF : Ne fallait-il pas cependant prendre le risque de laisser s’exprimer votre désir de parler de ce qui nous menace?
N.T.: Mais, précisément, c'était la meilleure façon de servir ce désir ! Il était plus efficace d’en parler indirectement. Dans l’économie du spectacle, on l'entend, cette France qui souffre, on entend ce qu’on fait aux gens à travers la parole, ce qu’on leur fait à travers la politique, etc.
Il y a une politique de la parole. La parole est l'objet d'un enjeu démocratique. Avec ce spectacle, le surgissement de la parole s'appuie sur un univers poétique, l'univers de l'art théâtral. Ma démarche est esthétique, mais aussi politique, pleinement.
Interviewer les gens ordinaires, comme le font Nougaret et Depardon, interviewer les gens dans les asiles psychiatriques ou dans les tribunaux avec les mêmes moyens que ceux qu'on prend pour interviewer Isabelle Adjani ou Vincent Lindon, c'est aussi un geste politique, lié à l'enjeu démocratique. Filmer avec six micros et trois caméras comme on filmerait Catherine Deneuve dans une grande production, c'est un certain rapport aux gens et aux choses qui se dit à travers ça.
La démocratie, selon Jacques Rancière, c’est « le pouvoir de n’importe qui ». N’importe qui ou presque peut poser une question, peut mener une interview. Il n’y a pas besoin d’avoir une carte de presse. C’est démocratique parce que ça met les gens à égalité. (Bien sûr, l’interview du maître, ça existe, l'interview payé par le maître lui-même, où il n’y a pas de relance, ou il n’y a rien.)
Que l'intervieweur soit capable d’être le passeur entre un grand intellectuel, un grand savant, de lui poser des questions simples qui vont permettre au public de comprendre quelque chose de compliqué, comme la théorie de la relativité ou autre, voilà qui est aussi démocratique.
Toutes proportions gardées, l'interview a quelque chose à voir avec les Lumières, avec l’effort d’élargir le champ de la connaissance, comme l’a initié Diderot avec l’Encyclopédie. Une interview qui permet de mieux comprendre la relativité d'Einstein, ou la peinture de Cézanne, ou la vie et le théâtre de Molière, c'est précieux. La politique n’est pas réservée aux politiciens, les sciences ne sont pas réservées aux scientifiques, l’art n’est pas réservé aux artistes, et l’interview, si les conditions sont réunies permettent d'ouvrir ces domaines à tous.
Il faut donc défendre ce que l’interview peut permettre, le défendre contre le communicationel, contre l’autorité despotique, contre l’ignorance.
Diderot
NF : Au théâtre, faut-il plaire ou inquiéter ?
N.T.: Il faut inquéter pour plaire. Il faut dérouter pour plaire. Le théâtre a à voir avec la philosophie par la pratique du détour. Nicolas et Judith sont là au début sur la scène, c’est inquiétant, légèrement : que vont-ils faire ? En fait, il n’y a pas de dichotomie entre plaire et inquiéter. Si on cherche trop à plaire, on va aller dans le sens du poil, on ne va rien mettre en jeu, on ne va prendre aucun risque et il ne va rien se passer. J’espère avoir montré dans cette pièce qu’il peut y avoir des choses plaisantes, mais surtout qu’il peut y avoir « un beau danger », quelque chose de plaisant à suivre et à regarder, avec quelques frissons. Personne n’est obligé d’être contre, ni d’inquiéter, ni de déplaire pour amener quelque chose d'authentique.
Je sais que certains pensent qu’il faut inquiéter, voire prendre le public à rebrousse-poil pour créer un effet. Mon opinion est qu’on peut emmener les gens très loin, si notre proposition relève aussi du plaisir.
Dans mon premier spectacle, j’ai apporté des textes de philosophie critique, de Théodor Adorno, de Walter Benjamin, qui, au théâtre, ne sont pas si simples à mettre en espace. Faire comprendre qu’il y a une sorte de plaisir dans la difficulté à suivre et à s’enfoncer dans un discours philosophique, c'est dépasser le caractère inquiétant de ces textes.
Je prends donc cet outil-là, la capacité de ces comédiens formidables à créer une relation entre eux et avec le public, pour essayer d'emmener les gens très loin. Ils pourraient nous emmener plus loin encore, dans des thèmes très compliqués et très lourds, parce que ça passe par une forme de plaisir.
L'inquiétante étrangeté, génératrice d'une certaine angoisse chez Freud, pique pourtant la curiosité de l'interprète psychanalyste, qui la convertit en délicieuse étrangeté ! Il y a quelque chose de "l’ailleurs", qui recèle une grande puissance esthétique.
Je pense donc qu'on ne doit pas opposer le plaisir et l'inquiétude. Comme si le plaisir était forcément du côté de l’ignorance, comme s’il était forcément "putassier", non. Et comme si l’austérité, voire même la dureté, la frontalité avec le public, au sens où on lui fait subir une sorte d'agression esthétique, était du côté de l’art. Je n’y crois pas du tout.
Je me situe du côté du plaisir, de la joie, en m'appuyant sur une grande tradition : Mozart, Nietzsche, Spinoza, plus qu’un certain Sturm und Drang.
A voir prochainement :
- 16 au 18 mars 2017 La Criée, théâtre national de Marseille
- 22 au 24 mars Sortie Ouest, théâtre de Béziers
- 6 au 14 avril MC2, Grenoble
- 3 mai L'Agora, Boulazac
- 5 mai Le Liburnia, Libourne
- 9 mai théâtre des quatre saisons, Draguignan
- 12 et 13 mai théâtre liberté, Toulon
- 20 mai la comédie de Reims
- 23 et 24 mai le quai CDN, Angers
- 29 mais au 17 juin le Montfort, Paris
A lire également sur nonfiction.fr :
Sommaire de la rubrique théâtre
