Les États-Unis s’apprêtent à élire leur prochain(e) président(e). Deux fois par mois, cet horizon sera l’occasion d’explorer, avec Pascal Mbongo, un pays dont les contrastes et les mutations ne lassent pas d'en agacer certains et d'en fasciner d'autres – parfois les mêmes.
Cette quatrième livraison de la série est consacrée à la Cour suprême. Le décès du juge Antonin Scalia a été internationalement commenté. Parce que cette disparition est intervenue en pleine campagne électorale en vue de l’élection en novembre 2016 du président des États-Unis. Parce que la désignation de son successeur était supposée permettre à Barack Obama de nommer un juge plus à gauche et modifier ainsi la majorité politique de la Cour suprême. Il reste que le juge Antonin Scalia n’a pas seulement été la figure de proue du conservatisme judiciaire aux États-Unis mais également le symptôme d’une forme de « politisation » de la Cour suprême qui n’était pas la « bonne » politisation imaginée par les Pères fondateurs de la République américaine.
La Cour suprême des États-Unis est une institution paradoxale car son importance dans la vie politique, économique, sociale et juridique américaine ne ressort pas de la Constitution elle-même, qui ne dit pas grand-chose à propos de la Cour. Aussi surprenant que cela puisse paraître, ce sont de simples lois fédérales susceptibles d’être modifiées par le Congrès qui prévoient que la Cour suprême compte neuf juges, que ces juges sont nommés à vie. C’est néanmoins la Constitution des États-Unis elle-même qui, en faisant de la Cour un acteur de la séparation des pouvoirs, l’a disposée à être la puissance politique qu’elle est devenue.
Puissance de la Cour suprême
C’est à deux points de vue que la Cour suprême est un « marqueur » de la séparation des pouvoirs en Amérique.
Les premiers mots des articles Ier, II et III de la Constitution se répondent en quelque sorte. L’article Ier désigne la mission du « pouvoir législatif ». L’article II désigne la mission du « pouvoir exécutif ». L’article III désigne pour sa part un « pouvoir judiciaire ». On a ici la séparation des pouvoirs dans son sens américain « le plus élémentaire » : le Président est investi de la mission d’exécution de la loi fédérale, le Congrès est investi de la mission de fabrication de cette loi et la Cour suprême est chargée de la « juger ». Consécutivement, la Cour suprême dispose de ses propres ressources humaines et matérielles, de la même manière que le Congrès et le président des États-Unis.
En deuxième lieu, la Cour suprême est un acteur du système des « freins et contrepoids » américain (Checks and Balances) qui consiste, selon l’expression du politiste Richard Neustadt, à « séparer des institutions tout en partageant leurs pouvoirs respectifs ». C’est dans cette mesure que le président peut opposer son veto à une loi adoptée par le Congrès, que le Congrès doit valider de nombreuses nominations de fonctionnaires ou de juges fédéraux décidées par le président, que le même Congrès peut révoquer (Impeachment) le président et de nombreux autres membres du pouvoir exécutif, et que la Cour suprême peut statuer sur la conformité au droit des décisions du Congrès ou du Président. Aussi faut-il toujours se pincer à la lecture des ouvrages de droit constitutionnel de langue française qui, contre toute évidence, professent que la Constitution américaine organise un régime de « séparation stricte des pouvoirs ».
L’inscription de la Cour suprême dans la séparation des pouvoirs telle qu’imaginée par les Pères fondateurs de la République américaine a précisément été l’un des facteurs de transformation de la Cour en cet interprète ultime de la Constitution américaine qu’elle est devenue, spécialement avec son arrêt Marbury v. Madison rendu 1803. La Cour y décide qu’à l’occasion des litiges dont elle serait saisie et relatifs à l’application de lois fédérales, elle se permettrait également de statuer sur la constitutionnalité de ces lois. Or, afin de s’attribuer à elle-même ce pouvoir qui n’était prévu par aucun texte, la Cour suprême fit valoir que cette solution lui était recommandée par la nécessité de donner un caractère effectif à la supériorité de la Constitution sur les lois fédérales, à la séparation des pouvoirs prévue par la Constitution, aux droits garantis par les dix premiers Amendements adoptés en 1791 (Bill of rights). Si la Cour suprême ne pouvait contrôler la conformité à la Constitution des lois fédérales, argumenta le président de la Cour John Marshall, alors cela voudrait dire qu’il n’y aurait personne pour garantir que le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif agissent dans le respect de la Constitution, que le pouvoir exécutif ou le pouvoir législatif n’empiètent pas sur les missions et les pouvoirs de l’autre, que le pouvoir exécutif ou le pouvoir législatif ne violent pas les droits fondamentaux garantis aux citoyens par la Constitution.
Deux siècles après l’arrêt Marbury v. Madison, le raisonnement du juge Marshall produit pleinement ses effets puisque la plupart des décisions du pouvoir exécutif fédéral, du pouvoir législatif fédéral, des juridictions fédérales, des pouvoirs exécutifs, législatifs ou judiciaires des États, peuvent arriver devant elle et se prêter à un examen de leur conformité à la Constitution fédérale. À cette aune, c’est une querelle un peu scolastique que de savoir si la Cour suprême est ou non une « Cour constitutionnelle ». Elle l’est dans l’un des sens susceptibles d’être donnés à cette expression, soit la juridiction dont les interprétations de la Constitution de l’État s’imposent à toutes les autorités politiques, administratives et judiciaires, peu important les conditions dans lesquelles cette juridiction est amenée à produire ces interprétations. De la même manière, c’est une controverse un peu picrocholine que de savoir si le Conseil constitutionnel français est une « Cour suprême ». Il l’est dans l’un des sens susceptibles d’être donnés à cette expression, soit la juridiction… dont les interprétations de la Constitution de l’état s’imposent à toutes les autorités politiques, administratives et judiciaires, peu important les conditions dans lesquelles cette juridiction est amenée à produire ces interprétations.
Politisations de la Cour suprême
Le décès du juge Antonin Scalia a été l’occasion de beaucoup de commentaires sur la « politisation » de la Cour suprême. En réalité, il convient de distinguer trois « politisations » de la Cour, celles qui sont constitutives de la Cour et celle qui est perçue de nos jours comme étant « pathologique ».
La première « politisation » est inhérente à la séparation des pouvoirs à l’américaine. En effet, ce principe a, théoriquement, une fonction de modération des différents acteurs politiques. Ainsi, plutôt que de choisir un juge « de gauche » (liberal) comme successeur désigné du juge « de droite » (conservative) Antonin Scalia à la Cour suprême, le président Barack Obama a choisi le juge Merrick Garland, soit un juge présidant la plus prestigieuse juridiction fédérale après la Cour suprême, un juge qui a été procureur fédéral et qui peut donc être perçu « à droite » comme n’étant pas « laxiste » et pas « anti-police », un juge dont la désignation à des fonctions judiciaires antérieures avait recueilli des votes Républicains au Sénat, un juge « centriste ».
Le président tient ainsi compte de la sensibilité politique dominante au Sénat tout en essayant par ailleurs de contraindre le même Sénat à se satisfaire d’un choix « centriste » plutôt que « de droite ». Cela peut marcher. Cela peut aussi ne pas marcher car un certain nombre d’élus Républicains ont en travers de la gorge ce qu’ils appellent la « trahison » du président actuel de la Cour suprême, John Roberts, et sa voix majoritaire en faveur de la constitutionnalité de la réforme de Barack Obama sur l’assurance-maladie. Dans leur esprit, si le président John Roberts a ajouté sa voix, et même plus d’une fois, à celle de « la gauche » de la Cour alors qu’il était supposé être « de droite », qu’est-ce qui dit que le juge Garland ne se révèlerait pas à la Cour « de gauche » plutôt que « centriste » ?
La deuxième « politisation » est inhérente au contrôle de la constitutionnalité des lois. Aux États-Unis, comme en France, en Belgique, en Allemagne, etc., les juges doivent décider à partir d’un texte, la Constitution, qui comprend des non-dits et des clairs-obscurs et qui a été rédigé à une époque plus ou moins lointaine et sans considération des questions nouvellement posées aux juges. Comment faire face à ces cas ou à ces revendications de droits qui ne sont pas prévus par la Constitution ? Antonin Scalia doit une partie de sa médiatisation à sa réponse. Il faut rechercher l’intention des auteurs de la Constitution (original intent), disait-il en substance, car ne pas s’en tenir à cette intention des Pères fondateurs est une manière pour les juges de réécrire la Constitution et d’usurper le pouvoir du peuple.
Cette réponse, qu’il est convenu d’appeler l’originalisme et dont il n’est pas à proprement parler l’inventeur, a été plus d’une fois « déconstruite ». Et elle est en concurrence avec différentes autres théories de l’interprétation constitutionnelle. L’on notera au passage que si les livres d’Antonin Scalia n’ont guère été traduits en France, et qu’il n’y enthousiasme guère les juristes de droit public, c’est pour deux raisons. D’une part, la vision qu’avait Antonin Scalia de l’interprétation juridique apparaît comme une régression intellectuelle par rapport à Kelsen et à son idée implicite selon laquelle le pouvoir juridique appartient à l’interprète d’un texte et non à son auteur. D’autre part, la « théorie juridique » d’Antonin Scalia n’est pas accordable à la philosophie de l’intérêt général et du service public que le droit public européen a mis près d’un demi-siècle à construire. Chez Antonin Scalia, l’originalisme est l’habillage formel d’un idéal politique, celui de l’auto-organisation de la société. Comme chez Friedrich Hayek lorsqu’il critiquait les idéaux européens d’intérêt général et de service public (notamment dans Droit, Législation et liberté et dans La Constitution de la liberté). Comme, plus prosaïquement, chez les partisans du Tea Party, dont l’anti-étatisme a quelque chose d’extravagant, même pour un Européen de « droite ».
À y regarder de plus près, ce n’est pas seulement sa « théorie » qui a rendu le juge Scalia médiatique, mais trois autres choses. Il y avait, en premier lieu, le fait que le juge Antonin Scalia avait le mot d’esprit facile et invoquait régulièrement le « bon sens ». Toutes choses qui, en réalité, avaient fini par perdre de leur charme. Ainsi, dans une tribune remarquée parue le 14 juillet 2015 dans le Los Angeles Times, le célèbre professeur de droit constitutionnel, Erwin Chemerinsky, n’y est pas allé par quatre chemins pour dire qu’il trouvait Antonin Scalia médiocrement péremptoire et suffisant. La médiatisation du juge Scalia devait encore au fait qu’il a semblé offrir aux plus conservateurs des Américains une « théorie juridique » susceptible de justifier le rejet par la Cour suprême de certaines évolutions « sociétales » portées par les « progressistes ». Enfin, la « théorie juridique » d’Antonin Scalia s’accordait au culte, plus contemporain qu’on ne le croit, dont les Pères fondateurs font l’objet. À sa manière, l’originalisme déifie les Pères fondateurs.
La troisième « politisation » de la Cour suprême, celle qui est « pathologique » ou distante de la pensée des hommes de 1787, découle de l’articulation de la vie politique des démocraties, depuis la fin du dix-neuvième siècle, par des partis politiques stables, professionnalisés et revendiquant le monopole de la production des idéaux politiques et sociaux. Loin de l’univers mental et politique des Pères fondateurs de la République américaine. Au début du XXe siècle encore, la compréhension des arrêts de la Cour suprême n’est pas réductible à la bipolarisation partisane de la deuxième moitié du siècle. L’arrêt Brown v. Board of Education of Topeka par lequel la Cour met fin à la ségrégation raciale n’est pas le seul fait de juges « de gauche ». L’arrêt Roe v. Wade de 1973 sur le droit à l’avortement n’est pas non plus le seul fait de juges « de gauche », et le gouverneur Républicain de la Californie, Ronald Reagan, pouvait alors être favorable à l’avortement ou à la reconnaissance des droits des homosexuels.
Conclusion
1. Le succès médiatique et/ou populaire du juge Antonin Scalia a été à la fois l’expression et la conséquence de ce qu’est devenu le champ politique et partisan américain, avec ses « guerres culturelles », avec cette part « paranoïde » rapportée par Richard Hofstadter.
2. La « politisation » de la Cour suprême n’a cessé d’être perçue avantageusement que depuis l’avènement de ce que Bernard Manin appelle la « démocratie des partis » et la « démocratie du public », soit deux formes démocratiques pas toujours accordées à l’idéal de modération des Pères fondateurs.
À lire également sur nonfiction.fr :
Tous les articles des Chroniques américaines
Sélection bibliographique :

![]() Le style paranoïaque : Théories du complot et droite radicale en Amérique
Le style paranoïaque : Théories du complot et droite radicale en Amérique
Richard Hofstadter
François Bourin éditeur, 2012.
 Le juge et le philosophe. Essais sur le nouvel âge du droit
Le juge et le philosophe. Essais sur le nouvel âge du droit
Philippe Raynaud
Armand Colin, 2008.
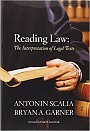 Reading Law: The Interpretation of Legal Texts
Reading Law: The Interpretation of Legal Texts
Antonin Scalia et Bryan A. Garner
West, 2012
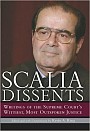 Scalia Dissents: Writings of the Supreme Court's Wittiest, Most Outspoken Justice
Scalia Dissents: Writings of the Supreme Court's Wittiest, Most Outspoken Justice
Antonin Scalia & Kevin A. Ring
Regnery Publishing, 2012.
