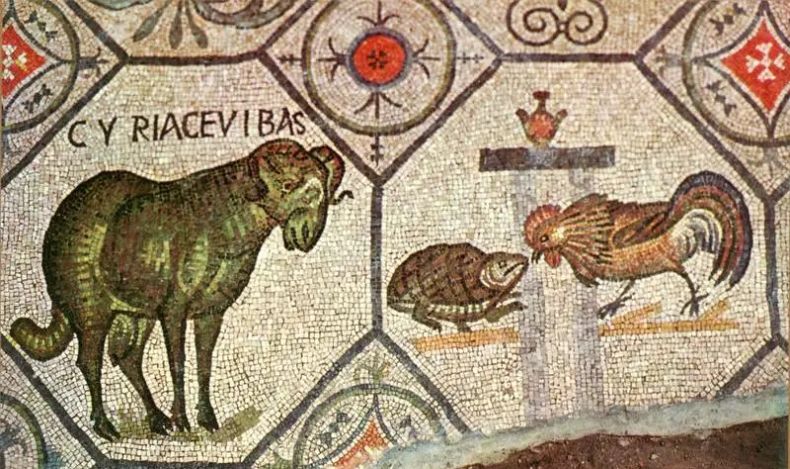La Gnose, mouvement religieux de l'Antiquité, est-elle une clé de compréhension du christianisme ?
Les premiers siècles de notre ère, dans le bassin méditerranéen, ont été le théâtre de l’éclosion de dynamiques religieuses autant variées que fécondes. Cela invite l’historien des religions à porter un regard attentif sur cette période et notamment sur la naissance de la philosophie chrétienne. C’est précisément dans ce bouillonnement d’idées propre aux Ier et IIe siècles de notre ère, au cœur de la matrice proto-chrétienne, que viennent émerger les premiers linéaments de ce que l’on appelle la Gnose, autrement dit une voie d’accès menant certains élus au salut divin par l’entremise de la connaissance.
La Gnose, traditionnellement répertoriée parmi les hérésies, a fait l’objet de nombreux débats, notamment depuis le XIXe siècle. Les hypothèses d’une origine « orientale et préchrétienne » du gnosticisme incarnées par l’« École de l’histoire des religions » (et notamment Bultmann) se sont amplement développées à la fin du XIXe et au début du XXe siècle. Walter Bauer soulignera par la suite la dimension authentiquement chrétienne d’un gnosticisme déclaré dissident a posteriori avant que Hans Jonas n’inscrive le gnosticisme dans l’horizon de la philosophie.
Mais c’est véritablement la découverte de Nag Hammadi, un ensemble de douze codex de papyrus découverts en 1945 sur un site égyptien (les plus connus étant l’Évangile de Judas et l’Évangile de Thomas), et de ses manuscrits d’inspiration gnostique pour la plupart qui va orienter de manière décisive la recherche. Elle éclaire en effet d’un jour nouveau le christianisme primitif et permet de dégager quelques caractéristiques de la Gnose , sans pour autant résoudre l’épineuse question des origines.
C’est précisément dans ce cadre épistémologique complexe voire aporétique que vient s’inscrire l’ouvrage d’André Paul (spécialiste reconnu des Manuscrits de la mer Morte et du judaïsme ancien), intitulé La Gnose antique. De l’archéologie du christianisme à l’institution du judaïsme. L’auteur s’y propose de questionner à nouveaux frais la naissance et peut-être la nature même de la Gnose.
L’ambivalence des rapports du christianisme primitif avec la Gnose
La réflexion s’ouvre sur la présentation des sources de ce que l’historien nomme la Gnose antique et non le gnosticisme (terme tardif apparu seulement dans la seconde moitié du XVIIe siècle en Angleterre). Il relève que Platon fut le premier à mettre en valeur, dans Le Politique, le terme gnôsis (« connaissance »), pour « désigner et magnifier les qualités requises de l’homme politique » , comprenons la façon dont la raison peut permettre d’atteindre la vraie « connaissance ». Les premiers témoins directs de la Gnose antique apparaissent dans certains textes néotestamentaires et écrits chrétiens des IIe-IIIe siècles, conduisant à féconder la philosophie chrétienne. Clément d’Alexandrie (fin du IIe siècle) sera ainsi l’un des premiers, dans les Stromates, à valoriser fortement le terme gnostikos pour désigner l’homme parfait, à la ressemblance de Dieu. La Gnose participera aussi de l’essor du monachisme en Egypte au IVe siècle avec Pachôme ou Evagre le Pontique, lequel fait de la gnôsis l’idéal du moine. Et André Paul de souligner la place cardinale des gnostiques dans la communauté chrétienne d’Alexandrie, « berceau platonicien de la Gnose chrétienne » .
Cela dit, de manière quasi concomitante, vers la fin du IIe siècle de notre ère, sous l’impulsion décisive notamment d’Irénée de Lyon, la connotation du vocable gnôsis se charge d’une réelle tonalité péjorative référée à une connaissance dite mensongère (la fausse gnose). Son ouvrage essentiel, Dénonciation et réfutation de la fausse gnose, qui deviendra en latin Adversus Haereses (« Contre les hérésies »), explicite la pensée du Nouveau Testament, lequel met en lumière cette « fausse gnôsis » . L'auteur montre ainsi la manière dont le corpus johannique notamment infléchit le sens de la Gnose réservée traditionnellement à une poignée d’élus (les pneumatiques) pour l’élargir à l’ensemble des humains via la personne du Christ, opposant par là même la fausse gnose à la vraie connaissance.
L’Epître de Barnabé (considérée comme un apocryphe du Nouveau Testament), écrite au tout début du IIe siècle de notre ère, témoigne à elle seule de cette intégration de la gnôsis dans un système de valeurs protochrétien susceptible d’associer à la foi de chacun des hommes « la connaissance parfaite » : « J’ai réfléchi que si je prenais le soin de vous communiquer une partie de ce que j’ai reçu, avoir servi des esprits tels que les vôtres me vaudrait récompense. Je me suis donc empressé de vous envoyer ces quelques lignes, afin que vous ayez aussi, en plus de votre foi (méta tès pistéôs), la connaissance parfaite (téléia gnôsis) » (1, 5).
La naissance de l’Ekklèsia et le rejet de la Gnose
Si le proto-christianisme, à travers le corpus néotestamentaire notamment, développe de réelles tonalités gnostiques tout en opposant les notions de « fausse gnose » et de « vraie gnose », c’est véritablement la naissance de l’Ekklèsia — la Grande Église — dans les dernières décennies du IIe siècle qui relègue définitivement la Gnose dans le camp de l’hérésie. Il s’agit d’abord d’Irénée de Lyon qui le premier utilise le vocable gnostikos pour condamner des groupes ou des individus jugés hérétiques (notamment les Valentiniens). Tertullien, au IIe siècle, dans son Contre les Valentiniens ainsi que Hippolyte de Rome (IIe) dans sa Réfutation de toutes les hérésies, ou encore Epiphane de Salamine (IVe) dans son Panarion prolongeront la pensée d’Irénée en associant systématiquement la Gnose à l’hérésie. Ce qui se joue ici, on l’aura compris, c’est l’affirmation d’une identité chrétienne dans ses dimensions sociale, culturelle et cultuelle et qui ne saurait souffrir la moindre ambiguïté doctrinale. De ce point de vue, l’ambivalence présente dans certains écrits chrétiens primitifs concernant la Gnose (notamment la dichotomie entre un dieu transcendant et un démiurge créateur du cosmos et du mal) apparaissait comme un possible ferment déstabilisant et dangereux aux yeux de l’Ekklèsia.
Probablement condamnée en raison même de sa richesse et de sa complexité, la Gnose antique se présente pourtant comme un système à la fois « philosophique, anthropologique et cosmologique » . Envisagée comme un modèle dualiste lié à deux créateurs, la Gnose fait du monde une prison dont l’âme cherche à s’échapper. Mais seule une poignée d’élus possède l’étincelle divine susceptible, par l’effet de la gnôsis, de retourner à l’origine céleste. Reste que ce dualisme apparent, souvent considéré par les spécialistes comme le trait marquant de la Gnose, se trouve en partie contesté par l’auteur qui voit plutôt dans la Gnose antique « les résultats d’une réflexion profonde et affinée sur la présence du mal dans le monde » . De fait, nous sommes bien en présence d’une philosophie plutôt que d’une religion entendue dans un sens social et doctrinal. Seules importent pour la Gnose la voie du salut et la libération du cosmos et de la matière.
Malgré la dimension philosophique de la Gnose, André Paul montre également la façon dont l’orthodoxie chrétienne a pu écarter du canon certains livres dits apocryphes, au nombre desquels notamment l’éclairant Livre des secrets de Jean (un texte gnostique de la fin du IIe siècle). Il s’agit ni plus ni moins d’une « révélation » du Christ ressuscité à son disciple Jean, à laquelle se trouve associée la présence d’un agent créateur Yaldabaoth, divinité imparfaite. L’Évangile de Judas semble aller encore plus loin puisqu’il présente Judas comme un élu de Dieu qui s’est « vu lapidé et persécuté par les douze disciples. » Comprenons que le texte gnostique conteste ici le culte rendu au Dieu suprême et mis en avant par l’Ekklèsia. Il va jusqu’à considérer ladite trahison de Judas comme un acte libérateur et salvifique puisqu’il affranchit l’être spirituel de Jésus au détriment du cadre matériel et physique. Que l’Ekklèsia naissante ait considéré ce texte comme apocryphe ne peut surprendre tant on retrouve dans cet épisode certains accents du docétisme (cette vision christologique du christianisme primitif tendant à nier la réalité de l’Incarnation en prêtant seulement à Jésus-Christ une apparence humaine). Que l’on ne soit pas surpris non plus de trouver dans l’Apocalypse de Pierre (texte apocryphe chrétien rédigé en Egypte au début du IIe siècle) la mention suivante relative à la crucifixion : « celui qui souffre, c’est le corps substitut » . La doctrine de l’Incarnation et de la résurrection spirituelle et physique ne pouvait en effet trouver un écho favorable dans les textes dits gnostiques, tant le monde matériel est pour eux l’obstacle premier à toute libération spirituelle.
Les sources gréco-judaïques de la Gnose et du christianisme primitif
L’auteur utilise l'expression philosophia Christou pour désigner la philosophia qui vient remplacer celle d’Homère ou de Moïse (autrement dit la littérature au sens large) et qui a la particularité d’associer la foi à la connaissance ou philosophie. Celle-ci a cherché à écarter les idées gnostiques, dans la mesure où ces deux mouvements se trouvaient en concurrence dès le IIe siècle de notre ère puisque présents au cœur même du corpus néotestamentaire. Comment pouvaient-ils coexister ? André Paul s’emploie à sonder dans un chapitre déterminant le terrain commun d’ensemencement de la Gnose et de la philosophie chrétienne.
La première œuvre dont l’examen est requis est celle de Philon d’Alexandrie, exégète juif d’Alexandrie de la première moitié du Ier siècle de notre ère. Sa pensée, tant par sa puissance allégorisante que par son ample développement, dessine les contours d’un Dieu unique, au service duquel se trouvent deux figures essentielles : le Logos « Parole » et la Sophia « Sagesse » présentés chez Philon comme « père » et « mère » de tous les êtres créés. Tout se passe ici comme si ce Dieu assisté de divinités subalternes préfigurait la Gnose elle-même et sa double divinité. Comprenons que dans la constellation des œuvres qui éclosent aux alentours du Ier siècle de notre ère et qui dessinent les contours d’une théologie dite monothéiste — le terme est ici bien sûr anachronique — se rencontre un certain nombre de textes qui, s’ils affirment l’existence d’un Dieu unique et dominateur, ne renoncent pas pour autant à évoquer l’existence de divinités subalternes. Citons à titre d’exemple l’écrit visionnaire du Testament de Moïse, légèrement antérieur aux œuvres philoniennes, qui évoque la fin des temps en consacrant le rôle essentiel d’un « Envoyé » de Dieu (l’archange Michel). Cette trace d’une divinité duelle se retrouve dans nombre d’écrits dits apocalyptiques (Daniel, IIIe livre d’Henoch), lesquels n’hésitent pas parfois à recourir à la dénomination « Petit Yahvé » pour évoquer la seconde figure divine.
L'auteur cherche à démontrer que de tels textes ont pu favoriser l’éclosion de la Gnose. Il cite, entre autres, certains écrits gnostiques, tels que le Livre de Jéü qui parle du grand et du petit Yahvé ou encore le livre syriaque Gannot busame (« Jardin des délices »), où se rencontrent un « Petit Seigneur » et un « Grand Seigneur ». C’est donc bien dans le cadre de la paidéia (l'ensemble des connaissances culturelles enseignées au citoyen grec dans l'Antiquité) gréco-judaïque qu’apparaissent les premiers éléménts de la philosophie chrétienne et de la Gnose, ce que l’auteur nomme les « éléments d’un riche proto-christianisme » .
L’élaboration de la pensée doctrinale chrétienne en opposition à la Gnose
Certains textes du christianisme primitif témoignent, non sans ambiguïté, de la coexistence de la Gnose et de la philosophia Christou. Cela conduit inévitablement l’Ekklèsia naissante à déterminer plus précisément ses dogmes, à la lumière notamment des positions gnostiques. Considérons ainsi la question du mal, centrale d’un point de vue théologique, et à laquelle les gnostiques apportent une réponse cohérente en reconnaissant l’existence d’un mauvais démiurge créateur du cosmos et du monde matériel : elle se trouve reconsidérée par le christianisme en opposition précisément à l’affirmation gnostique. Le dogme du péché originel, dans le cadre du Credo, consacrera, par-delà certaines controverses animées (le pélagianisme notamment ), la responsabilité humaine et la transmissibilité du péché de génération en génération et par là même l’unicité absolue de Dieu dans son rapport au monde et aux hommes. La Gnose apparaît dès lors aux yeux de l’auteur comme « un aiguillon doctrinal du christianisme » en consacrant le dogme central de la Trinité, entendue comme « intégration radicale à la Divinité des fonctions médiatrices du Logos et du Pneuma, jusqu’alors dissociées » . On mesure ici la façon dont la philosophie chrétienne s’est imposée dans sa singularité à partir d’une source judaïque (l’œuvre de Philon entre autres) déployée dans le creuset culturel du gréco-judaïsme.
Cette démonstration de l’auteur le conduit alors à développer une réflexion secondaire, à rebours du discours traditionnel, selon laquelle le judaïsme ou sa forme rabbinique ne serait que second par rapport au christianisme dans l’ordre d’apparition (d’où le sous-titre de l’ouvrage : « De l'archéologie du christianisme à l’institution du judaïsme »). Et André Paul de développer son argumentaire en montrant la façon dont « les rabbis, fondateurs du ioudaismos véritable sur la base du culte de la Torah » ont rejeté l’héritage gréco-judaïque en consacrant un culte à un dieu dénommé « Yahvé », « qui n’a guère les traits ni les comportements du Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob » puisqu’il se « présente sous les traits d’un rabbi de la Yeshiva ou Académie céleste » . De fait, il peut encore apparaître comme un dieu national en contradiction avec le « Dieu monos », comprenons le Dieu unique. Il en va de même, selon l’historien, concernant le rôle dévolu à Moïse dans le ioudaismos puisqu’il perd son statut de chef de guerre et de meneur prophétique au profit de celui d’un insigne rabbi. Le judaïsme premier, tel qu’il se dessinait à grands traits dans le corpus vétérotestamentaire, se trouve dès lors minoré, voire disqualifié, le judaïsme rabbinique se constituant, selon André Paul, en rupture avec les traditions des Pères.
La Gnose au cœur des interrogations religieuses et philosophiques
Le présent ouvrage, en se confrontant à l’épineuse question de la Gnose antique, offre une passionnante plongée au cœur de la matrice proto-chrétienne qui se développe essentiellement au Ier siècle de notre ère, à l’époque où s’entrelacent et s’interpénètrent diverses dynamiques religieuses, en dehors de toute opposition frontale. Que cette richesse culturelle, théologique ou encore sociologique soit l'une des caractéristiques du christianisme primitif a déjà amplement été démontré. L’intérêt du livre réside ailleurs, dans la façon dont l’auteur, à travers une approche aussi savante qu’intelligible, parvient, textes à l’appui, à démontrer que la paidéia gréco-judaïque a nourri conjointement le champ du christianisme et celui de la Gnose antique. Le corpus néotestamentaire témoigne avec force de cette double inspiration que l’Ekklèsia naissante, à la fin du IIe siècle, prendra soin de gommer en contrant, quasiment point par point, la pensée gnostique dont l’apothéose correspond précisément au IIe siècle de notre ère.
À cet égard, l'un des intérêts majeurs du livre, nous semble-t-il, est de questionner notre vision monolithique du texte religieux — en l’espèce ici, le Nouveau Testament — en soulignant la façon dont il est traversé par des tensions, par des lignes de force qui font de lui une vaste marqueterie religieuse. Que le jeu des possibles influences ayant présidé à l’élaboration de ces textes sacrés reste primordial aux yeux des chercheurs est un point acquis. Depuis quelques décennies d’ailleurs, la recherche oriente ses travaux vers les textes dits apocryphes pour sonder précisément ces influences. André Paul montre ainsi, entre autres, que la littérature visionnaire (parfois dite apocalyptique), du Ier av. J.C. au Ier de notre ère, innerve la philosophie chrétienne naissante ainsi que la Gnose antique. Ce n’est pas la moindre des qualités de cet ouvrage que de permettre au lecteur de questionner avec l’auteur les problématiques religieuses essentielles que sont la naissance du monothéisme , la distinction judaïsme/christianisme et la question du mal.
Concernant la seconde, le lecteur trouvera un prolongement intéressant à la réflexion d'André Paul dans le livre de Daniel Boyarin intitulé La Partition du judaïsme et du christianisme . Le théologien américain y met en effet en cause le modèle traditionnel de la partition entre deux entités clairement distinctes (le judaïsme rabbinique et le christianisme des Pères de l’Église) en montrant que la plupart des marqueurs différentiels (la seule hypostase divine, la théologie du Logos notamment) étaient initialement partagés par des juifs et des chrétiens, ce qui pourrait nous conduire à nuancer les propos de l’auteur en ce qui concerne un rejet total de l’héritage gréco-judaïque de la part du judaïsme rabbinique. On peut aussi légitimement questionner la réflexion de l'historien concernant la position seconde du judaïsme (rabbinique, il est vrai) par rapport au christianisme. Une telle pensée nous paraît en effet parfois gommer l’existence d’un judaïsme prérabbinique par-delà la destruction du Temple de 70. En effet, il semblerait que l’historiographie traditionnelle selon laquelle l’autorité rabbinique se serait imposée à l’ensemble des Judéens après le concile de Yabneh puisse être remise en cause puisque le champ d’action de l’autorité rabbinique ne touchait sans doute pas tous les Judéens, et de surcroît, le judaïsme ne se réduit pas aux seuls documents judéens des IIe-IVe siècles issus du mouvement rabbinique (voir entre autres la littérature apocryphe dite chrétienne ou la littérature targoumique).
Quoi qu’il en soit, la lecture du présent ouvrage se révèle passionnante et d’une inestimable fécondité, tant les réflexions avancées sont constamment illustrées de manière pertinente par des textes nombreux et variés. Signalons également la présence d’un précieux lexique des notions grecques référant à la philosophie ou à la religion ainsi qu’une bibliographie détaillée. L’auteur, toujours soucieux de clarifier les étapes de sa pensée, sait mettre son érudition au service d’une pensée dynamique et concise qui cherche constamment à interroger à nouveaux frais les représentations traditionnelles. De ce point de vue, La Gnose antique a le grand mérite de mettre en lumière l’importance d’un mouvement de pensée qui prend sa source dans la paidéia gréco-judaïque, ensemence le corpus néotestamentaire avant d’orienter, à son insu il est vrai, de manière décisive la pensée doctrinale chrétienne, comme si seul prévalait en définitive l’universel questionnement religieux, à la fois anthropologique, théologique, cosmique et eschatologique : quelle voie de salut pour l’homme ?