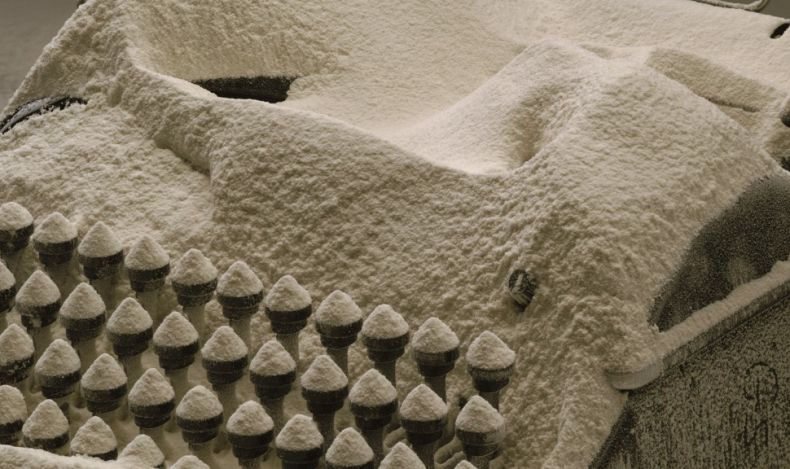La traduction française d'un ouvrage important pour penser l'émergence des médias.
L’archéologie des médias est une expression à la mode dans l’espace francophone. Il était donc temps que l’ouvrage — Qu’est-ce que l’archéologie des média ? — de Jussi Parikka soit traduit. La version anglaise date, en effet, de 2012 (elle est ici à peine remaniée). Historien de formation, l’auteur, professeur de cultures technologiques et d’esthétique à l’université de Southampton, y relève le défi d’un état de la recherche en médiarchéologie. Il œuvre également à distinguer cet axe de pertinence de l’histoire des médias , des études culturelles et de l’histoire de l’art.
Cela est cependant fait sans chercher à définir une nouvelle discipline, l’archéologie des médias étant plutôt conçue comme étant une manière de décloisonner et de mettre en crise différentes perspectives disciplinaires préexistantes. L’usage de cette expression a donc une valeur stratégique dans le champ académique. Elle permet d’agréger, sous un même label, un ensemble de points de vue qui visent à renouveler l’étude des médias. Cet usage stratégique constitue également la principale faiblesse de l’optique défendue, car la cohérence théorique dudit mouvement est parfois douteuse. L’ouvrage rend en tout cas compte de la diversité des types des recherches qui sont désignés par ce syntagme.
Relativiser les impressions de « rupture » et de « nouveauté »
En effet, l’archéologie des médias revient, pour certains, à étudier l’émergence d’un nouveau média, en prenant en considération des dispositifs plus anciens . Ainsi, la manière dont le cinéma se délocalise (diffusion des contenus audiovisuels sur différents écrans miniaturisés — téléphone intelligent — et élargis – façade d’un immeuble) conduit à souligner qu’il n’est pas ontologiquement lié à un format de diffusion (la projection dans une salle d’images inscrites sur une pellicule) . L’archéologie se distingue ici de l’histoire, dans la mesure où l’étude porte moins sur l’institutionnalisation de pratiques médiatiques (ce qui s’est passé entre 1890 et 1915 et au début du XXIe siècle) que sur la mise en rapport d’un média émergent (ce qui se passe au début du XXIe siècle) et d’un ensemble de pratiques passées (ce qui s’est passé entre 1890 et 1915) .
Dans ce cas, ce qui est premier, c’est la mise en relation des deux moments médiatiques . Cela conduit à mettre en perspective l’impression d’une rupture radicale liée à l’émergence des « nouveaux médias » (sous-entendu numérique) et, dans un même mouvement, à identifier ce qui est propre à chaque configuration médiatique. Cette perspective, développée notamment par Thomas Elsaesser, Tom Gunning ou André Gaudreault est présentée dans le premier chapitre de l’ouvrage de Parikka . Elle est ainsi, d’une certaine manière, renvoyée à une période (passée) de l’histoire de l’archéologie des médias .
Une contre-analyse de la société via l’analyse de médias "inadvenus"
L’auteur associe à cette perspective l’étude des médias qui ne se sont jamais institutionnalisés (chapitre 2 : « Média imaginaires : cartographier des objets bizarres »). Il porte ainsi une attention particulière aux machineries qui n’ont pas connu le succès escompté par leurs promoteurs. Cet intérêt pour l’inadvenu n’est pas celui du collectionneur d’incunables . Il vise, plutôt, à une délinéarisation de l’histoire des médias.
De nouveau, cela est surtout fait de manière à comprendre ce qui se joue dans le présent. Ce souci permanent d’articuler différentes temporalités et la prise en compte du rôle des médias dans notre rapport au temps constituent d’ailleurs quelques-uns des principaux intérêts théoriques de l’ouvrage. Il s’agit de rouvrir le champ des possibles propres à la période étudiée afin de lui rendre son caractère imprévisible. L’archéologie s’oppose ici à une histoire téléologique des médias. Il s’agit ainsi de proposer une contre-analyse de la société .
Cela conduit l’auteur à considérer des médias qui n’ont existé que dans l’esprit et les écrits d’inventeurs, d’artistes ou d’auteurs. Ces médias imaginaires sont pertinents, car ils renseignent les chercheurs : « qu’est-il possible d’imaginer, et selon quelles conditions historiques, sociales et politiques ? À quelles conditions les médialités imaginaires de l’esprit moderne et de la culture contemporaine sont-elles soumises ? Et, d’autre part, comment les imaginaires conditionnent-ils notre perception des technologies réelles ? » (p. 102).
L’archéologue des médias s’intéresse donc aux discours et à leur appropriation dans l’espace public . Cette perspective s’inscrit dans la continuité directe des théories foucaldiennes sur l’archive . Il s’agit ainsi moins de s’intéresser au contenu partagé via un support donné (une représentation), qu’aux conditions qui ont rendu possible le fait de penser et de mettre en place un tel dispositif médiatique. Il s’agit en somme d’étudier ce qui se situe en amont de la représentation médiatique (film, texte, photographie).
La technique au centre de l’étude
Pour ce qui est de l’archéologie des médias, cet « amont » est, certes, toujours culturel, social et économique, mais il est avant tout d’ordre technique. Cela est étudié dans un chapitre intitulé « Théorie des médias et nouveau matérialisme ». Le point de vue choisi revient alors à se détacher de perspectives centrées sur des déterminants principalement économiques (approche (néo)marxiste) ou sur des variables culturelles, p. 131).
Considérer le rôle de la technique est, ainsi, pour Parikka (à la suite de Fredrich Kittler ), une manière de s’éloigner des enjeux des études culturelles anglo-saxonnes. Il s’agit d’adopter « le primat de la conception des systèmes sur une perspective herméneutique visant à l’interprétation et le sens » (p. 148-149). Wolfgang Ernst expliquait à ce propos que « l’archéologie des média se concentre sur les éléments non discursifs pour traiter du passé : moins sur les locuteurs que sur la capacité d’agir de la machine » (cité p. 157). Il ne s’agit donc pas de mettre en contact des représentations anciennes et modernes, mais de considérer les « caractéristiques essentielles [des médias], à savoir leurs dimensions opérationelle et processuelle » (p. 164).
Ce « nouveau matérialisme » qui a d’abord émergé dans les universités allemandes (Medienwissenschaft) est maintenant présent dans des centres anglo-américains, autour des « software studies, études des plates-formes, [et des] études légales des médias. » (p. 134). Le chercheur invite donc à considérer les matériaux et la fabrique des machines en allant « sous le capot » (p. 158), mais aussi en lisant les manuels, les politiques et les protocoles qui guident l’usage d’un dispositif technique (une caméra, un projecteur, un magnétophone, par exemple). Cette centralité de la technique (certains diront ce déterminisme technologique) conduit à prendre en compte ce que les machineries propres à une époque permettent ou non. Les conditions de possibilité du savoir souvent recherchées dans les discours, Parikka invite ainsi à les penser à partir des machines elles-mêmes .
Technique et politique
Le chapitre suivant, « Cartographier le bruit et les accidents », met à l’épreuve d’un cas — l’étude du bruit — les considérations susmentionnées. En se basant sur la conception très classique du rapport signal/bruit chez Claude Shannon et Warren Weaver, il illustre une perspective technocentrée qui peine à articuler technique et usages socioculturels, politiques et économiques des médias.
Le chapitre consacré à la dynamique des archives à l’ère du numérique est plus convaincant dans sa tentative d’articuler dimension technique et enjeu politique. La démonstration est centrée sur l’idée que ce qui fait archives ce sont moins les documents conservés numériquement que la machinerie qui rend possible leur préservation, soit tout à la fois leur conservation et leur partage. Suivant Ernst, Parikka explique s’intéresser moins aux documents qu’« à leurs conditions techniques, qui sont aussi les conditions de leur archivage » (p. 222). Il s’agit de considérer qu’il n’y a pas d’archives en dehors des machineries qui conditionnent leur modalité de préservation.
Il écrit ainsi : « nous pouvons (…) considérer les objets numériques comme des objets physiques (les inscriptions concrètes sur des bandes magnétiques) et logiques (renvoyant, par exemple, à la manière dont fonctionne le logiciel et au fait que les bitmaps offrent des informations qui présentent une pertinence analytique, y compris pour les humanités). » (p. 226). Il s’agit là d’une critique assez transparente des discours portant sur l’immatérialité des contenus numériques et, donc, d’une certaine manière de pratiquer les humanités numériques.
A l’encontre du déterminisme technique ?
Le risque de remplacer un déterminisme économique ou culturel par un déterminisme technique est pris en compte dans le dernier chapitre du livre, intitulé « Pratiquer l’archéologie des médias ». Parikka considère alors le médiactivisme et le médiartivisme, soit des pratiques militantes et artistiques – Paul DeMarinis, Gebhard Sengmüller, Zoe Beloff... – comme relevant de l’archéologie des médias (les auteurs ne s’identifient eux-mêmes que rarement à ce type de démarche). Celles-ci reviennent notamment à « passer de ce que nous voyons (le contenu) au codage, à la modulation et à la transmission de ce que nous voyons (les média comme normes et signaux de codage). » (p. 263). Il s’agit alors de voir comment les approches analysées précédemment sont appropriées en dehors des murs de l’université. Des productions culturelles qualifiées d’assemblages, de remix, de remédiations et de rematérialisations (usage de machines obsolètes et de consommables désuets) sont alors étudiées. Ces réalisations très diverses ont pour point commun de mettre en scène la fabrique des contenus médiatiques. Il s’agit ainsi davantage d’analyser des processus que des représentations. L’auteur se penche ainsi sur le degré d’appropriabilité des techniques par les usagers. Il est possible de se demander dans quelle mesure le bricolage et/ou le hacking d’une machine sont possibles et quelles sont les conséquences de celui-ci sur leur fonctionnement.
Ce déplacement de l’histoire de la technique vers des pratiques culturelles liées à la technique correspond à une manière de réintégrer la question du politique. C’est une réponse aux limites de l’école allemande des médias, dont Parikka indique que « le problème, c’est que si cet accent sur les machines permet une discussion très raffinée sur les conditions techniques de la perception, il ne permet pas véritablement de relier cette approche aux thématiques de l’économie politique, ou encore de la subjectivité et de la subjectivation. » (p. 234).
Cette attention à l’articulation entre la technique et la société est louable. Cependant, il est étonnant que la solution proposée repose principalement sur l’étude du rôle des artistes et des militants. Cela conduit à oblitérer le fait que, depuis des années, ces questions sont centrales, notamment dans le cadre des études intermédiales. Celles-ci considèrent des environnements médiatiques qui articulent appareillages techniques, usages sociaux, espace public et temporalité. Silvestra Mariniello explique à ce titre que l’intermédialité « marque le passage d’une théorie de la société qui contient les médias – conception généralement établie de nos jours – à une théorie où société, socialités et médias se coconstruisent et se détruisent en permanence . »
L’étude de l’émergence des médias s’inscrit d’ailleurs assez strictement dans cette perspective. Elle revient à ne pas uniquement considérer un média comme étant quelque chose qui s’invente, mais à le traiter également comme étant un fait social. En somme, pour qu’une série culturelle se distingue d’un média lui préexistant, il ne faut pas seulement un changement d’ordre technique (une invention), mais une institutionnalisation, qui passe par la création de discours, ainsi qu’une demande sociale. Le fait que Parikka n’interroge pas l’équivalence entre appareillage technique et média pourrait, dans cette perspective, être considéré comme une limite dans la démarche qu’il a engagée.
Points de discussion
Revenons-en à présent aux apports du livre. Après avoir fait porter leur attention sur l’émergence des médias et sur des médias imaginaires, les chercheurs en archéologie des médias ont appréhendé les déterminants techniques pour eux-mêmes. Cela les a conduits à s’éloigner d’une étude des représentations médiatiques pour se concentrer sur des processus et sur la fabrique de dispositifs. Cette tendance techniciste conduit à ignorer la dimension politique des médias. Or, il s’agit d’un enjeu central pour Parikka .
Ce dernier propose donc d’élargir l’archéologie des médias aux pratiques culturelles et artistiques qui s’approprient la mise en scène des médias en tant que tels. Ces trois tendances, respectivement centrées sur les notions d’émergence, de technique et de pratiques, coexistent ; elles ne se succèdent pas. En effet, l’étude de l’émergence des médias est, plus que jamais, d’actualité. Les pratiques artistiques qui mettent en scène des médias ont, elles, existé bien avant que l’archéologie des médias s’impose comme une perspective disciplinaire. Cette coprésence de ces perspectives conduit à une certaine confusion. Elle fait naitre l’impression que des approches assez clairement distinctes sont désignées par la même appellation. Les panels, les articles, les ouvrages qui renvoient à cette expression peuvent, en effet, porter sur des médias en émergence, des machineries dont il s’agit d’ouvrir le capot ou sur des œuvres relevant du Net.art . Ce flou notionnel n’est cependant pas uniquement à considérer d’un point de vue critique.
Il faut, pour comprendre ce dernier point, revenir à l’enjeu de l’archéologie des médias. En fait, comme il a été indiqué en introduction, il s’agit d’un axe de pertinence qui vise à mettre en crise des disciplines préexistantes. Ainsi, Parikka adopte, en conclusion, un ton programmatique en expliquant que pour « se faire une place en tant que méthodologie dans les humanités du XXIe siècle, [l’archéologie des médias] doit expliciter dès le départ sa position particulière, au croisement de l’art, de la science et de la technologie, et montrer que ces franchissements de frontière s’inscrivent dans des lignées plus anciennes. » (p. 275).
Cela revient, en quelque sorte, comme cela a pu être dit de l’intermédialité , à percevoir l’archéologie des médias comme étant une discipline seconde . Cette manière de faire de la recherche est donc une façon de se poser autrement des questions qui ont déjà été longuement abordées par d’autres voies.
Ainsi, par son attention à l’histoire et à la comparaison entre des médias non contemporains les uns des autres, l’archéologie des médias critique une certaine manière de faire des humanités numériques. De plus, elle oppose aux études culturelles et à l’histoire de l’art, la nécessité de moins considérer les œuvres et les représentations culturelles, que les machines et leur mode d’activation. C’est une manière de porter l’attention sur la technique et la matérialité des médias, soit sur ce qui permet de donner à voir et à entendre, plutôt que sur ce que les médias nous donnent à voir et à entendre.