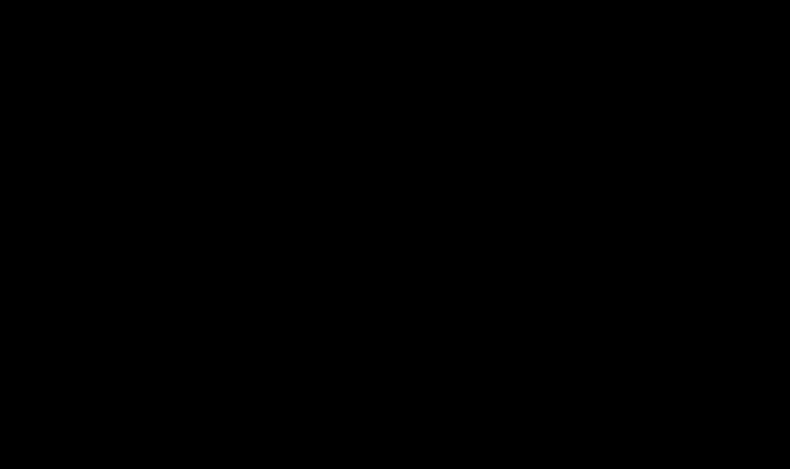La chute et le salut des images chez Jean-Luc Godard revisité à partir d’une constellation de philosophes (Derrida, Deleuze, Foucault...).
L’actualité cinématographique de 2017 a été marquée par Le Redoutable, un film de Michel Hazanavicius sur Godard (pour simplifier outrageusement) conçu à partir du livre d’Anne Wiazemsky, Un an après. Dans ce livre publié en 2015, l’actrice et romancière qui fut aussi son épouse restitue leur histoire de mai 1968 à mai 1969. C’est cependant d’assez loin de cette actualité qu’écrit Saad Chakali, dans un livre qui soulève de nombreuses questions sur la figure tutélaire de la Nouvelle vague : comment lire, entendre ou voir l’œuvre de Jean-Luc Godard en philosophe et par la philosophie ? Comment comprendre cette œuvre malgré ceux qui n’y voient que des amalgames d’images ? Avec Jean-Luc Godard : dans la relève des archives du mal, Saad Chakali ancre ainsi sa lecture de l’œuvre du cinéaste dans la philosophie et non dans une analyse d’images.
L’exploration dont résulte cet ouvrage – dont l’objet est de déployer une interprétation du travail de Godard sous la condition de l’« image dialectique », selon la formule de Walter Benjamin – provient d’une participation à des séminaires, notamment du Collège international de philosophie (2014). Elle tente, désormais sous la forme d’un ouvrage largement étayé, de dégager une cartographie de l’archive chez Jean-Luc Godard, cette expression pouvant renvoyer à l’établissement d’un inventaire des images comme à la proposition d’un répertoire des gestes cinématographiques du metteur en scène. Sachant que par « archive », l’auteur n’entend pas uniquement les productions du maître, mais aussi les éléments de son geste artistique se saisissant d’extraits de films de fiction pour s’emparer en eux de « la part du cinéma ». Mais cette manière de s’emparer des images, caractéristique évidemment d'Histoire(s) du cinéma, interroge la manière de caractériser l'image d'archive : est-elle image dialectique sans récapitulation ? association libre d’images ouverte aux courts-circuits ? La liste des questions ouvertes est longue, et la la thèse de l’auteur est ambitieuse : ces Histoire(s) du cinéma ne véhiculent moins un oracle prophétique qu’elles soutiennent une fiction messianique imprégnée par la lettre de Paul et par les Thèses sur l’histoire de Benjamin.
Un point de départ
Le point de départ de cette réflexion philosophique de grande ampleur, par ce qu’elle brasse constamment de références et de considérations – sans doute un peu surchargées – sur l’image-mouvement, selon l’expression de Gilles Deleuze, est le propos de Godard : « L’image vient au temps de la résurrection » (Histoire(s) de cinéma, 1988-1998). Certes, cette citation pousse par elle-même à un jeu de rappel (à Paul, Épitre aux Corinthiens, 15-49). Mais l’auteur insiste surtout sur le fait que l’on ne peut ni rater le caractère énigmatique de cette presque citation, ni sa fonction dans l’œuvre du cinéaste si, centralement, on la comprend comme un site poétique constitutif d’une mémoire dépositaire des souffrances historiques. L’interprétation, ici, en devient : que cette formule exprime le désir paradoxal « d’assigner une temporalité spécifique à l’image », en lui faisant jouer le rôle de briser le continuum catastrophique du temps historique ». Dans ce jeu de relève du monde par l’image – le terme est repris de Jacques Derrida, utilisé aussi par Jacques Lacan – et par un cinéma conçu comme « rédemption », s’inscrit une tension paradoxale : celle du montage dialectique d’images de l’oubli et de l’indignité du cinéma de propagande et de divertissement, tel que Godard le pratique.
C’est en tout cas une manière d’aborder le choix des images chez Godard, en particulier dans Histoire(s) du cinéma, pour autant que ces choix relèvent à la fois d’une conception du nouage des images et du projet, de type benjaminien, de produire des chocs entre les images, qui fassent lever les spectres (dit Hélène Bouchardeau) ou aident à produire une image dialectique qui permette de penser une autre puissance esthétique que celle du divertissement.
L’archive
Cette lecture philosophique du travail de Godard conduit l’auteur à le placer sous l’autorité d’un certain caractère messianique (sans messianisme, si l’on s’accorde avec Jacques Derrida). « Une place au soleil de la rédemption, voilà en tout cas ce que désirent assurément les Histoire(s) du cinéma pour toutes les images sans exception, dans l’indifférence égalitaire à toute hiérarchie formelle ou culturelle ». C’est ce qui permettrait à Godard de placer l’image d’un déporté en miroir de celle du Christ ressuscité, l’image de la star hollywoodienne en reflet de la Marie-Madeleine de Giotto, etc. De ce fait, loin qu’il s’agisse de nier ou effacer la mort génocidaire, en risquant de la noyer dans un flot d’images, il s’agit bien de la relever, à partir de la puissance de scandale que peut incarner le cinéma.
La cartographie visuelle de Godard – dont chacun a retenu au moins l’usage qu’il fait de la photographie de l’enfant du ghetto de Varsovie – consiste par conséquent moins à répertorier et classer les images, et moins encore à cultiver une quelconque exhaustivité, qu’à tirer des lignes de force de ces images en tant qu’elles recueillent la mémoire d’une souffrance. Les Histoire(s) du cinéma ne constitue-t-elles pas un espace fictionnel d’écriture devant permettre au spectateur de reconfigurer sa vision de l’histoire du cinéma, tout autant que celle de l’histoire du XX° siècle. Ainsi l’auteur indique-t-il que l’archive godardienne bat et rebat les images afin d’en débattre, après les avoir démontées de leur chaine de montage originel et remontées comme en « un battement de coeur », en un geste sensiblement benjaminien.
L’archive godardienne produit des constellations d’images, sans postuler un achèvement terminal. Le patient travail de redécouvrir à chaque fois de nouveaux points de départ, ne laisse pas à cette « dialectique » (cette dernière poursuivant Godard depuis l’engagement dans le groupe Dziga-Vertov, mais pouvant être interprétée de manière non hégélienne ou marxiste) la volonté de clôture. Il est non moins certain que dans la querelle des images, et devant les postulats de Claude Lanzmann par exemple, Godard peut répondre que face au refus de la représentation, il faut affirmer un « c’est toujours çà ».
Le montage
Il n’en reste pas moins vrai que tout est affaire de montage, comme on le sait. Godard n’a cessé de le souligner. Chakali, à ce propos, entreprend une analyse tout à fait pertinente du film du cinéaste portant sur Sarajevo. Il s’y empare d’un cliché du photographe Ron Haviv pour déployer son indignation contre les photographes qui n’interviennent pas devant les crimes, en se contentant de les « documenter ». Des bosniaques tombés deux fois : dans la vie et sur la photographie ! Le film représenterait-il donc une sorte de sauvetage allégorique des innocents profanés !
Si Godard peut faire du montage le « propre » de l’art cinématographique, c’est aussi parce que dans les constellations d’images ainsi construites, s’inscrit une dialectique dans laquelle s’exerce la force d’un rapprochement entre des images qui ne sont pas prédisposées à se côtoyer. Autant affirmer que le geste esthétique godardien du montage des antagonismes et des hétérogènes peut avoir marqué le cinéma des années 1950 à nos jours.
C’est de cette manière que Godard aurait relevé l’honneur des vaincus par l’art cinématographique.
L’héritage européen
Dans cet ouvrage, un passage tout à fait pertinent concerne les rapports de Godard, moins au cinéma hollywoodien qu’au cinéma européen, notamment à Roberto Rossellini. L’auteur souligne des similitudes entre des images, mais aussi les reprises et montages d’images de Rossellini dans Histoire(s) du cinéma. Il faut réentendre effectivement Godard appréciant la manière dont, au travers du cinéaste, l’Italie a reconquis le droit de se regarder en face.
De ce fait, il est important de revenir un peu sur la question du montage, dans la mesure où il est possible d’opposer le montage des intervalles à la manière de Dziga Vertov et le montage des attractions, version Eisenstein. C’est même cette opposition qui permet à l’auteur de traiter Ici et Ailleurs (Anne-Marie Miéville et Jean-Luc Godard) comme l’un des grands films politiques de la période (1974), lequel fait le deuil d’un certain gauchisme.
De deuil en deuil, c’est sans doute ainsi que l’histoire se fait, même si le deuil est ce qui caractérise moins la fin de l’histoire – thème auquel Godard n’adhère pas, compte tenu de ce qui fut dit ci-dessus de la dialectique – que le début de la mémoire. Et ceci dans la mesure où le deuil est ce à partir de quoi la mémoire atteste que de l’histoire eut lieu. Ou plus précisément, elle permet d’exercer une certaine résistance, en l’occurrence « actuelle », à l’encontre les entreprises de liquidation des noms et des récits, que cette liquidation soit politique ou commerciale. C’est alors vers le spectateur qu’il convient de se tourner. Le spectateur godardien finissant par acquérir de l’aisance dans ce jeu de court-circuit qui ne cesse de le solliciter en direction d’une « mémoire du futur ».
Le battement d’images
Signalons encore deux spécificités de cet ouvrage. La première consiste en une série d’encadrés, tout au long des pages, chacun destiné à préciser un point ou un autre, voire à ramasser les citations utilisées afin d’en préciser les sources conceptuelles et la logique. La seconde renforce l’argumentaire par des analyses plus précises, dans des Annexes thématiques, publiées en renfort des travaux de l’auteur dans le cadre du site de cinéma Des nouvelles du front cinématographique, portant sur tel ou tel film de Godard ou sur la lecture des films par Georges Didi-Huberman.
Et par conséquent, l’auteur souligne constamment que l’archive godardienne témoigne que le cinéma aura été l’art qui aura le mieux exprimé la spécificité à la fois industrielle et spectaculaire du XX° siècle, ce siècle se réfléchissant dans le miroir de cet art qu’est le cinéma. L’archive godardienne, dans l’héritage de l’image dialectique benjaminienne, serait ainsi l’ouverture à l’à-venir d’une justice à l’endroit de la situation faite aux opprimés. L’objectif serait de faire fuir l’histoire le long de ses lignes de faille afin d’en tirer de nouvelles lignes de force. Ce propos s’entend d’ailleurs plus exactement en rapport avec Histoire(s) du cinéma qu’en rapport avec les films d’anticipation de Godard (1965-1967), puisque ces Histoire(s) (épisode 3 A) se réclament de la formule (remaniée) de Sieyès : « que veut le cinéma : Tout »
A lire aussi sur Nonfiction.fr :
- La critique du film Le Redoutable par Antoine GAUDIN.