Les États-Unis s’apprêtent à élire leur prochain(e) président(e). Deux fois par mois, cet horizon sera l’occasion d’explorer, avec Pascal Mbongo, un pays dont les contrastes et les mutations ne lassent pas d'en agacer certains et d'en fasciner d'autres – parfois les mêmes.
Cette troisième livraison de la série est consacrée à la prostitution. Avec l’incrimination pénale des clients de prostituées en passe d’être introduite dans la législation française, la France va dans le sens du choix opéré par les États-Unis, pour des raisons tout à fait différentes, au début du XXe siècle.
C’est un interdit légal majeur aux États-Unis depuis un siècle, la prostitution, qui fait l’objet d’une hyper-présence dans les images produites par les industries culturelles américaines, depuis les biatch(es) et les P.I. (pimp[s]), entendez « proxénètes ») des clips vidéos d’un certain rap, jusqu’à celles et ceux des séries policières ou du cinéma. Dans le cas du cinéma, Pretty Woman retient particulièrement l’attention dans la mesure où, sorti en 1990, le film de Gary Marshall rencontra l’un des plus importants succès populaires du cinéma hollywoodien. Ce n’est cependant qu’à partir des années 2000 que, l’avènement de l’Internet aidant, les critiques du film pour son triple caractère sexiste, paternaliste et « glamourisant » de la prostitution commencent de concurrencer sérieusement sa représentation initiale comme une « histoire de Cendrillon ».
Ce chassé-croisé est d’autant plus remarquable que la contestation par l’opinion publique de la légitimité de l’incrimination pénale de la prostitution ne s’est pas spécialement développée dans la même période. Bien qu’apparemment minoritaire, cette contestation est néanmoins lointaine puisque c’est à elle que l’on doit notamment la substitution proposée dans les années 1970 de l’expression sex worker à celle de prostitute par Carol Leigh alias Scarlot Harlot, activiste et prostituée de San Francisco.
Empreinte française
L’histoire de la prostitution aux États-Unis aux XVIIIe et XIXe siècles est remarquable pour sa part française. Celle-ci désigne la « déportation » de prostituées de la France vers la Nouvelle-Orléans au début du XVIIIe siècle, au moment du peuplement de la Louisiane. S’il est généralement admis que cette « déportation » de prostituées vers le Mississipi était vouée en particulier à conjurer les « razzias » pratiquées par les colons sur les Indiennes, elle ne participait pas moins d’une politique générale de peuplement pénal et para-pénal de la Louisiane par des mendiants, des vagabonds, « [des] femmes, gueuses, délinquantes, libertines ou prostituées (…) », des proches dénoncés par leurs familles aux pouvoirs publics comme étant « incorrigible(s) pour (leur) libertinage, (leur) fainéantise, (leur) ivrognerie, (leur) passion du jeu, (leurs) violences, (leurs) mauvaises fréquentations, (leurs) vols répétés, (les) dettes accumulées et autres motifs similaires lesquels, d’ailleurs, dissimulaient parfois le simple désir d’éliminer un membre gênant dont la part d’héritage était convoité » (Charles Frostin, « Du peuplement pénal de l'Amérique française aux XVIIe et XVIIIe siècles : hésitations et contradictions du pouvoir royal en matière de déportation », Annales de Bretagne et des pays de l'Ouest, 1978, vol. 85, n° 1, pp. 67-94 [p. 79]).
Dans la deuxième moitié du XIXe siècle, à la suite du California Gold Rush, un autre mouvement d’émigration prostitutionnelle fit aller des prostituées de Paris et de Marseille vers San Francisco. Dans The Barbary Coast: An Informal History of the San Francisco Underworld, Herbert Asbury soutient qu’en 1850, ce ne sont pas moins de 900 prostituées des prisons de Paris et de Marseille qui furent annoncées comme venant de France, même si seule une cinquantaine d’entre elles semblent avoir été finalement dénombrées à San Francisco. Cette immigration ne fut pas exclusivement française mais authentiquement internationale. Et elle se fit malgré le Page Act du 3 mars 1875, une loi par laquelle le Congrès a interdit l’importation de femmes aux États-Unis en vue de leur faire exercer des activités prostitutionnelles.
Storyville, la grande Babylone du Sud
Dire que la prostitution a été légale aux États-Unis avant la Première Guerre mondiale est un peu une commodité juridique car avant la prohibition explicite au début du XXe siècle les prostituées n’étaient guère en situation de « sécurité juridique » vis-à-vis de polices locales qu’il fallait constamment corrompre en échange de la promesse de ne pas être persécutées à toutes sortes de titres.
L’apparition constatée déjà dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle de quartiers hébergeant des houses of prostitution relevait néanmoins d’une certaine tolérance. Cette tolérance fut institutionnalisée à la fin du XIXe siècle avec l’apparition de red-light districts, des « quartiers rouges » créés par décision des pouvoirs publics en vue tout à la fois de faire disparaître la prostitution des rues et de mieux la contrôler. D’après l’Oxford Dictionary, l’appellation de ces quartiers par l’expression red-light district doit à l’habitude prise par les employés du rail de laisser des lanternes rouges aux portes et fenêtres des prostituées auprès desquelles ils se trouvaient, ce afin de prévenir leurs employeurs au cas où ceux-ci auraient voulu disposer d’eux.
Le plus grand et le plus mémorable red-light district de l’Amérique ouvre le 1er janvier 1898 à la Nouvelle-Orléans. Entre sa naissance et sa fermeture le 12 novembre 1917, Storyville fut la « grande Babylone du Sud ». Les deux arrêtés municipaux qui en décidèrent en 1797 sont un chef d’œuvre de jésuitisme juridique tant il fallait à la municipalité ségréguer la prostitution dans un lieu unique sans donner le sentiment d’avoir légalisé une pratique que l’American Constitutional Law d’Henry C. Black, ouvrage paru en 1895 et ayant fait autorité auprès des juristes, présentait comme étant « contraire aux bonnes mœurs ». En 1900, dans L’Hote v. City of New Orleans, la Cour suprême des États-Unis elle-même donna quitus à la ville de sa fiction en concluant que ses arrêtés « ne légalisaient pas le vice » mais… assuraient l’ordre public.
Entre saloons, cabarets, bars, hôtels, les orchestres de Jazz et les chanteurs ou chanteuses de blues, les voyageurs étaient éclairés par une sorte d’annuaire vendu à travers la ville, le Blue Book, qui tout à la fois recensait les établissements de plaisir en spécifiant leurs particularités et l’appartenance raciale des patrons ou des patronnes, portraiturait les « filles de joie » en mettant également en évidence leurs appartenances raciales (Blanche, Noire, Octavonne [Octoroon]…), éditait des publicités en faveur de ces établissements.
Au-delà des édiles de la Nouvelle-Orléans, d’intéressantes figures apparaissent dans les biographies de ce que les contemporains ont eux-mêmes appelé la Queer zone. Un homme d’abord, Tom Anderson, « maire officieux » de la ville, propriétaire d’établissements de plaisirs et plusieurs fois député de la Louisiane. Des figures de femmes se distinguent également dans la galerie des grands propriétaires d’établissements à Storyville. Celle de Josie Arlington, qui était Blanche. Celles de la « comtesse » Willie V. Piazza et de « Mademoiselle » Lulu White qui étaient Octavonnes, plutôt d’ailleurs que Noires. Du « temple superbe » de Miss Lulu White, le Mahogany Hall, Louis Amstrong dira que « les hommes riches venus du monde entier s’y rendaient pour se commettre avec de ravissantes prostituées créoles ».
Le Mann Act, cheval de troie de la prohibition formelle
En décidant en 1917 de mettre fin à la « ségrégation » de la prostitution à Storyville et en l’interdisant de fait, la municipalité de la Nouvelle-Orléans a répondu pour une part aux demandes du gouvernement fédéral et à ses inquiétudes sur les risques sanitaires courus par les soldats. Sans doute aussi des sensibilités nouvelles et critiques de la prostitution devaient-elles être à l’œuvre. Déjà, en 1902, la ville de New York réunit un comité d’experts (le « comité des 15 ») chargé de lui recommander une politique pour ce qui s’appelle déjà un « fléau social » (The Social Evil : titre du rapport). D’autre part, c’est le 12 février 1905 que naît l’American Society of Sanitary and Moral Prophylaxis Forms, une association créée par le Docteur Price A. Morrow avec le projet explicite d’obtenir l’interdiction de la prostitution. Enfin, quelque temps avant que le Congrès ne légifère en 1910, la Cour suprême des États-Unis, dans un arrêt Keller v. United States rendu le 5 avril 1909, a été amenée à décider que l’administration fédérale violait le XIIIe Amendement de la Constitution en « expulsant » des États-Unis une étrangère qui était devenue prostituée après être entrée en Amérique.
Le cheval de troie fédéral de l’interdiction générale de la prostitution par les États a été le Mann Act (officiellement, le White-Slave Traffic Act) du 25 juin 1910. Agissant sur le fondement de sa compétence constitutionnelle pour statuer sur le « commerce entre les États » et le commerce avec les États étrangers, le Congrès institue une répression pénale des personnes qui, en connaissance de cause, transportent, aident au transport ou aux déplacements entre les États (ainsi qu’entre les États et le district fédéral de Columbia) ou entre l’étranger et les États-Unis, de toute femme ou fille à des fins prostitutionnelles, de débauche ou à « toutes autres fins immorales ». La loi érige également en infraction pénale le fait de convaincre, persuader, inciter, contraindre, aider une femme ou une fille à voyager entre les tats (ainsi qu’entre les états et le district fédéral de Columbia) ou entre les états-Unis et l’étranger à des fins prostitutionnelles, de débauche ou à « toutes autres fins immorales ». Le Mann Act fut validé par la Cour suprême le 24 février 1911, dans Hoke v. United States, avec cette précision qu’il revenait à chaque État fédéré de statuer sur la prostitution pour son territoire, le législateur fédéral ne pouvant aller au-delà de questions intéressant le commerce entre les États ou les échanges internationaux des États-Unis.
Le Mann Act s’est abrité derrière deux instruments internationaux contemporains et relatifs à la traite des blanches, d’une part l’arrangement international du 18 mai 1904 « en vue d'assurer une protection efficace contre le trafic criminel connu sous le nom de traite des blanches », d’autre part, la Convention internationale relative à la répression de la traite des blanches du 4 mai 1910. James Robert Mann, le congressman Républicain de l’Illinois auteur du texte, a cependant aussi exprimé une « panique morale » proprement américaine vis-à-vis de la traite des blanches, à la faveur de nombreux récits de presse plus ou moins fantasmés sur des enlèvements de jeunes filles. Ce sont en revanche des préoccupations sanitaires et militaires, soit la protection des militaires contre les maladies vénériennes, qui conduisirent la Navy à décider en 1918 la fermeture de toutes les activités commerciales en rapport avec la sexualité à proximité des bases militaires.
Jack Jonhson, Charlie Chaplin, Chuck Berry, myRedBook…
L’histoire de l’application du Man Act est faite aussi de scories. Ainsi, son usage racialiste a été mis en cause à propos du boxeur Noir Jack Johnson lorsque ce dernier fut poursuivi et condamné en 1913 à une année et un jour de prison pour avoir transporté entre les États une femme Blanche dont la police et le tribunal ont considéré qu’elle était prostituée alors que le prévenu faisait valoir qu’elle était sa compagne. Edgar J. Hoover en fit par ailleurs un usage quelque peu « personnel » en 1943 lorsqu’il engagea une enquête sur Charlie Chaplin après l’action en reconnaissance de paternité formée contre le cinéaste par l’actrice Joan Barry. La suspicion du directeur du FBI sur le caractère illicite au regard du Mann Act de la relation entre Chaplin et Barry se nourrissait de ce que le cinéaste, pendant l’un de ses séjours à New York, avait fait parvenir de l’argent à Joan Barry à Los Angeles afin qu’elle le rejoigne. Le rapport préliminaire de l’agent spécial du FBI dit simplement : « Elle se rendit à New York et prit part à différentes réceptions auxquelles était convié Chaplin. Il est allégué qu’elle fut disponible à d’autres hommes et à des fins immorales ». D’autres personnalités du spectacle éprouveront rudement le Mann Act. Ainsi de Chuck Berry qui passa deux années en prison pour des déplacements interétatiques et à des fins immorales des femmes non mariées.
Le Mann Act s’est très tôt prêté à un débat sur la question de savoir si les prostituées concernées pouvaient elles aussi être poursuivies ou si elles devaient nécessairement être considérées comme étant des victimes. La Cour suprême a d’abord jugé en 1915 dans United States v. Holte que dans certaines circonstances et sous certaines conditions, une femme pouvait être poursuivie en tant que « co-auteur » de son propre transport ou déplacement. La Cour a nuancé sa position en 1932 dans Gebardi v. United States en jugeant que le consentement de la femme à son transport ou à son voyage ne suffit pas à la rendre coupable de violation de la loi, un rôle plus actif de sa part étant nécessaire.
La plus récente application notable du Mann Act date de 2015 avec la condamnation à treize ans de prison d’Ed Omuro le propriétaire du site Internet myRedBook qui, entre 2010 et 2014, a proposé aux Américains et aux Canadiens une offre prostitutionnelle ayant généré plus d’un million de dollars de revenus pour son propriétaire.
Le Nevada : vers la fin d’une exception ?
La répression fédérale de la prostitution va au-delà du Mann Act. Différents autres textes fédéraux, ceux réprimant le trafic des êtres humains, peuvent également s’appliquer à la prostitution. De la même manière que le droit fédéral réprime toute activité prostitutionnelle dans les dépendances publiques, notamment les bases militaires, ou qu’il interdit l’exercice de tout emploi public fédéral si le casier judiciaire du candidat compte une condamnation pour prostitution. Cette répression fédérale se superpose à la répression prévue par les lois pénales des États qui ne fait pas obstacle à l’existence d’arrêtés de police au niveau des comtés, avec des sanctions souvent plus sévères dans les comtés ruraux.
Le Nevada seul se départit depuis 1971 de la prohibition générale mais à cette nuance près que l’État laisse le soin à chacun de ses comtés de décider pour lui-même. Ce sont ainsi 12 comtés sur 16 qui admettent et réglementent la prostitution en leur sein. Loin des apparences tenant notamment à sa qualification de « ville du péché » (Sin City) et de l’existence de facto d’une importante prostitution, Las Vegas n’admet pas la prostitution. Plus exactement, le comté de Clark, dont dépend Las Vegas, n’a pas voulu compter parmi les comtés réglementaristes afin de préserver l’« image familiale » de la ville. Les comtés réglementaristes prévoient notamment que la prostitution ne peut avoir lieu que dans des brothels installés dans des lieux et des limites définis, qu’elle est assortie d’une autorisation administrative, que les prostituées doivent se prêter à des examens médicaux réguliers, que les rapports sexuels non protégés sont interdits.
L’un des plus importants propriétaires de brothels du Nevada, Dennis Hof, est une figure populaire en Amérique, son discours apologétique de la prostitution et réglementariste étant décliné dans ses nombreuses interviews dans les médias, dans une bande dessinée à succès qu’il a publiée en 2015, The Art of the Pimp, et dans un programme audiovisuel mi-téléréalité et mi-documentaire, Cathouse, diffusé par HBO. Le 17 mai 2012, Dennis Hof prononça une conférence à l’Université d’Oxford en faveur de la dépénalisation de la prostitution à l’échelle universelle. Autant son argumentation était-elle classique et comparable à celle qui a déterminé Amnesty International à recommander en 2015 la dépénalisation de la prostitution, autant son invocation du Nevada comme modèle était-elle paradoxale puisque la question contemporaine est plutôt de savoir si les brothels de l’État ne sont pas condamnés à disparaître du fait de la concurrence de l’offre prostitutionnelle en ligne et des « facilités » qu’elle procure, du fait encore de la caractérisation du Nevada par le FBI comme étant l’un des hauts lieux de la prostitution de mineures aux États-Unis, du fait enfin de l’apparition d’une nouvelle génération de décideurs politiques réfractaires à la prostitution.
Panique politique et policière
Comment tarir un phénomène alors que celui-ci semble prospère ? Cette question est posée aux responsables politiques et aux autorités de police, spécialement à New York et en Californie. Le débat porte d’abord sur les John Schools, ces écoles de « sensibilisation » fréquentées par des clients de prostituées au titre de mesure alternative à des poursuites pénales ou au titre de peine complémentaire à une condamnation pour sollicitation prostitutionnelle. Ces écoles font l’objet de critiques par certaines associations au motif qu’elles deviendraient un business lucratif pour ceux qui y professent. Le débat porte également sur la légitimité d’une « humiliation publique » des clients au moyen d’une publication des noms et des photos des individus mis en cause ou condamnés pour sollicitation prostitutionnelle en général, ou pour sollicitation prostitutionnelle de mineures en particulier. Les villes d’Orange et de San Bernadino le font déjà pour des personnes condamnées. Les villes de Fresno et d’Oakland le font pour des personnes interpellées mais n’ayant pas encore été jugées. La ville de Los Angeles en discute pour sa part depuis 2014.
L’existence d’un hubris policier dans la lutte contre la prostitution n’est pas moins discutée. Tel fut le cas à travers le débat sur le statut des préservatifs dans des poursuites pénales pour activité prostitutionnelle. À New York, il est tout à fait légal de circuler avec des préservatifs par devers soi. Toutefois, comme dans d’autres villes, la police excipait notamment de la présence de préservatifs pour légitimer une arrestation dans la perspective d’une poursuite pour prostitution, sans cependant que la présence de préservatifs puisse en elle-même fonder, ni une inculpation ni une condamnation pour activité prostitutionnelle. Au demeurant, dans les poursuites formées contre des prostituées ou des sex traffickers, la prostitution est rarement la seule incrimination mobilisée par le ministère public et celui-ci obtient dans la plupart des cas un plaider-coupable du prévenu sur le fondement d’incriminations autres que la prostitution. Or en juin 2013, les deux procureurs de New York qui s’occupent à eux seuls de l’ensemble de la prostitution dans la ville (le procureur du district de Nassau et celui du district de Brooklyn), ont décidé de suivre la politique des procureurs de San Francisco, en ne retenant plus les préservatifs saisis au titre des indices de l’activité prostitutionnelle. La police s’en est formalisée. Ainsi, ces procureurs ont fait leurs les arguments des défenseurs de la santé publique pour qui le traitement des préservatifs comme preuve pénale a un effet réfrigérant sur la disposition des prostituées à s’en servir et peut ainsi accélérer la propagation de maladies sexuellement transmissibles. De l’autre côté, la police considère que l’efficacité de son action risque d’être considérablement affectée si elle n’avait plus à sa disposition la saisie de préservatifs comme ressource procédurale…
À lire aussi sur nonfiction.fr :
Tous les articles des Chroniques américaines
Bibliographie sélective :
![]()
 The Barbary Coast: An Informal History of the San Francisco Underworld
The Barbary Coast: An Informal History of the San Francisco Underworld
Thunder’s Mouth Press, 2002
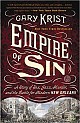 Empire of Sin. A Story of Sex, Jazz, Murder, and the Battle for Modern New Orleans
Empire of Sin. A Story of Sex, Jazz, Murder, and the Battle for Modern New Orleans
Gary Krist
Crown Publishers, 2014
 The Great Southern Babylon
The Great Southern Babylon
Alecia P. Long,
The Louisiana State University Press, 2004
 Storyville, New Orleans: Being an Authentic, Illustrated Account of the Notorious Red Light District
Storyville, New Orleans: Being an Authentic, Illustrated Account of the Notorious Red Light District
Al Rose
The University of Alabama Press, 1978
