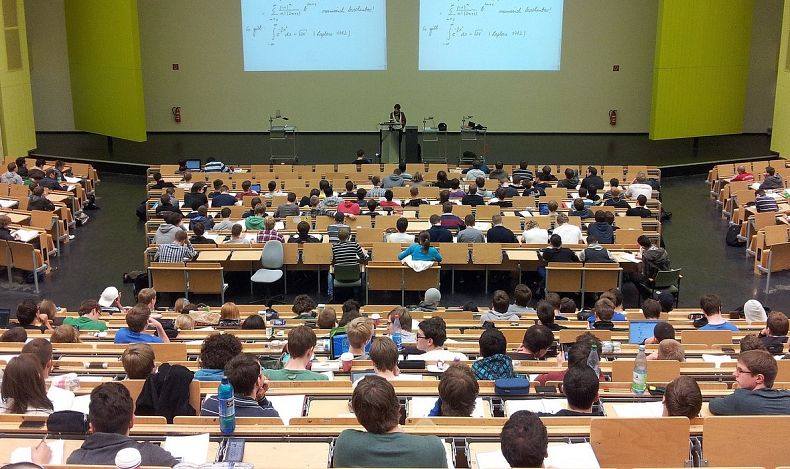Une enquête stimulante explore comment l’écologie s’intègre (ou ne s’intègre pas) dans l’enseignement supérieur et peut être l'occasion de réinventer l'apprentissage à partir des marges.
Présenté comme un « petit manuel de résistance », cet ouvrage est une invitation à la mise en mouvement. Il naît d’un compagnonnage : celui de Baptiste Lanaspeze, fondateur des éditions Wildproject, essayiste attentif aux paysages et aux formes d’engagement, et de Marin Schaffner, anthropologue de formation, traducteur, auteur d’ouvrages sur les écologies politiques. Deux figures qui observent, depuis plus d’une décennie, les reconfigurations de la culture écologique en France, depuis le terrain, depuis les marges.
Faire école autrement
Ce livre ne cherche pas à convaincre. Il invite. Non pas à résister au changement, mais à le rendre possible, à l’imaginer, à le désirer. Ce n’est pas un appel à la révolte, c’est une proposition de lucidité. À une époque où l’enseignement de l’écologie semble gagner toutes les strates de l’université, des écoles d’ingénieurs aux facultés de médecine, des sciences politiques aux écoles d’art et d’architecture, ce court texte rappelle que la transition académique, loin d’être acquise, reste profondément ambivalente.
L’ouvrage repose sur une enquête menée entre 2020 et 2023 dans une douzaine d’établissements d’enseignement supérieur. Des centaines d’étudiant·e·s, d’enseignant·e·s, de chercheur·se·s ont été interrogé·e·s. L’ambition est modeste en apparence : documenter ce qui s’invente, se cherche, se débat, à l’intérieur et surtout en marge de l’université. Mais la portée est plus vaste. Car ce que révèle cette enquête, c’est un écart : entre le discours institutionnel et la réalité des formations, entre les mots employés et les idées qu’ils recouvrent, ou qu’ils effacent.
L'écologie sans le mot « écologie »
Une analyse sémantique minutieuse des intitulés de licences, de masters, et de leurs enseignements montre un paradoxe révélateur : le mot « écologie » est quasiment absent. Ce sont d’autres vocabulaires – « environnement », « durabilité », « gestion » – qui dominent. Comme si l’écologie véritable, en tant que pensée des interdépendances, en tant que science des relations, restait inassimilable par l’appareil académique. Invisibilisée, diraient les auteurs. Pas niée, mais contournée. Pas ignorée, mais neutralisée.
Cette occultation n’est pas qu’un détail lexical : elle dit quelque chose de profond sur la manière dont l’université continue de fonctionner, sur ce qu’elle juge pensable, respectable, transmissible. Comme si enseigner l’écologie supposait, avant tout, de ne pas en parler trop directement.
Des savoirs en marge qui redessinent le centre
Là où le livre devient précieux, c’est lorsqu’il cartographie les initiatives nées aux lisières de l’institution : création de revues, de maisons d’édition, de formations transversales, d’ateliers d’écologie politique. Le tout impulsé par des enseignants-chercheurs qui, de plus en plus nombreux, refusent de choisir entre leur engagement citoyen et leur activité scientifique.
Ces lieux, ces revues, ces programmes expérimentaux, dessinent les contours d’un autre espace académique. Non pas hors de l’université, mais à sa frontière – un seuil où se croisent les humanités environnementales, les sciences sociales, les récits de territoire, les luttes écologiques. Une écologie qui ne se contente pas de décrire le monde, mais tente d’y habiter autrement.
Changer les savoirs, pas seulement les contenus
La critique centrale du livre est claire : on ne peut pas enseigner l’écologie sans remettre en cause les formes mêmes de production et de transmission des savoirs. Le modèle disciplinaire, hérité de l’époque moderne, hiérarchise les sciences, valorise l’abstraction, la théorie, le quantifiable – au détriment du sensible, du relationnel, du local. L’écologie, à l’inverse, demande une science poreuse, hybride, ancrée. Elle appelle à un renversement : non pas additionner des modules verts aux cursus existants, mais repenser la finalité même de l’enseignement supérieur.
L’ouvrage convoque ici des penseurs comme Bruno Latour, Isabelle Stengers, Philippe Descola, Deborah Bird Rose, Christophe Bonneuil ou Émilie Hache pour ouvrir une brèche dans l’université. Une brèche par où s’infiltrent d’autres récits, d’autres manières de faire école. Celles qui assument l’éthique de la lenteur, l’attention au vivant, la critique de la performance, et l’envie de co-apprendre – avec des étudiant·e·s, mais aussi avec des habitant·e·s, des savoirs pratiques, et des territoires en lutte.
Si le ton de l’ouvrage est sobre, presque sage, c’est qu’il ne cherche pas à dénoncer, mais à révéler. Il ne s'agit pas de dire que rien ne se fait, mais que ce qui se fait se fait souvent malgré les cadres, en dehors des schémas, et dans une logique de débrouille fertile. Le mot « résistance » y prend un sens neuf : plutôt que l’opposition frontale, la persistance à faire autrement. À montrer que ce qui semble impossible est déjà en cours.
Le format choisi – un carnet de notes, fragmentaire, annotable, presque brouillon – participe de cette volonté : ouvrir un chantier, non clôturer un discours. Inviter chacun à y ajouter sa page, sa note, sa voix.
Mais qui enseigne l’écologie ? est un livre qui fait ce qu’il dit. Il ne se contente pas d’analyser le champ académique : il y prend part, en décalage. Il ne réclame pas la révolution, mais il en donne à voir les signes – discrets, mais puissants. Il rappelle qu’on n’enseigne pas l’écologie comme une matière de plus, mais comme une manière de vivre, de penser, d’apprendre en commun. Et que cela commence, peut-être, par sortir de la salle de classe.