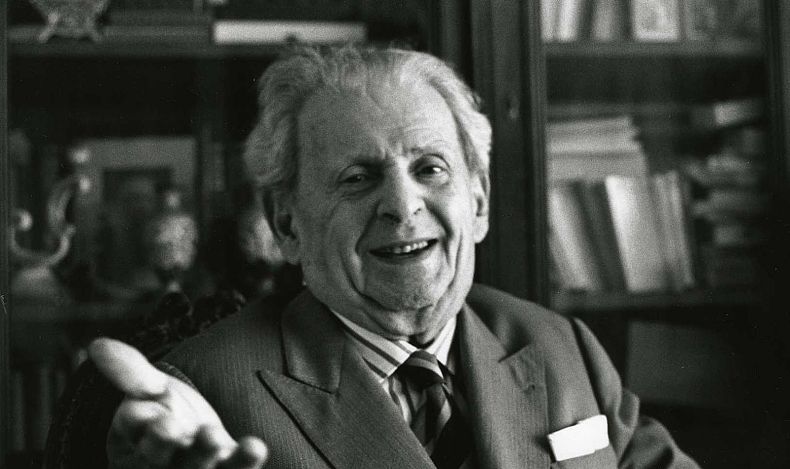Ce volume des œuvres de Levinas présente les documents relatifs à l’écriture et à la réception de son premier chef d’œuvre, "Totalité et infini".
Après avoir rendu disponibles un certain nombre de textes importants pour comprendre la genèse de la pensée d’Emmanuel Levinas, la publication du quatrième volume de ses Œuvres offre au lecteur des documents plus tardifs que ceux des précédents volumes et qui sont consacrés à l’élucidation du contexte de rédaction et de réception de Totalité et infini, publié en 1961. Quatre grandes parties éclairent chacune l’œuvre d’une lumière particulière.
Les versions successives
Le fonds « Emmanuel Levinas » de l’IMEC contient sept documents pouvant être considérés comme des versions préliminaires de Totalité et infini, ainsi que deux ensembles intermédiaires. Il y a des dactylogrammes, des manuscrits et des jeux d'épreuves corrigées. Tout ceci est présenté dans l’introduction à la première partie de ce volume, intitulée « Genèse et génétique des différentes versions de Totalité et infini ». Du projet qui a finalement abouti à l’œuvre publiée, le dactylogramme intitulé L’Être extérieur est une version séminale datée par les éditeurs de 1954-1955, à laquelle succède une autre version du texte, intitulée Le Tout ou l’infini. Essai sur l’extériorité de l’Être, datée des années 1958-1959. La présentation des différents manuscrits est claire et très pratique, dans la mesure où ce qui diffère de ce qui sera l’œuvre publiée est écrit en italiques, ce qui permet, par contraste, de voir ce qui a disparu de l’œuvre au cours de son élaboration.
Il ne saurait être question de relever ici tout ce qu’enseigne la comparaison entre ces différentes versions. Contentons-nous simplement de signaler la relative importance de l’argent dans l’Être extérieur (six occurrences) par rapport à la version définitive (une seule occurrence), ce qui permet d'accréditer la thèse d’un Levinas non seulement marqué par la phénoménologie allemande mais également inspiré par la pensée matérialiste marxiste, comme le montre encore l’importance de la réflexion sur la propriété dans les textes préparatoires. On trouve également des thèmes qui seront absents ou nettement moins développés dans l’ouvrage de 1961, mais qui seront ultérieurement repris par Levinas. Ainsi de l’analyse du vieillissement dans certaines versions préparatoires. On aperçoit aussi la présence textuelle explicite de la philosophie de Martin Buber, à laquelle Levinas consacrera un certain nombre de textes, dans une version dont la date est estimée à 1957.
La publication de ces travaux préparatoires successifs ouvre un champ de recherche important à la critique génétique, permettant de mieux comprendre comment Levinas construit sa pensée et comment il philosophe.
De nouveaux inédits
Les volumes précédents des Œuvres de Levinas contenaient des témoignages de lecture, des notes diverses, qui permettaient de comprendre d’où provenaient certaines analyses de Levinas. La section de l’ouvrage intitulée « Inédits autour de Totalité et infini » regorge d’éléments intéressants pour celui qui cherche à comprendre comment ou de quoi naît la philosophie de Levinas. On y trouve notamment des passages recopiés du Cas Wagner de Nietzsche, un passage de la Lettre philosophique 25 de Voltaire ou du 2e Entretien sur la métaphysique de Malebranche.
Outre ces témoignages de lectures jugées suffisamment importantes par Levinas pour être recopiées ou discutées, on trouve des fragments d’analyse de Levinas qui, souvent dans une forme resserrée et elliptique, condense un argument important qu’il pourra développer plus ou moins longuement ou un raccourci saisissant de sa pensée. Ainsi, quand il écrit : « Dans ma conception il y a une place pour le matérialisme : le besoin matériel de l’Autre est sacré – il constitue même toute (?) ma spiritualité », le lecteur mesure combien sont erronées les interprétations de la pensée lévinassienne trop idéalistes, qui ne font pas droit à la matérialité et à la dimension corporelle de son éthique.
Sont aussi publiés des textes dans lesquels Levinas discute de conceptions par rapport auxquelles il se situe. Un long fragment s’efforce ainsi de démarquer la méthode et l’objectif de l’entreprise philosophique de Levinas par rapport à la tradition idéaliste, et ce de façon imagée, à partir d’une réflexion sur la lumière : « Notre ambition consiste en un sens à définir la lumière à partir de ce qui n'est pas lumière. Partir du sujet comme l'idéalisme c'est déjà se donner la connaissance et la lumière. Partir d'un fait quelconque, c'est partir également d'un objet connu et, par conséquent, dans un autre sens, se donner déjà la lumière. On peut certes poser la lumière comme fait premier – et cela est commun à l'idéalisme et au réalisme – mais ce serait précisément refuser le problème de la lumière comme problème. On peut adopter cette attitude, mais ce serait arrêter la recherche ».
On trouve également, comme dans de nombreux textes de Levinas, l’esquisse d’un débat – ou d’un affrontement – avec Heidegger. Ainsi, alors qu’Heidegger définit le Dasein comme un étant pour lequel « il y va en son être de cet être » et « l’être-au-monde » comme « souci », Levinas écrit précisément, dans un extrait d’une conférence sur le vouloir : « Il y a dans la volonté du bonheur autre chose que la Sorge préoccupée d’être. L’homme est un être qui ne se soucie pas de son être. Il est jeunesse et insouciance qui ne représentent pas simplement une fuite devant l’essentiel, mais la valeur de la vie humaine. Le vouloir n’est pas vouloir d’être mais vouloir de choses qui donnent un prix à cet exister nu. De l’exister s’occupe l’instinct, mais du bonheur – la volonté. Elle est volonté de contenus. Réduit à la pure existence, comme l’existence des ombres qu’aux enfers visite Ulysse, l’être ne peut plus stimuler la volonté ». Cet extrait (parmi tant d’autres) rappelle que la description au cœur de Totalité et infini est loin d’être neutre : en décrivant comme il le fait le déploiement de l’être et son économie, Levinas prend aussi implicitement et polémiquement position contre certains points de la description heideggérienne du Dasein.
Inédits sur Franz Rosenzweig
Dans un troisième moment, ce quatrième volume des Œuvres de Levinas, donne à lire les textes que Levinas a écrits sur Franz Rosenzweig (1886-1929), le philosophe allemand qui a grandement influencé sa pensée. La recherche s’en tenait aux trois textes sur Rosenzweig que Levinas a publiés dans trois ouvrages différents et à la phrase connue de Totalité et infini : « L’opposition à l’idée de totalité nous a frappé dans le Stern der Erlösung de Franz Rosenzweig, trop souvent présent dans ce livre pour être cité. » On « savait » que Rosenzweig avait exercé une influence déterminante sur la pensée de Levinas, mais sans savoir ce qui, de Rosenzweig, avait été lu par Levinas, ni dans quelle édition, et encore moins à quel moment.
Ce volume vient combler ces lacunes en fournissant les Notes de lecture prises par Levinas dans l’édition allemande de l’Étoile de la Rédemption (initialement parue en 1921) et d’autres textes (issus des Kleine Schriften), ainsi que des ébauches de textes écrits par Levinas sur le philosophe juif allemand. On y voit que Levinas ne s’est pas contenté de lire l’œuvre de Rosenzweig mais qu’il a également pris des notes sur ses principaux commentateurs comme J. Guttman, ou N. Glazer. On apprend également que Levinas s’intéresse à certains aspects déterminés de la pensée de Rosenzweig, comme le rôle de la religion, mais également son rapport à l’existentialisme.
Soutenance de thèse
La dernière partie du livre est consacrée aux documents relatifs à la soutenance de thèse de Levinas, le 6 juin 1961, qui porte notamment sur Totalité et infini. À cette occasion, Levinas revient sur la signification de certains termes qu’il emploie sans jamais les définir aussi précisément. C’est notamment le cas du féminin, du visage, etc. On comprend que c’est la lecture de textes de Dostoïevski (dont l’importance dans la formation intellectuelle de Levinas ne saurait être surestimée) qui décide Levinas à définir comme il le fait le désir d’infini. Un passage noue clairement le désir à l’amour à l’aide des mots de la Torah : « Nous avons cherché à surprendre la bonté à partir du Désir, afin de conserver à la bonté sa source subjective – Et cela s’atteste dans le phénomène : où la bonté est comme un besoin et où l’exercice de la bonté est comme une passion. Il y a comme une souffrance pour la bonté de ne pas avoir de caresses pour se satisfaire par-delà les actes. Dans la Bible hébraïque, le terme qui sert à exprimer l’amour de Dieu pour ses élus Deut. 7,7 ; Deut. 10… ou dans le Psaume "Il m’a désiré" est le même qui désigne le désir du guerrier pour la femme captive. »
Levinas reconnaît certaines filiations entre certains penseurs et lui-même. Il reconnaît sa dette à l’égard de Gabriel Marcel et de Martin Buber, et formule précisément le lien qui l’unit à Heidegger, dans une formule qui pourrait caractériser toute sa philosophie : « il représente un génie absolument hostile [...] à une tradition dont je suis l’un des témoins. » Et il explique les raisons pour lesquelles il refuse un certain nombre de principes heideggériens :
« Mon livre proteste contre cette signification de l’être. Certes, derrière les objets et avant les objets il y a le langage de la culture. Mais derrière le langage de la culture – et avant lui – se révèle le visage.
Dans la splendeur anonyme de la nature – où tout est au neutre –, dans l'enracinement paysan ou payen qu'elle atteste, se loge la cruauté à l'égard des hommes et une indifférence éthique – l'impassibilité devant la souffrance des hommes dans la tendresse pour les arbres et les chiens. Dans la neutralité de l'être de l'étant, je vois l'indétermination de l'élémental.
Il me souvient de cette personne qui trouvait affreuse la guerre de 1939-45, car la cathédrale de Rouen avait été endommagée par les bombardements anglais, déformant affreusement sa ville natale et la paix de ce paysage certainement irremplaçable. Je pense que l'on peut vivre dans un monde où la cathédrale de Rouen ou même le temple de Jérusalem sont endommagés ou détruits [...]. Mais je pense qu'il est difficile de vivre après les camps de la mort. »
Enfin, dans une lettre de 1965, il confie à Jacques Derrida ses doutes sur la question de savoir si la philosophie heideggérienne peut être exemptée de toute suspicion de complicité avec le nazisme, dans une formule là aussi mémorable : « A-t-il toujours été fidèle à lui-même ? Est-il sûr notamment qu’il le resta à l’Unheimlichkeit de Sein und Zeit sans s’être laissé contaminer, dans son Lieu de la dernière manière, par Blut und Boden ? »
La parution de ce nouveau volume des Œuvres, qui a dû demander un immense travail, apporte au chercheur ou à celui qui veut comprendre comment et pourquoi Levinas écrit ce qu’il écrit, des matériaux pour étancher sa curiosité, en complément de ce qu’avait déjà apporté la publication d’autres textes de jeunesse, ou de captivité, du philosophe.