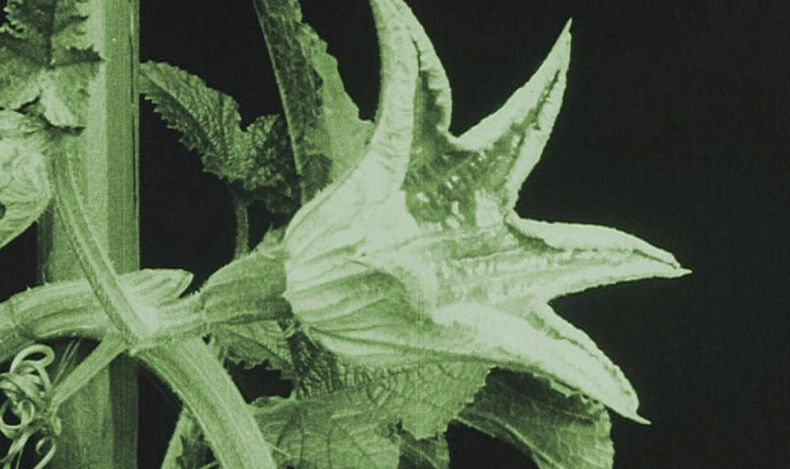Inspiré par l'anthropologie perspectiviste, le dernier ouvrage de Jean-Michel Durafour propose de fonder une iconologie "au-delà de l’humain".
Fusion entre l’esthétique et les théories de l’écologie et de la biologie, l’éconologie s’annonce comme un renouvellement de l’iconologie en proposant de penser l’image comme une forme de vie non-organique. Une telle démarche permet d’attirer l’attention sur le phénomène des images, souvent délaissé dans les débats sur l’écologie, en choisissant de les considérer non plus comme une série d’artefacts produits par l’homme mais comme un tissu de relations dont nous ne pouvons percevoir que certaines facettes. Loin de se cantonner au seul domaine des études cinématographiques, auquel la première partie est davantage consacrée, l’ouvrage s’inscrit dans des débats très actuels sur la problématique distinction entre l’humain et le non-humain, ou encore sur les rapports que nous entretenons avec les images à l’ère de la cybernétique et du biopouvoir.
La vie cristalline des images
Le fait d’attribuer une vie propre aux images n’est pas une idée neuve, comme Jean-Michel Durafour le rappelle en évoquant entre autres le mythe de Pygmalion. Toutefois force est de constater que le concept de vie que l’on attribue aux images reste dans la plupart des cas celui d’une vie imaginaire : dans le Pygmalion, par exemple, l’image n’est jamais vraiment vivante puisque l’on passe directement d’une image inerte à un être vivant ; autrement dit, le mythe rapporté par Ovide dans ses Métamorphoses suggère l’existence d’une césure entre l’image et le vivant.
L’auteur revient d’ailleurs sur les théoriciens qui ont posé les premiers jalons pour une théorie de la vie des images, et octroie à ce titre une large place au travail de W. J. T. Mitchell, fondateur américain des Visual Studies. En effet, s’il critique sa conception métaphorique de la vie des images, Durafour insiste néanmoins sur l’avancée théorique que son travail représente dans le domaine des études visuelles. Mitchell est en effet l’un des premiers à penser l’image en dehors de toute production humaine – notamment, dans What do Pictures Want ? (2005), quand il propose de comparer les images à des virus auxquels l’homme, en les accueillant, permet de se reproduire.
Toutefois, dans cet ouvrage, Durafour cherche à aller plus loin, en choisissant d’accorder aux images, selon ses propres mots, une « vie plénière ». Pour cela, il dérive son concept de « vie » du mode d’existence des cristaux, car tout comme les cristaux, les images vivent « en donnant l’impression de ne vivre pas » (p. 158). Aussi propose-t-il de nommer « vie cristalline » cette vie des images pleine et entière.
Dé-familiariser l’image
L’attribution d’une vie plénière aux images est ce qui lui permet de penser l’image autrement que comme une chose cantonnée au seul fait humain. En effet, l’image est selon lui pensée le plus souvent sur le seul mode anthropocentrique, soit dans sa seule relation aux humains. C’est la critique principale adressée à l’iconologie post-warburgienne. Durafour affirme en effet qu’une partie de l’image n’est pas accessible à l’homme, et qu’elle a une vie autonome qui, littéralement « ne nous regarde pas ».
Pour bien faire entendre son propos, le théoricien propose de recourir au concept de « l’images », au pluriel, pour connoter que ce que nous voyons et nommons n’est pas l’image « en soi », mais seulement une facette de l’image que nous avons pu percevoir. Pour construire ce marchepied théorique essentiel, Durafour s’appuie sur l’Object Oriented Ontology, projet philosophique qui propose une approche anticorrélationniste des objets, c’est-à-dire qui ne se limite pas aux capacités spatio-temporelles de représentation de la conscience humaine.
Jean-Michel Durafour reprend ici à son compte la critique du corrélationnisme telle qu’elle est formulée par certains penseurs du réalisme spéculatif comme le philosophe Quentin Meillassoux, qui désigne par-là la primauté exclusive qui fut accordée, au moins à partir de Kant, à la relation entre la pensée humaine et l’objet.
Dans le court chapitre intitulé « Le tumulte adamant des objets », Durafour retrace d’ailleurs notre mode d’approche de l’objet depuis l’époque de ce penseur, sans oublier d’évoquer les acquis de la phénoménologie de Husserl et de ses successeurs. Tout l’enjeu est ici justement de parvenir à « défamiliariser » notre pensée, afin de pouvoir envisager l’idée selon laquelle une part seulement de l’image nous est accessible.
À cet égard, Jean-Michel Durafour emprunte aussi le concept d’hyperobjet à Timothy Morton, l’un des principaux théoriciens de la philosophie orientée vers l’objet, afin de qualifier « l’images ». Elle est selon sa restitution « une entité supradimensionnelle à laquelle l’être humain n’a accès que partiellement et par fronts d’intersection avec son monde » (p. 244). Ce concept qui permet de penser des objets débordant l’espace et le temps humain permet alors de saisir l’image non plus comme une simple chose que notre regard serait en mesure de surplomber, mais comme un ensemble de relations susceptibles de dépasser l’humain.
Une ontologie relationniste
La possibilité d’envisager l’image comme une relation ne doit pas être comprise comme un geste corrélationniste. En effet, l’auteur s’en prémunit dès les premières pages et précise que relation et corrélation sont à distinguer : « Dans la corrélation, l’un des deux termes ne peut pas être pensé sans cet autre-ci. Au contraire, le relationnisme, en affirmant que tout être n’est que parce qu’il est en relation (…) permet aussi de penser qu’il puisse toujours exister d’autres relations pour un terme que celle qu’il a avec un autre terme, et que donc rien d’aussi clos et monodirectionnel que la corrélation, notamment la corrélation hommes-objets, ne saurait imposer ses seules lois. On peut nombrer d’autres relations, entre objets, entre images, sans passer par la médiation constitutive de l’homme (…) » (p. 18).
Cette pensée de l’image comme relation découle de l’important travail de relecture des travaux de théoriciens de l’écologie et de la biologie auquel s’est livré l’auteur. Ce sont ces fondations qui vont permettre de préciser le sens de la théorie éconologique, et de mieux déterminer le concept d’image comprise comme une forme de vie.
Dans un important passage intitulé « Écologie », Jean-Michel Durafour revient sur les travaux en écologie relationniste de l’écologue japonais Kinji Imanishi. Ce dernier se distingue radicalement des théories darwiniennes en ce qu’il considère que puisque les milieux et les êtres vivants proviennent par « différenciation d’une même unité germinative », ils sont en conséquence radicalement inséparables les uns des autres. Chaque être pourrait donc être pensé comme un développement à partir d’un même élément primordial : « l’être vivant et son environnement ne forment qu’un, et cela même représente le véritable être vivant » (p. 201).
Ainsi, être en vie ne se réduit pas à avoir un organisme. C’est à partir de ce concept de vie que Durafour pense l’image éconologique, et c’est ce qui lui permet d’affirmer que « la véritable image est l’image et son iconotope » (p. 204), soit l’image et l’« environnement iconique hébergeant l’iconocénose (autres images, théories scientifiques, doctrines religieuses, systèmes philosophiques, produits culturels, etc.) ». Ceci implique que les images influent sur leur environnement tout comme les êtres vivants « s’écospécient » le leur.
(N.B. : Le concept d’écospécie est la traduction qu’Augustin Berque propose du concept de « sumiwake », central dans les travaux de Kinji Imanishi, désignant l’unité concrète que chaque espèce forme avec son milieu. Il permet d’envisager que les êtres vivants sont aussi eux-mêmes à l’origine de leur évolution. En d’autres termes, comme l’explique Durafour, p.207 : « Non seulement le développement d’un animal ou d’une image est dépendant de sa connexion à des choses, autres êtres vivants ou non, qui lui sont extérieures (…), mais cette dépendance précède ces individus eux-mêmes. Mieux : elle les fait. »)
Une critique de l’iconologie
Tout ceci mène à une discussion avec la discipline inspiratrice. Pour Durafour, l’iconologie post-warburgienne a en effet le tort de reposer sur un concept imaginaire de la nature des images, selon un régime subordonné au critère de la ressemblance. Or : « Ne s’attacher qu’aux images apparentes, que l’on rapproche ou éloigne par leur plus ou moins de ressemblance, est encore une manière trop répandue de se contenter paresseusement de pratiquer l’iconologie. L’éconologie propose une autre attitude devant les images. » (p. 227)
L’éconologie permet donc de pointer du doigt un problème assez récurrent des études cinématographiques, qui consiste à penser les images selon des critères purement réductibles à leur apparence, notamment du fait d’une mauvaise compréhension de la théorie warburgienne. Alors que la notion de « Nachleben », de survivance, est souvent rapprochée de l’idée d’héritage, Durafour invite à l’apparenter plutôt à celle d’hérédité. En effet, si l’on comprend l’idée de la survivance comme un héritage, l’on risque de la comprendre comme une forme de succession, alors que selon Durafour, il s’agit d’une transmission, qui, selon ses mots, « ne procède pas selon la relation de cause à effet, unique et rectiligne, mais par constellations généalogiques » (p. 170)
Le projet warburgien est donc à comprendre à nouveau frais, avant tout comme celui de la vie des images, notamment grâce au concept de migration des formules de pathos (Pathosformeln), d’une époque à l’autre, d’un espace géographique à l’autre, plutôt que comme pensée de la trace et de la mémoire en ce sens romantique.
Finalement, l’éconologie de Durafour est un geste qui vise à retrouver le véritable projet warburgien, celui d’une « iconologie décérébrée ou acéphale » (p. 240). Car, pour Durafour, le projet de Warburg est justement celui d’un geste théorique à la fois anticorrélationniste et relationniste. C’est en effet lui qui, selon l’auteur, a ouvert la voie à une théorie de la vie des images et de la vie des figures en tant qu’indépendantes des hommes.
C’est en fait par une comparaison inspirée de l’anthropologie amérindienne que Durafour explicite l’ambition de l’éconologie : « L’équivalent de la décolonisation amérindienne de l’anthropologie est la déshumanisation éconologique de l’iconologie. » (p. 257)
Il revient à ce titre dans Cinéma et cristaux sur l’anthropologie perspectiviste, à travers notamment une relecture des importants ouvrages d’Eduardo Viveiros de Castro (Métaphysiques cannibales, 2009) et de Philippe Descola (Par-delà nature et culture, 2005). En effet, l’anthropologie perspectiviste fournit à l’éconologie un modèle selon lequel l’humain peut « quitter son point de vue d’être humain pour embrasser celui d’un non-humain. » (p. 251)
La question que Jean-Michel Durafour souhaite poser avec l’éconologie peut en somme se résumer de la manière la suivante : « Que se passe-t-il lorsque nous demandons aux images ce qu’est l’iconologie? » (p. 257) Le travail novateur de Jean-Michel Durafour est donc l’occasion de faire le point sur ce que la notion de forme de vie nous permet d’envisager de nouveau dans les images et sur ce que l’étude attentive des images permet d’apporter en retour aux élaborations théoriques prenant pour objet la forme de vie. Elle propose aussi une réinterprétation originale du geste inaugural de l’iconologie, dans le sens d’une théorie non plus humaniste, mais désanthropocentrée.
Échos et prolongements
Le projet éconologique de Jean-Michel Durafour n’est pas sans rappeler les préoccupations de certains artistes visuels contemporains, comme Trevor Paglen, qui s’est intéressé aux « images invisibles » qui peuplent notre environnement. Dans un article paru en 2016 sur le magazine en ligne The New Inquiry, « Invisible Images (Your Pictures Are Looking at You) », il soutenait que depuis une dizaine d’années la culture visuelle était devenue « détachée des yeux humains », soit largement invisible, notamment depuis le développement d’algorithmes (comme ceux de Facebook par exemple), qui consistent, pour le dire simplement, en ce que des machines produisent des images pour d’autres machines. Cette théorie pourrait aller dans le sens de l’éconologie, en ce qu’elle admet que l’humain peut être radicalement exclu de la production des images.
Or, si Paglen conservait une distinction problématique entre la culture visuelle humaine et la culture visuelle machinique, l’éconologie cherche justement à dépasser ce clivage. En effet, comme le rappelle à plusieurs reprises Jean-Michel Durafour, il ne faut pas se méprendre et penser que l’au-delà de l’humain ne concernerait plus l’humain. Au contraire, « il implique le très humain, non seulement parce que seul l’humain peut poser la question de l’au-delà de l’humain, mais surtout parce que les images sont également prises dans les réseaux que nous tissons, nous humains. » (p. 267)
L’étude de la vie des images pourrait alors apparaître comme le moyen d’ouvrir une brèche dans le champ de l’esthétique en la défamiliarisant, permettant ainsi de penser un « Ouvert » qui remettrait en question les problématiques distinctions entre humain et non-humain, sujet et objet, nature et culture.