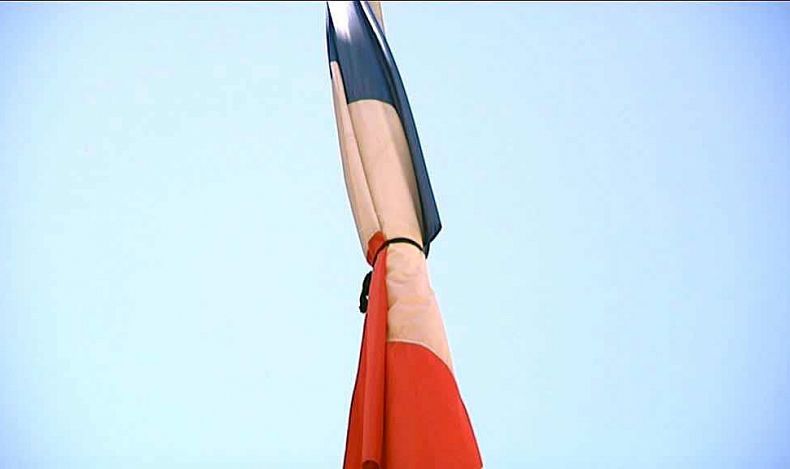L’essayiste américain David Rieff explore les failles de la mémoire collective et en appelle à réhabiliter l’oubli, sans lequel on ne peut pas laisser place à l’avenir.
Si le titre accrocheur du dernier ouvrage de l’essayiste américain David Rieff peut surprendre, le sous-titre, beaucoup plus précis, annonce d’emblée la thèse principale du livre : la mémoire collective, intégrant aussi bien les souvenirs partagés que les commémorations officielles, renferme des pièges et des risques de natures aussi variées que la récupération politique, la fausse impartialité, la favorisation du ressentiment, ou encore la réactivation des guerres et des inimitiés. Dans ce livre paru en 2016 et traduit récemment en français, il s’agit donc moins de faire l’éloge pur et simple de l’oubli que de mettre en exergue les failles et les excès du souvenir collectif et d’appeler, par conséquent, à un traitement de la remémoration à la fois plus vigilant et mieux adapté aux différents contextes historico-politiques.
Le premier chapitre de l’ouvrage s’ouvre sur une lecture du célèbre poème « For the Fallen » du poète anglais Laurence Binyon, composé en 1914 suite aux pertes conséquentes dans les rangs de l’armée britannique au début de la Première Guerre Mondiale. Scandé régulièrement lors des commémorations en Angleterre et en Australie, ce poème « quasi officiel du souvenir » est généralement suivi, en réponse, d’un « Pour que l’on oublie pas », issu d’un poème de Kipling et révélant, selon Rieff, « une douloureuse reconnaissance de l’inévitabilité d’un tel oubli ». Partant de cet exemple, l’auteur rappelle que l’oubli constitue la fin inexorable des êtres humains, des nations et des civilisations, en somme une réalité incontournable qu’il s’agit de reconnaître et d’accepter.
Pour l’auteur, ce constat devrait éclairer les faiblesses de la mémoire collective, surtout celle relative aux conflits. D’un côté, la mémoire collective est façonnée de manière unilatérale par les vainqueurs, ce qui crée un déséquilibre évident. En l’absence de vainqueurs, le conflit s’étend même souvent au terrain mémoriel. D’un autre côté, l’importance historique d’un événement demeure une donnée relative et fragile : même les événements les plus terribles de l’histoire finiront, selon Rieff, par être oubliés et céderont leur place à de nouveaux souvenirs. L’auteur en conclut que « l’on ne peut être tyrannisé par un passé dont les coordonnées culturelles et historiques nous sont entièrement étrangères » : la remémoration suppose un lien dont l’absence ou l’affaiblissement rend le souvenir inopérant.
Une construction sociale et potentiellement négative
Les sept chapitres suivants développent cet argument principal à partir de différentes perspectives: la déformation du passé, l’utilité supposée de la mémoire collective, les rapports entre mémoire et histoire et entre pardon et oubli, le souvenir des traumas et ses effets, les vertus éventuelles de l’oubli et les excès potentiels de la remémoration.
En s’appuyant sur les travaux du sociologue français Maurice Halbwachs, Rieff rappelle que la remémoration est « une construction sociale » dont la nature varie en fonction des sources collectives du travail de mémoire. L’auteur prend pour exemple le cas de l’Irlande où il pointe le processus d’identification aux idées de lutte et de reconstruction de la nation, largement dominantes dans l’imaginaire collectif. A la suite d’Ernest Renan selon lequel l’oubli et l’erreur historique seraient « un facteur essentiel de la création d’une nation », Rieff explique que dans le domaine de la mémoire collective, la fabrication des mythes répond certes à un besoin de sécurité, mais demeure, selon lui, un processus instable, objet de mutations et créateur de compromis.
La compréhension du mode de fonctionnement de la mémoire collective passerait également, comme le montrent les travaux de l’historien britannique Eric Hobsbawm, par l’étude des modes d’imagination, d’invention et de renouvellement des traditions. Puisant dans son expérience de reporter lors des conflits des années 1990 aux Balkans, Rieff observe que la mémoire historique collective, loin de contribuer à la réconciliation, a plutôt nourri le ressentiment et la rancœur des belligérants. Plus de vingt ans plus tard, la montée des nationalismes en Europe et la persistance des foyers de conflits au Moyen-Orient auraient largement bénéficié de cette dynamique négative.
De l’(in)utilité de la remémoration
Dès lors, l’ouvrage pose une question fondamentale : dans quelle mesure peut-on affirmer que la remémoration est (in)utile dans une époque marquée par une accélération généralisée de l’histoire, rythmée par les évolutions technologiques, les progrès scientifiques et la circulation des peuples ? Rieff observe que le registre le plus courant de la remémoration est celui du « plus jamais ça ». Par ailleurs, la mémoire collective est trop souvent évoquée « comme si elle pouvait être comparée à la mémoire individuelle ». Or, insiste-t-il, « le monde ne se souvient pas ; les nations non plus ; et pas plus les groupes et les collectifs ». L’acte de remémoration serait fondamentalement individuel et ne garantirait en aucun cas l’immunité collective face à la résurgence du mal.
Pour étayer son propos, Rieff s’appuie sur les travaux de plusieurs penseurs ayant souligné les risques d’une mauvaise utilisation de la remémoration, dont Avishai Margalit et Tzvetan Todorov. Si le premier a raison de plaider en faveur d’« une éthique du souvenir », il omet de souligner la réalité politique qui sous-tend la remémoration et l’oubli. En France, les travaux de Pierre Nora et d’autres ont montré que l’étude de l’histoire est souvent mise au service de la mémoire, et ce dans un contexte où l’incursion du politique vient, selon Rieff, annihiler toute visée éthique. L’Etat se retrouve ainsi à jouer le rôle d’intermédiaire dans un processus d’élaboration et de transmission de la remémoration.
Avec beaucoup d’énergie, Rieff s’attaque également aux idées plus ou moins répandues selon lesquelles le souvenir serait une forme de « responsabilité » alors que l’oubli serait l’expression d’une « irresponsabilité ». Partant d’une réflexion sur le devenir d’une remémoration telle que celle de la Shoah, Rieff alerte sur le risque de basculement dans le « kitsch » ou d’accélération de l’instrumentalisation politique au point de créer, dans les mots de l’historien américain Tony Judt, « une mauvaise morale et une mauvaise histoire ». Quel que soit le contexte, plaide l’auteur, la remémoration doit toujours obéir à des règles d’exigence et d’exactitude qui n’admettent en aucun cas la recherche d’un profit politique ou d’un opportunisme moral.
Désacraliser la mémoire collective
A plusieurs reprises, Rieff explique que la pratique de la remémoration demeure tributaire de facteurs stratégiques et d’éléments exogènes incontrôlables. En intervenant sur le passé, la remémoration agirait souvent comme « un adhésif toxique » permettant de « cimenter les vieilles haines recuites et d’opposer les unes aux autres les diverses martyrologies en vigueur ». A ceux qui considèrent, comme les philosophes Emil Fackenheim et Yosef Hayim Yerushalmi, que l’oubli peut mener à une catastrophe morale, Rieff répond que la mémoire collective fonctionne de son côté « comme une sorte d’échappée, une sorte d’idylle, en fournissant une caution morale à la nostalgie » qu’il juge problématique.
Selon lui, la sacralisation de la mémoire collective peut mener à un phénomène encore plus grave, à savoir la déformation des réalités historiques au profit des logiques de solidarité politique ou de regroupement stratégique. Le développement de l’industrie de la mémoire s’accompagne par un recul de la maîtrise de l’histoire. En s’éloignant de la rigueur historique, la remémoration fonctionnerait au mieux comme « une consolation », au pire comme « une façon de se vautrer dans le passé » et de promouvoir « l’automythologisation ». Ainsi, l’appel de Rieff à désacraliser la mémoire collective se double d’une défense de « la faisabilité d’une communauté d’oubli ». En réponse à Todorov, dont il salue la contribution majeure à la mise en lumière des abus de la mémoire, Rieff appelle à considérer la façon dont l’oubli collectif pourrait donner forme au désir commun d’éthique.
Mémoire, justice et paix
L’un des arguments majeurs du livre s’appuie sur l’idée que si la remémoration est « peut-être l’alliée de la justice », elle n’est pas « une amie fiable de la paix » : se souvenir ne permettrait pas toujours la réconciliation ou le rétablissement des libertés. A titre d’exemple, Rieff rappelle qu’après l’ère franquiste, la transition démocratique en Espagne s’est appuyée sur le « Pacto del olvido », loi d’amnistie instituée au lendemain de la mort de Franco. Selon l’auteur, l’oubli peut servir d’étape intermédiaire vers l’apaisement, à la fois pour éviter les risques de nouvelles dérives et pour préparer une période plus propice à la remémoration. Ainsi, pour Rieff, les Balkans, l’Irlande, ou encore le Moyen-Orient sont des zones géographiques où il faudrait « cesser de prôner la remémoration et louer les vertus de l’oubli ». Dans d’autres pays, tels que le Sri Lanka, la Colombie, ou l’Ukraine, il faudrait, selon lui, « penser à autre chose qu’aux victoires, défaites, blessures et rancunes ».
Dans le dernier chapitre de l’ouvrage, intitulé non sans provocation « Contre la remémoration », l’auteur part de l’exemple du mémorial officiel du 11 septembre aux Etats-Unis pour rappeler qu’un mémorial est « un lieu dédié à la solidarité plutôt qu’à la subtilité, à la déférence plutôt qu’à l’esprit critique, à la piété plutôt qu’à la réécriture de l’histoire ». Pour Rieff, néanmoins, le texte détaillant la mission du mémorial et réaffirmant la détermination américaine à « préserver la liberté » dans le monde n’est pas sans faire écho à la politique extérieure belliqueuse de George W. Bush. Cet exemple révèle de nouveau que le « fantôme » de la politique s’invite toujours dans les remémorations en y manipulant à la fois le souvenir et son devenir. Sortir de ce piège nécessite, selon l’auteur, de délimiter les périodes de remémoration, de prôner une approche critique et non mystique de l’histoire et d’en finir avec le dénigrement de l’oubli car, dans les mots de Nietzsche, « l’oubli n’est pas seulement une vis inertiae, comme le croient les esprits superficiels ; c’est bien plutôt un pouvoir actif ».
Faiblesses d’un plaidoyer
Malgré sa défense vigoureuse de « l’impératif éthique de l’oubli », l’ouvrage de Rieff souffre de plusieurs faiblesses. En tant que prolongement d’un autre « essai polémique sur la mémoire collective », le livre alterne l’analyse rigoureuse et la formulation provocante. Ce choix nuit souvent à la clarté du propos, déjà atteinte par le manque d’une structuration claire de l’ouvrage, l’absence d’une définition précise des mots-clés, et la répétition excessive des mêmes idées ou arguments à quelques pages d’intervalle. Une autre faiblesse concerne l’accumulation des citations qui vire souvent au « name-dropping », au risque de perdre par moments le lecteur. Certes, le mérite de l’auteur est d’avoir su puiser non seulement dans les textes des écrivains (Shakespeare, Shelley, Kipling, Beckett, Gordimer, Miłosz) et les travaux des historiens (Trevor-Roper, Halévy, Vidal-Naquet, Riley-Smith, Le Goff, Cannadine) mais aussi dans les contributions de disciplines aussi variées que la sociologie, l’anthropologie ou encore la science politique. Ceci étant, l’érudition de Rieff finit par obscurcir la thèse qu’il défend et ne favorise pas toujours la lecture attentive et la compréhension aisée de ses arguments.
Au niveau du contenu, si Rieff a raison de souligner les failles et les excès de la mémoire collective, il ne défend pas toujours cet équilibre nécessaire, qu’il appelle pourtant de ses vœux, entre mémoire critique et oubli actif. Quand il avance par exemple que les mémoires collectives ne sont des mémoires « que sur le seul mode métaphorique », il minimise la réalité vécue et l’ancrage social du souvenir partagé. Plus généralement, en mettant sur le même niveau d’analyse des expériences de remémoration aux contextes et aux enjeux distincts, il contredit en quelque sorte son propre appel à faire preuve de vigilance et de discernement lors du traitement de la mémoire collective. Par ailleurs, en avançant qu’en matière de remémoration, « le critère ultime ne devrait pas être l’idéal mais le raisonnable, ou du moins le faisable », Rieff oublie de souligner que ce type de pragmatisme peut mener à l’amnésie collective et à la perte définitive de ces mêmes repères éthiques qu’il s’évertue à vouloir préserver. Enfin, quand il prône l’introduction d’« une proportion décente de commun oubli » suivant les cas, il omet de préciser les modalités de mise en place d’une telle mesure à l’échelle collective, ainsi que les problèmes potentiels qu’elle soulèverait sur le plan aussi bien éthique que politique.
Le lecteur de ce plaidoyer déroutant en vient à se demander : et si Rieff se trompait de combat ? Sans basculer dans l’oubli, même actif, ne pourrait-on pas repenser et réinventer la mémoire collective ? A l’ère de la communication numérique et de la montée des pensées obscurantistes, la priorité serait peut-être non pas de tenter une réhabilitation de l’oubli, mais de promouvoir des modes de remémoration alternatifs, à la fois pédagogiques, interactifs et instructifs, favorisant l’échange et l’esprit critique, et réduisant au mieux les distances entre les attentes individuelles et les enjeux collectifs. Une meilleure maîtrise de l’Histoire peut difficilement favoriser ou justifier l’oubli. A l’inverse, elle encouragerait aussi bien l’acquisition et la transmission des savoirs mémoriels que la lutte contre les excès et les abus du souvenir collectif : une remémoration critique et vigilante vaut peut-être mieux que bon nombre d’oublis.