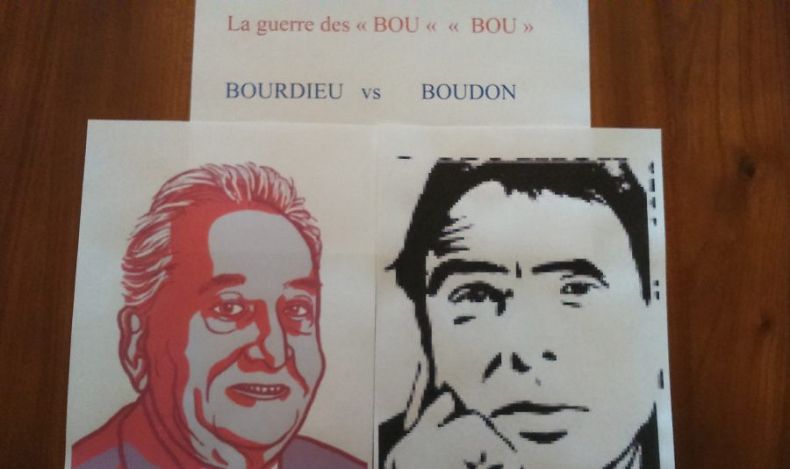Une critique du déterminisme sociologique appuyée sur de récentes avancées des neurosciences.
Le danger sociologique a déjà fait beaucoup parler de lui. On y a vu un pendant, s’agissant de la sociologie, au pamphlet de Cahuc et Zylberberg qui dénonçait l’an passé le « négationnisme économique ». Dans les deux cas, les auteurs revendiquent pour eux-mêmes une pratique scientifique de leur discipline, pour les uns de l’économie, pour les autres de la sociologie, et dénoncent d’autres manières de la concevoir qu’ils estiment non fondées et dangereuses.
De quelques aberrations et dérives sociologiques
Pour Cahuc et Zylberberg, le danger en question consistait en de mauvaises préconisations de politique économique. Pour Bronner et Géhin, il consiste, en premier lieu, dans une déconsidération de la sociologie, et l’introduction de leur livre donne ainsi quelques exemples de dérives lamentables (Michel Maffesoli et Edgar Morin sont ainsi épinglés), mais qui sont bien connues et qui ne trouveraient que peu de défenseurs chez les sociologues.
Le point suivant fera davantage débat. Pour Bronner et Géhin, ces dérives s’expliquent par un mode de raisonnement explicatif erroné, même si celui-ci peut correspondre à la croyance spontanée des acteurs, qui attribue « l’origine des phénomènes sociaux à des entités hypothétiques, douées d’un pouvoir causal, éventuellement même d’une intentionnalité » . La montée en généralité qu’ils opèrent ici permet aux auteurs d’élargir leur critique à toute explication des phénomènes sociaux qui mobiliserait des entités extérieures aux acteurs, qui les contraindraient à agir d’une certaine façon, et irait dans certains cas jusqu’à leur attribuer une intentionnalité. Comme lorsque Loïc Wacquant écrit à propos des prisons qu’elles permettent à l’Etat de réguler le marché du travail dans une logique néo-libérale ou, plus globalement (de manière tout de même beaucoup moins évidente à notre avis, au moins lorsque l’on parle de la société ou du capitalisme), chaque fois que des sociologues adoptent une explication finaliste des inégalités sociales en expliquant que celles-ci sont plus ou moins sciemment produites par « « la société », « le capitalisme », « le patronat », « les riches », etc. » .
Sans tomber dans ce dernier travers, recourir, à des fins explicatives, à de telles entités collectives pourrait être le moyen de prendre en compte telle ou telle forme de domination sociale, ou tout autre phénomène social, qu’il serait impossible d’expliquer autrement. Il pourrait en aller ainsi du « genre » en particulier, sur lequel les auteurs se penchent alors, si l’on admet que le fait que les femmes soient partout (plus ou moins) tenues pour mineures, inférieures et subordonnées, ne puisse s’expliquer par des différences biologiques. D’où l’importance pour Bronner et Géhin de contredire ce dernier point, sur lequel ils suivent, expliquent-ils, l’anthropologue Françoise Héritier, pour qui les conditions faites aux femmes restent malgré tout enracinées dans les différences biologiques. Ce qui leur permet de critiquer vertement Christine Delphy qui adopte une position contraire, et en effet plutôt extrémiste . Mais surtout de suggérer que l’amélioration de leur situation devrait plus à l’invention de la pilule contraceptive qu’aux études sur le genre . Le ton est donné et l’on n’est en effet pas loin du pamphlet.
Ce tour de piste des aberrations se termine par l’évocation de la charge de Manuel Valls, alors Premier ministre, contre « ceux qui cherchent en permanence des excuses et des explications culturelles ou sociologiques à ce qu’il s’est passé » et les réactions que cette déclaration avait alors suscitées. Et les auteurs d’expliquer que celui-ci n’avait probablement pas tout à fait tort, au motif, tout d’abord, qu’il s’était trouvé au moins un sociologue (Geoffroy de Lagasnerie) pour affirmer publiquement rejeter la distinction entre expliquer et juger, et affirmer qu’« Excusez, c’est un beau programme de gauche » . Mais surtout, parce que la dénonciation du libre arbitre comme une illusion, au nom du déterminisme social auquel adhèrent de nombreux sociologues, nous disent Bronner et Géhin, alimente sans aucun doute l’idée d’une irresponsabilité des acteurs (on y reviendra plus loin). Bernard Lahire avait répondu à cette déclaration de Manuel Valls et à quelques autres par un ouvrage, Pour la sociologie , que Bronner et Géhin épinglent pour son rejet du libre arbitre . Le déterminisme social, expliquent-ils, fait peu de cas de la manière dont les individus agissent en réalité et s’accorde bien mal avec la connaissance que l’on a acquise du cerveau humain. Il empêche de prendre « conscience de la forte imprédictibilité de la vie sociale et de bien rendre compte des changements qui se produisent au sein d’une société humaine » .
Ce débat au sein de la sociologie est ancien, il oppose classiquement Durkheim à Weber, le holisme et le déterminisme social du premier à l’individualisme méthodologique du second. Et les tenants de la sociologie cognitive (ou analytique comme préfèrent l’appeler les auteurs), fermes partisans de Weber, Boudon en tête, ont depuis longtemps cherché à montrer que Durkheim lui-même avait été obligé d’admettre, au moins dans sa pratique de la sociologie, qu’un déterminisme strict n’était pas tenable. C’est l’objet du premier chapitre.
Déterminisme social vs individualisme méthodologique
Les arguments de Durkheim en faveur du déterminisme méritent d’être rappelés. Ils consistent dans le fait que, même s’il est l’addition d’individus animés de leurs intentions propres, un ensemble social acquiert une autonomie par rapport à ceux-ci. Une idée qui se trouve confortée à la fois par la variété, les variations et la complexité que présentent ici ou là les institutions et par la contrainte que celles-ci exercent sur les individus .
Pour autant, Durkheim serait loin d’avoir réussi à bannir de sa sociologie toute référence à la subjectivité des acteurs. Les auteurs en prennent pour exemple le jugement que celui-ci porte sur le crime dans Les Règles de la méthode sociologique, où il aurait été forcé de reconnaître que les institutions laissent aux individus des possibilités d’innovation, sans quoi il serait impossible de concevoir le progrès social. Ou encore, l’explication que celui-ci donne dans Le Suicide du « suicide anomique », où un affaiblissement de la contrainte morale donnant libre cours aux désirs individuels se traduit par une montée de l’insatisfaction des individus.
Le chapitre suivant expose le programme de la sociologique analytique. Pour ses tenants, dont Max Weber est sans aucun doute le plus célèbre, les phénomènes sociaux étant produits par les actions humaines, il faut pour les expliquer comprendre les acteurs, autrement dit montrer les raisons pour lesquels ils ont agi ou agissent de telle ou telle manière. Cela à l’exclusion de toute autre méthode qui ferait abstraction de la signification humaine.
Les auteurs mêlent toutefois, en cherchant avant tout à se démarquer de Durkheim des considérations dirigées contre le déterminisme de celui-ci et de ses successeurs (ils reviennent notamment sur le caractère irréaliste d’entités collectives susceptibles de causer les phénomènes sociaux) et une présentation du programme de la sociologique analytique, ce qui fait que cette dernière est alors quelque peu décousue .
Ils écartent la critique d’un soi-disant psychologisme que l’on fait parfois à cette méthode, qui requiert simplement - même si les sociologues doivent se mettre pour cela d’une certaine façon à la place des acteurs - d’appréhender leurs motivations communes, liées à la nature humaine ou, pour le dire autrement, à des catégories universelles de pensée et de conduite , sans avoir à se préoccuper de leur personnalité. Cela en tirant la conséquence de ce que les actions individuelles ne produisent de faits sociaux (mais aussi économiques ou politiques si l’on suit les auteurs) que par l’intermédiaire de leur agrégation, un phénomène qui n’a rien de psychologique en lui-même .
Ils rappellent la nécessité de procéder, dans la recherche de ces motifs, à une réelle imputation causale. Il est en effet indispensable, comme Weber y insistait, de soumettre les interprétations significatives, envisagées tout d’abord à titre d’hypothèses, à toutes les vérifications possibles, en ayant recours aux mêmes moyens que ceux que l’on utilise à propos de n’importe quelle autre hypothèse.
Ce programme préserve le libre arbitre et la responsabilité morale qui lui est associée. Il rejette en effet l’idée que la socialisation, toute aboutie qu’elle soit, produise des acteurs qui seraient conditionnés par leur environnement au point que toutes leurs actions leur seraient dictées par ce conditionnement. Il relie la possibilité des actions collectives à l’acceptation des acteurs d’opérer selon des règles communes, qui sont aussi, précisent-ils, des règles habilitantes. Et rend pensable, expliquent-ils, le changement de ces règles et l’innovation, ou encore la possibilité de les interpréter ou d’arbitrer entre elles quand cela se révèle nécessaire. Sans être du tout désocialisé (même s’il tire également une partie de son apprentissage de son expérience du monde en général ), l’acteur de la sociologie analytique est ainsi supposé agir ou tout du moins pouvoir agir de manière autonome, dans les limites de ses connaissances et de ses capacités, et parfois des biais cognitifs (que Gérald Bronner a beaucoup contribué à introduire en sociologie) dans lesquels il peut tomber, et compte tenu des contraintes émanant du contexte .
Même s’il est essentiellement question dans ces deux chapitres de Durkheim et de Weber, ce sont les successeurs de Durkheim que Bronner et Géhin cherchent à atteindre à travers leur critique du déterminisme du premier. Il s’agit principalement, comme cela devient évident plus loin, de Pierre Bourdieu et potentiellement d’une grande partie des sociologues qui se réclament de lui (sans que d’autres noms ne soient donnés cependant) et, alors qu’il est lui nommément désigné à plusieurs reprises, de Bernard Lahire, qui se signale en effet par un déterminisme tout particulièrement revendiqué, mais dont il n’irait toutefois pas complètement de soi qu’il bannit toute initiative des acteurs, d’autant qu’il s’en défend, y compris dans l’ouvrage que Bronner et Géhin prenait pour cible dans l’introduction : « La sociologie ne dit pas que des choix ne sont pas faits, que des décisions ne sont pas prises ou que les intentions ou les volontés sont inexistantes. Elle dit seulement que les choix, les décisions et les intentions sont des réalités au croisement de contraintes multiples. Ces contraintes sont à la fois internes, faites de l’ensemble des dispositions incorporées à croire, voir, sentir, penser, agir forgées à travers les diverses expériences sociales passées, et externes, car les choix, les décisions et les intentions sont toujours ancrés dans des contextes sociaux et parfois formulés par rapport à des circonstances sociales » . Et encore : « On confond souvent le déterminisme avec le caractère prévisible des événements. Or il va de soi que les sciences du monde social ne mettent pas en évidence des « causalités » simples, univoques et mécaniques qui permettraient de prévoir avec certitudes les comportements […]. Ce sont au mieux des probabilités d’apparition de comportements ou d’événements qui sont calculées [une phrase que citaient également Bronner et Géhin, mais qui s’arrêtaient là]. Deux raisons expliquent cette impossible prévision, même si cela ne remet pas en cause l’existence des déterminismes : d’une part l’impossibilité de réduire un contexte social d’action à une série finie de paramètres pertinents, comme dans le cas d’expériences physiques ou chimiques, et d’autre part la complexité interne des individus dont le patrimoine de dispositions […] est plus ou moins hétérogène, composé d’éléments plus ou moins contradictoires. Difficile, par conséquent, de prédire avec certitude ce qui, dans un contexte spécifique, va « jouer » ou « peser sur chaque individu et ce qui, des multiples dispositions incorporées, va être déclenché dans et par le contexte en question. » . Ce qui fait tout de même une dénonciation : soit très générale, et on peut se demander s’il n’aurait pas été nécessaire de donner d’autres illustrations des dérives que les auteurs prétendent pointer ; soit très personnelle, mais qui cadre alors mal avec le danger grave qu’ils croient pouvoir signaler, et aurait dans tous les cas nécessité un examen plus approfondi des arguments de Bernard Lahire.
Plus troublant encore, alors que l’opposition entre Durkheim et Weber a déjà été jouée un nombre considérable de fois, est le fait que Bronner et Géhin se sentent autorisés à passer complètement sous silence les travaux destinés à rendre plus compatibles entre elles les leçons que l’on devrait pouvoir retenir de ces deux principaux fondateurs de la sociologie , et plus largement le fait qu’ils passent également complètement sous silence les nombreux travaux d’épistémologie des sciences sociales qui ont cherché à évaluer les différents modèles d’explication qui pouvaient avoir cours en sociologie, notamment en faveur d’un certain pluralisme , comme si ceux-ci n’avaient jamais existés. Une caractéristique, soit dite au passage, que les auteurs partagent également avec Cahuc et Zylberberg, critiqués sur ce point par André Orléan , sans doute pour la même raison : ni les uns ni les autres ne croient à la vertu du pluralisme méthodologique. Rapprocher les points de vue ou tout du moins les rendre comparables n’est alors plus possible qu’en adoptant une position extérieure à celle qu’illustre cet ouvrage .
Cerveau et libre arbitre
Le dernier chapitre mobilise les résultats des sciences cognitives à l’appui du programme de la sociologie analytique. C’est la principale contribution originale du livre, elle vise à montrer que ces résultats confortent précisément un tel programme. Elle s’y emploie comme précédemment en démarquant celui-ci du déterminisme sociologique.
Les tenants du déterminisme social ont parfois tendance à se méfier des neurosciences, écrivent les auteurs, même si la conception de l’habitus de Bourdieu, comme celui-ci en était conscient, est parfaitement compatible avec certaines des théories que développent les chercheurs en neurosciences autour des processus d’implémentation des réseaux neuronaux par expérience.
Des progrès récents des neurosciences tendraient toutefois à montrer que la conscience peut réinvestir, lorsque les circonstances nous y incitent, des objets mentaux habituellement vécus sur le mode non conscient (même si cela se révèle plus consommateur d’énergie), pour procéder à leur réévaluation ou à des arbitrages . Il ne faudrait pas en conclure que ce mécanisme conduit à des décisions ou des choix toujours parfaitement cohérents. Il paraît en effet désormais bien établi que l’individu doive composer avec une multitude d’injonctions d’une grande diversité, étant lui-même le sujet d’une concurrence intra-individuelle constante . Mais cela ne doit pas nous amener à voir celui-ci comme un personnage uniquement balloté par les influences contradictoires de ses modes de socialisation passés, qui s’exprimeraient tour à tour selon les circonstances, comme le préconisent les sociologues déterministes tels que Bernard Lahire . Il importe en effet, pour la sociologie, expliquent Bronner et Géhin, de reconnaître cette instance d’arbitrage, à base de réévaluation des situations passées et d’imagination des situations futures, qui est au cœur du fonctionnement de notre cerveau. « D’une façon générale, l’une des caractéristiques de la vie mentale des êtres humains est la plasticité intellectuelle, le pouvoir de mettre en sourdine certaines routines, d’en choisir d’autres, et de revenir sur un raisonnement ou sur une préférence. » . C’est ce qui rend « imprédictibles [au sens où ceux-ci ne seraient pas dictés par les circonstances et ne relèveraient donc pas du déterminisme] les phénomènes mentaux de haut niveau que sont l’évaluation des arguments, la planification des objectifs, la résolution des dilemmes moraux, l’adoption d’une représentation du monde ou d’une autre… qui sont précisément les objets auxquels s’intéressent habituellement les sciences sociales » .
Pour illustrer le faible intérêt dans de telles situations des explications déterministes, les auteurs comparent les taux de criminalité des deux villes de Saint-Denis et Annecy, où celles-ci sont bien en peine d’expliquer pourquoi ces taux, qui vont pourtant du simple au double, laissent autant d’habitants qui respectent la loi . Pour qui n’aurait pas compris où ce raisonnement conduit, ce qui pourrait d’autant plus facilement se vérifier que l’ouvrage - ce qui est un autre problème - compte très peu d’exemples d’explications qu’aurait apportées la sociologie cognitive, cet exemple pourrait bien constituer un choc…
Nul doute, dans l’esprit des auteurs, qu’une explication qui prenne en compte, outre les variables sociales, des invariants mentaux est plus adaptée pour rendre compte d’une telle situation . Mais l’argument n’est pas neuf. Boudon faisait déjà remarquer que la plupart des individus en provenance de milieux défavorisés ne commettaient aucun acte de délinquance.
Précision importante, les auteurs souhaitant écarter un malentendu expliquent à la suite ne pas chercher à sauver avec ce programme la notion philosophique de « liberté » ou l’idée selon laquelle la personnalité ou le « vrai moi » d’un individu serait logé dans son cerveau. Ils ne font que s’interroger, disent-ils, sur la fiction intellectuelle la plus efficace pour rendre compte des phénomènes qui intéressent la sociologie, l’acteur social tel que défini ci-dessus leur semblant bien placé pour cela .
Ceux-ci s’expliquent également sur le fait de ne pas réduire cet acteur (même considéré comme une fiction) à ses déterminants biologiques, comme seraient portés à le faire assez naturellement des neuroscientifiques. « Il faudrait pour cela que l’infra-individualisme ait fait la démonstration de sa capacité à ramener les phénomènes mentaux, en particulier les phénomènes intellectuels centralisés de haut niveau, à des entités de niveau ontologique inférieur » . Ce qui, à supposer que cela soit possible, n’est clairement pas le cas aujourd’hui. Les neurosciences en sont plutôt, pour l’instant, à inventer des concepts intermédiaires censés relier ces deux réalités.
Une pente glissante
La suite revient sur la question déjà rencontrée à plusieurs reprises, qui constitue en quelque sorte le fil rouge du livre : la multiplication des entités collectives à laquelle s’adonneraient les sociologues déterministes. Peut-être les auteurs n’insistent-ils pas alors suffisamment sur la spécificité qui consiste à mobiliser de telles entités à des fins d’explication, au sens fort, des phénomènes sociaux. Car il paraît sinon évident que des entités collectives sont devenues indispensables au travail de la sociologie et des sciences humaines en général et qu’une partie très utile de ce dernier porte aujourd’hui précisément sur leur analyse et clarification, comme pourrait l’illustrer par exemple, pour ne pas prendre cet exemple en sociologie, un numéro récent de la revue Cahier d’histoire consacré à l’Etat.
Si le réductionnisme procède ainsi pour la dimension infra-individuelle, comme on l’a vu à l’instant, ces sociologues procèdent alors de même pour la dimension supra-individuelle, ne cessant, à la suite de Durkheim, d’inventer des entités collectives au statut ontologique indéfini censées expliquer les phénomènes sociaux. C’est ainsi le cas, par exemple, des « champs » tels que les définit Bourdieu (alors que le concept d’habitus avait plus ou moins réussi à échapper à la critique des auteurs) et auxquels il prête, à tort selon eux, une influence causale déterminante . L’hypercomplexité des phénomènes sociaux conduit ces chercheurs « à manipuler sans précaution des entités collectives, comme le pouvoir, l’Etat ou la classe, etc., pour rendre compte de certaines tendances statistiques, dont ils finissent parfois par croire qu’elles sont porteuses de causes et donc d’explications, allant même, dans certains cas, jusqu’à leur attribuer des desseins » , comme déjà indiqué précédemment. Ce que les auteurs relient alors au « biais d’agentivité » qui nous fait attribuer des intentions à toutes sortes d’entités qui en sont dépourvues. Michel Foucault en particulier est critiqué pour ses analyses de la prison dans Surveiller et Punir comme le moyen d’exercer pour la société ou le pouvoir, au profit d’un groupe dominant, un contrôle toujours plus serré des populations. De même que Bourdieu, à nouveau, pour son recours abusif, cette fois, à l’expression « Tout se passe comme si… », sans distinguer suffisamment entre la part de la fiction et l’intention réelle ainsi prêtée à ces entités (en l’illustrant toutefois d’une longue citation finalement peu compréhensible ). Ou encore pour des déclarations, datant de la période de son engagement politique, où l’intention paraît effectivement imprudemment imputée cette fois à ce type d’entités, où il est question de « préparation de l’avènement d’une sorte de gouvernement mondial » .
S’ils exonèrent en partie Bourdieu de l’accusation de conspirationnisme , les auteurs ne se privent pas d’affirmer que « La théorie de la domination qu’il a en partie constituée est […] une matrice dans laquelle certains peuvent trouver les moyens de donner à des constructions idéologiques les apparences de la scientificité. Il existe un continuum cognitif ou, si l’on veut, une pente glissante entre la convocation inconséquente d’entités collectives, le biais d’agentivité, le finalisme, les arguments du cui prodest (à qui profite le crime) et les théories du complot. Cela ne signifie pas que tous s’engagent sur cette pente ; certains l’évitent, d’autres freinent car ils craignent la chute, d’autres la suivent sans se soucier de savoir où cela les mène » . Et, en tout cas, cela dessert alors la sociologie.
Peut-être les auteurs auraient-ils dû donner ici une caractérisation plus précise de ces différents stades, de manière à ce que l’on sache à quoi s’en tenir. Ils ont préféré insister pour finir, peut-être à tort, sur un autre inconvénient de ce type d’explications déterministes, car, à les en croire, certains publics dont elles prétendent expliquer les conduites pourraient subir leur influence. Nous avons tendance à nous attribuer nos succès mais à attribuer nos échecs à des facteurs externes, notent-ils, et ces théories renforcent alors cette tendance. C’est en tout cas ce que sembleraient corroborer certaines expériences de psychologie sociale , qui tendraient à montrer que la lecture de textes déterministes (sic) rendrait davantage enclin à frauder ou favoriserait les tendances à l’agressivité et altérerait le sentiment de compassion et la volonté d’aider autrui ; il ne semble toutefois pas que l’expérience ait été menée à ce jour avec les œuvres complètes de Pierre Bourdieu, mais sans doute cela pourrait-il être la prochaine étape. On se souvient dans le même ordre d’idée que les étudiants en économie seraient plus enclins à se montrer égoïstes. Encore cela dépend-il sans doute de la façon dont celle-ci est enseignée. Bronner et Géhin n’hésitent pas à extrapoler ces résultats, arguant que leurs destinataires pourraient trouver dans ces théories un motif de réduire leurs efforts, en particulier lorsque leurs conditions sociales rendraient en effet ceux-ci d’autant plus nécessaires . Ce qui pourrait ainsi contribuer aux moins bons résultats des enfants issus de l’immigration. A l’exception notable des enfants originaires de l’Asie du Sud-Est, élevés, toujours selon les auteurs, dans l’idée que l’excellence scolaire est possible mais qu’il faut faire des efforts pour l’atteindre. « L‘inégalité des chances est un fait, mais elle s’accroît beaucoup si les individus se lancent dans la vie persuadés que les jeux sont faits » , où il faut sans doute voir un (important) résultat de la sociologie cognitive.
La sociologie de la domination, qui caressait l’espoir que faire prendre davantage conscience de celle-ci contribuerait à la réduire, aurait donc tout faux, elle ne ferait au contraire que démotiver ceux auxquels elle s’adresse. Mais peut-être conviendrait-il de chercher à vérifier plus avant cette interprétation, comme Weber l’aurait probablement recommandé, à moins qu’il n’en écarte l’hypothèse dans un grand rire, allez savoir. Après tout, n’a-t-il pas consacré lui-même une partie de ses travaux à l’analyse de la domination ?
Bronner et Géhin rappellent en conclusion la nécessité de distinguer, toujours en se réclamant de Max Weber, les jugements de science et les jugements de valeur et en déduisent alors la nécessité de renoncer, pour la sociologie, à batailler contre les « structures » et les déterminismes sociaux pour se recentrer sur l’établissement et la compréhension des faits sociaux . Ainsi, les choses sont claires… Ce qui pourrait être fait en utilisant en particulier la grande quantité de données rendues disponibles par le web, dont toutes sortes d’amateurs font aujourd’hui leur miel et dont des sociologues, désormais mieux pensants, pourraient sans aucun doute s’emparer . A lire avec des pincettes