Intervenue au terme d'une année marquée, en France, par les débats sur la déchéance de nationalité et sur le burkini, l'élection de Donald Trump scelle-t-elle le fractionnement définitif des démocraties occidentales?
Dans la première partie de ce long entretien, l'historien Patrick Weil, auteur du Sens de la République, analysait sur le long terme les causes des sentiments de désaffiliation vis-à-vis de la communauté nationale qui se manifestent aussi bien dans le radicalisme musulman que dans le repli identitaire dont bénéficie le FN.
Dans cette seconde partie, il analyse les effets des événements les plus récents, de l'attentat contre Charlie Hebdo à celui de Nice, au gré desquels la capacité des différentes composantes de la Nation à cohabiter semble s'être durablement fissurée.
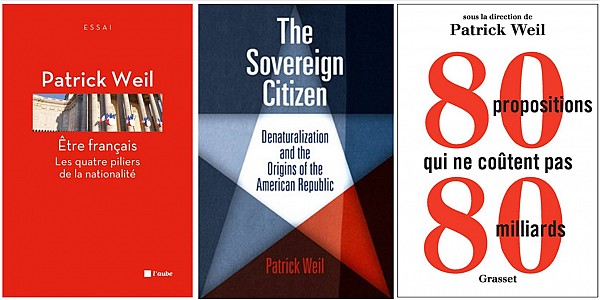
Nonfiction : Vous ouvrez Le Sens de la République (Grasset, 2015) sur les grandes manifestations de soutien à Charlie Hebdo qui ont eu lieu dans toute la France le 11 janvier. Pendant quelques jours, la France a été le centre de gravité du monde, mais derrière ce que certains ont appelé « l’unanimisme républicain » se sont nichées des voix divergentes. L’ouvrage d’Emmanuel Todd, Qui est Charlie ? Sociologie d’une crise religieuse (Seuil, 2015), en est la meilleure illustration puisque pour ce dernier, l’union sacrée n’était qu’un paravent qui masquait les fractures béantes de la société française. Quelle est votre interprétation de ces grandes manifestations ?
Patrick Weil : Je ne partage pas l’analyse d’Emmanuel Todd sur les manifestations du 11 janvier. Quatre millions de manifestants sont descendus dans les rues ce jour-là. Un chiffre certes inégalé mais relatif au regard de la population totale du pays. J’étais présent à ces manifestations et j’ai pu constater que tout le monde n’était pas là. Mais c’est le Financial Times qui a publié l’enquête la plus pertinente sur les très nombreux motifs de cette absence. Ils pouvaient avoir un sentiment de honte qu’on puisse les associer à ces tueurs.
L’absence pouvait aussi couvrir d’autres motifs. Certains ne pouvaient dire « je suis Charlie » car ils désapprouvaient les caricatures du prophète Mahomet. D’autres encore refusaient de manifester aux côtés de Benjamin Netanyahou, même si 44 autres chefs d’État et de gouvernement y étaient aussi. D’autres ont eu peur de se rendre à la manifestation ; ou parfois, quand ils ont voulu y aller, ils ont rebroussé chemin, telle cette Lyonnaise de confession musulmane, voilée, qui, confrontée à des regards inamicaux sur son trajet pour rejoindre le cortège a préféré rentrer chez elle.
Le sentiment de malaise n’est pas corrélé à la présence ou non à ces manifestations. Une partie de nos compatriotes juifs qui étaient là se disaient : il n’y aurait pas eu quatre millions de personnes dans les rues si seuls les quatre juifs du supermarché Hypercacher avaient été tués. Leur raisonnement n’était pas vraiment fondé : il n’y aurait pas non plus eu 4 millions de personnes dans les rues si c'est 12 caricaturistes inconnus qui avaient été exécutés.
Parmi les tués, il y avait en effet Cabu et Wolinski, deux dessinateurs que les Français connaissaient et aimaient. Deux figures avec lesquelles des millions d’entre eux avaient grandi à travers des émissions de télévision populaires, et qui les avaient accompagnés plus tard dans Paris Match, L’Humanité, le Canard enchainé, le JDD et bien sûr Charlie Hebdo, qui était finalement la moins lue des publications dans lesquelles ils dessinaient. Depuis des années, ils nous faisaient à la fois rire et réfléchir et leur assassinat a provoqué un choc profond. Ceux qui sont descendus dans les rues le 11 janvier marchaient silencieusement, comme à un enterrement dans l’intimité nationale de deux de leurs plus chers amis. Ils n’avaient rien contre leurs compatriotes musulmans.
Il y a aura ensuite une incompréhension du sens de « Je suis Charlie » qui s’est perpétué. Ce slogan était né en réaction aux paroles de l’un des tueurs qui en sortant de l’immeuble avait proclamé « on a tué Charlie Hebdo ». A ce moment-là, un grand mouvement de solidarité est né. « Je suis Charlie » c’était pour signifier que non, Charlie n’était pas mort, que nous nous levions tous pour continuer à le faire vivre, et que nous faisions le serment que Charlie continuerait à vivre. C’était un cri de soutien au nom de la liberté. Cela ne signifiait pas que tous étaient d’accord avec Charlie Hebdo et sa ligne éditoriale. C’est ce sens-là qui très vite a été perdu - d’où, plus tard, le malentendu. Ce qui n’empêche d’ailleurs pas que certains ne se soient pas reconnus dans cet appel. C’est leur droit.
Les attentats du 13 novembre n’ont pas eu le même écho au sein de la population française. Comment l’expliquez-vous ?
En effet, les attentats du 13 novembre ne sont pas à mettre sur le même plan que les attentats de janvier. Alors que les attentats du 7 et du 9 janvier visaient explicitement des caricaturistes, des juifs et des policiers, ceux du 13 novembre visaient tout un chacun. La configuration était différente car, cette fois-ci, ce sont les Français dans leur ensemble qui ont été pris pour cible, sans égard pour leur appartenance professionnelle, sociale ou ethnique. Nous étions tous ciblés pour ce que nous partageons ensemble, dans des cafés, des restaurants ou des salles de concert.
Les tueurs et leurs ordonnateurs cherchaient avant tout à nous diviser : l’urgence était donc de nous unir. Renforcer, assurer au mieux la cohésion du pays, c’était la meilleure réponse à faire aux terroristes. Dans le même temps, il fallait isoler, réduire, voire annihiler les quelques centaines de nos compatriotes attirés par l’action terroriste. Quelle fut la réponse du Président de la République ? La déchéance de nationalité. L’inverse en tous points de ce qu’il fallait faire.
Vous êtes souvent intervenu lors du débat sur ce projet d’inscrire la déchéance de nationalité dans la Constitution. Six mois après son abandon, quel bilan tirez-vous de cette projet de réforme constitutionnelle ?
Face aux attentats, le pouvoir politique devait tout d’abord chercher l’unité des citoyens, et ensuite prendre des mesures concrètes contre le terrorisme. Avec la déchéance de nationalité, on créait dans la Constitution une distinction entre Français, on les divisait. On blessait une masse énorme de Français sans dissuader le moins du monde le moindre terroriste qui, voulant aussi mourir en tuant, n'a rien à faire de sa nationalité – cette dimension suicidaire des terroristes a été parfaitement analysée par Hans Magnus Enzensberger dans Le perdant radical : essai sur les hommes de la terreur (Gallimard, 2006).
La Constitution est un texte fait pour unir les citoyens et non pour les diviser. La République française se déclare une et indivisible, et la déchéance pour les seuls doubles nationaux contredisait le premier article de la Constitution qui déclare les Français égaux devant la loi sans distinction d’origine, de race ou de religion. J’ajoute que la double nationalité est un vieux phénomène. La question de son acceptation s’est posée en 1922, pour des Allemands installés en Alsace avant 1914 qui souhaitaient devenir Français tout en conservant leur nationalité d’origine. Le parlement a alors déclaré que oui, il était tout-à-fait acceptable de garder des liens culturels et financiers avec le pays d’où l’on venait.
La République est indifférente à la double nationalité de ses ressortissants. L’égalité de traitement est le principe même de la République et, en plus, il favorise l’intégration. Il faut bien-sûr circonscrire l’embrigadement de terroristes et neutraliser ceux qui s’engagent. Je propose depuis janvier 2015 la création d’une commission d’enquête indépendante sur le modèle la commission d’enquête américaine qui s’est créée après le 11 septembre. Mais ce dont je suis sûr, c’est qu’il faut isoler les efforts pour briser l'unité de la communauté nationale, et donc rechercher à tout prix l’unité des Français, que la proposition d’inscrire dans la constitution la déchéance mettait à mal.
Il semble que depuis le drame de Nice, le climat a changé. La parole s’est libérée, la cohésion et l’unité nationale se sont effritées. Le sentiment de ras le bol et la colère ont pris le pas sur l’unanime républicain. Les débats sur le burkini sont en ce sens des exemples frappants. Qu’en pensez-vous ?
L’attentat de Nice a donné le sentiment que la protection de la population avait ete mal assurée. Comment un tel drame a-t-il pu se produire en marge d’un grand rassemblement populaire, et ce, en plein état d’urgence ? Dans les jours qui ont suivi, les autorités nationales et locales se sont renvoyés dos à dos la responsabilité de la tuerie. Ce qui n’a pas manqué d’amplifier un sentiment de colère et d’impuissance chez nos concitoyens.
Le refus d’assumer ses responsabilités a accentué le sentiment d’une absence de direction intellectuelle et politique de l’action publique depuis les attentats de Charlie Hebdo et de l’Hypercacher de Vincennes. En outre, il règne une grande confusion dans la compréhension de la laïcité.
Les différentes affaires liées au port du burkini s’inscrivent dans ce vide et illustrent bien cette perte de repères. Au milieu de toute cette polémique absurde, Caroline Fourest a proposé une réponse féministe : que les femmes se rendent les seins nus sur la plage. C’est la liberté individuelle de conscience qui règne sur une plage, pas le pouvoir de ceux qui veulent imposer le port de burkini ou de ceux qui veulent l’interdire.
Nous l’avons vu, la liberté de conscience s’organise différemment selon les espaces et selon les publics. Dans une école publique par exemple, des règles communes s’imposent qui ne sont pas les mêmes que sur une plage où prévaut la liberté individuelle. Chacun a le droit d’être sur la plage comme il ou elle l’entend dans les limites fixées par la loi.
Quel enseignement tirer de l’élection de Donald Trump à la présidence des Etats-Unis?
Au cœur de ce qui s’est passé le 8 novembre dernier, lors de l’élection présidentielle américaine, réside l’importance du principe d’égalité des conditions dont Tocqueville avait repéré, « à mesure qu’il étudiait la société américaine » qu’il était « le fait générateur dont chaque fait particulier semblait descendre ».
Pour de nombreux électeurs américains, ouvriers ou habitants des zones rurales, le sentiment de ne plus bénéficier de l’attention - pour eux et pour leurs enfants - des politiques d’égalité, le sentiment d’être abandonnés, a joué un rôle important dans leur vote pour Donald Trump. Malheureusement, ce principe d’égalité a aussi subi un autre sort : dès lors qu’il a, dans les dernières années, bénéficié à des minorités, par exemple avec l’Obamacare ou l’affirmative action, il a été rejeté par ce vote Trump .
La France a su résister au néolibéralisme thatchérien et reaganien dont le Royaume-Uni et les Etats-Unis payent maintenant le prix par une sorte de dislocation. Mais en France comme aux Etats-Unis, on doit avoir conscience du premier problème et veiller à ce que les politiques de l’égalité bénéficient aux citoyens les plus modestes, les plus déclassés, les plus délaissés partout sur nos territoires, indépendamment du lieu de résidence, de la couleur de la peau ou d’une éventuelle religion.
On ne peut résoudre le second problème qu’en se confrontant dans chaque pays à sa propre histoire. Trop souvent, aux Etats-Unis comme en France, les citoyens ne se sentent compatriotes que par le droit, et guère par les sentiments. Ceci, faute d’une histoire comprise et partagée. L’égalité des conditions dont parlait Tocqueville ne s’appliquait bien évidemment pas aux esclaves noirs ni aux Indiens. Il a fallu pour cela une guerre civile, plus d’un siècle de combat contre la ségrégation. A l’évidence, ce combat n’est pas achevé.
Alors nous Européens, que devons-nous, et que pouvons-nous faire ? Quand une république démocratique vacille, ses sœurs, républiques démocratiques, doivent prendre la relève, reprendre le flambeau des valeurs partagées. Dans l’histoire du XXème siècle, à des moments bien plus dramatiques pour notre continent et pour l’histoire du monde, les Etats-Unis d’Amérique sont intervenus pour nous sauver. Plus récemment pourtant, en 2003, quand George W. Bush a engagé son pays et a voulu engager le monde dans la guerre en Irak, c’est d’Europe, par les voix de Jacques Chirac au nom de la France et celle de Gerhard Schröder au nom de l’Allemagne, que sont venus le refus et la raison.
Nous aussi, nous devons réformer nos politiques de l’égalité. Nous aussi, nous devons mieux regarder en face notre histoire : celle qui, commune à tous les citoyens, puisse les rassembler et les rendre plus compatriotes. Mais c’est aujourd’hui d’Europe, depuis la France et l’Allemagne d’abord, qu’il faut incarner ces voix de la raison et ces valeurs d’égalité et de fraternité que nous partageons avec tant d’Américains
A lire également sur nonfiction.fr :
La première partie de ce long entretien avec Patrick Weil
Toutes nos critiques des livres de Patrick Weil
