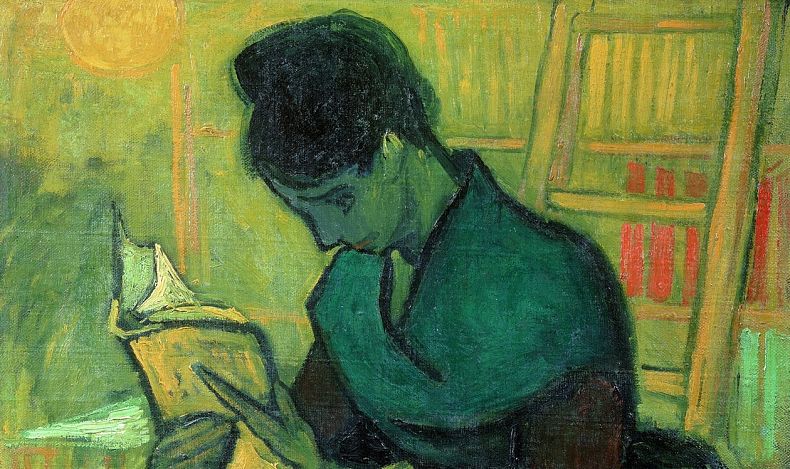Régine Detambel clôt une trilogie dédiée aux pouvoirs réparateurs de la lecture et de l’écriture, offrant une réflexion intense sur la manière dont les mots transforment, relient et soignent.
L'ouvrage de Régine Detambel, Écrire juste pour soi. Les mots prennent soin de nous, se veut le dernier volet d’une trilogie, entamée en 2015 avec la parution de Les livres prennent soin de nous. Pour une bibliothérapie créative, et complétée en 2023 avec Lire pour relier : La bibliothérapie à pleine voix. L'ensemble familiarise à nouveau le public francophone à la bibliothérapie, plusieurs décennies après la parution de l’ouvrage plus fouillé et fourni de Marc-Alain Ouaknin, Bibliothérapie. Lire, c’est guérir (1994).
Dans le premier volume de sa trilogie, Régine Detambel plaidait pour les effets thérapeutiques de la littérature ; dans le second volume, elle poursuivait son entreprise sur les prestations de soins littéraires en jetant la lumière sur l’aspect relationnel et socialisant de la bibliothérapie — à savoir, la lecture en partage (shared reading) — grâce à une série d’interventions socioculturelles programmées pendant la pandémie du coronavirus. Le dernier volume, qui vient de paraître, propose une autre forme de bibliothérapie en faisant une petite incursion dans l’atelier d’écriture des écrivants et écrivains, là encore, mêlant allègrement fiction et documentaire.
La formule est peu ou prou la même : un petit ouvrage ciselé en une quinzaine ou vingtaine de chapitres de quelques pages (quatre à six, tout au plus) colorées de métaphores et de comparaisons très fleuries. Même les titres lapidaires des divers chapitres fleurent bon cette poésie qui n’échappera pas aux lecteurs. Alors que la romancière fait le panégyrique de la littérature en lui prêtant parfois des pouvoirs excessifs — comme « le pouvoir de résurrection » —, elle concède par ailleurs l’impuissance des mots à tout dire : « Car les mots ne rendent jamais justice à nos pensées ; ils sont par essence inadaptés, bancals comme des couvercles impossibles à assujettir au récipient qu’ils sont censés recouvrir » . Cela signifie-t-il pour autant que la dimension thérapeutique de la littérature trouve ses limites face à la gravité des situations auxquelles nous serons tous, un jour ou l’autre, confrontés ?
Les réflexions de Régine Detambel brossent un large éventail de sujets qui vont — pour cet ouvrage dédié à l’écriture personnelle — du plaisir d’écrire à l’art-thérapie, en passant par la réparation, le journal intime, la corporéité et sensorialité de l’écriture, le gribouillage, les psychothérapies graphique et graphologique du docteur Pierre Ménard, l’écriture expressive de James Pennebaker, l’identité narrative de Paul Ricœur, etc. Tout est passé en revue, ou presque, dans ce survol littéraire qui présente ces ateliers de l’intimité comme une façon de transformer le soi.
À chaque nouveau tome, l’autrice introduit un élément original. Le tome 2 a vu l’inclusion de portraits-témoignages — artifice qu’elle reprendra dans le troisième tome — avec des bribes de paroles flanquées d’extraits de prose sous la plume des écrivains en herbe qu’elle a accompagnés dans l’écriture. L’architecture bipartite de Lire pour relier rappelle la structure de l’ouvrage de Nayla Chidiac, Les bienfaits de l’écriture, les bienfaits des mots : un atelier d'écriture (2022) qui innovait avec un double volet théorique et pratique, proposant en seconde partie des exercices de création littéraire. Dans ce même ouvrage, Chidiac — docteure en psychopathologie, psychologue clinicienne et psychanalyste — analyse la « littérature à contraintes » dans une section intitulée « Oulipo », grande marotte des ateliers d’écriture (creative writing workshops, en anglais). Régine Detambel rend un vibrant hommage à sa recherche pionnière en citant ses travaux : « Quand la psychologue Nayla Chidiac anime des ateliers pour ses patients, elle utilise beaucoup les contraintes oulipiennes, car ces propositions d’écriture créent un cadre très formel permettant d’écrire sans crainte de dévoiler son intériorité. »
Quant au tome 3, c’est l’exploitation raisonnée de l’intelligence artificielle — une trouvaille qui n’est pas sans rappeler le subterfuge déployé par Alexandre Gefen pour co-écrire Vivre avec CHATGPT (2023) — qui divertira le lectorat. Dans les deux cas, chez Gefen comme chez Detambel, nous constatons une écriture collaborative réussie, voire un parfait exemple de « créativité augmentée » , bien que le procédé littéraire et la teneur des propos ne manqueront pas de faire débat sur le plan de l’éthique. Comment fraterniser avec une intelligence artificielle plagiaire et cautionner son utilisation lorsque de nombreux écrivains se constituent en collectif pour traduire en justice OpenAI pour le pillage de leurs œuvres ? Nourrir cette intelligence artificielle, c’est quelque part consentir à co-créer et partager les droits de propriété sur la teneur des propos échangés qui émanent d’une production dialogique — de quoi bafouer davantage les droits de la propriété intellectuelle des écrivains.
Après lecture complète de la trilogie, on pourrait avoir le sentiment légitime que le sujet s’est tari dans la durée, mais il n’en est rien. L’autrice maîtrise l’art consommé de la reformulation qui ouvre sans cesse des perspectives nouvelles sur les usages variés de la fiction. Nul autre écrivain que Régine Detambel ne parvient à rendre avec autant d’acuité le fait que le langage — tel que l’avait pressenti Mikhaïl Bakhtine —, et par extension la littérature qui en est l’expression, est fondamentalement tant hétéroglossique que dialogique.
Grâce à cette trilogie, Régine Detambel entend répondre à la sempiternelle question qui a fait couler beaucoup d’encre dans les cénacles de théoriciens du fait littéraire : « que peut la littérature ? ». Écrire juste pour soi répond précisément à cette interrogation en développant ce qu’elle peut face à soi, à la vie, aux traumas, à la maladie, aux autres, au monde et au temps, faisant ainsi écho au projet d’Alexandre Gefen dans Réparer le monde. La Littérature française face au XXIe siècle (2017). Dans un entretien accordé il y a tout juste quelques mois, l’autrice expliquait la nécessité d’un tel ouvrage en ces termes :
« Nous traversons une époque d’éclatement. Les récits collectifs s’effondrent, les institutions chancèlent, et les subjectivités peinent à trouver des appuis. Nombreux sont celles et ceux qui éprouvent le sentiment de vaciller : éloignés d’eux-mêmes, éparpillés dans l’urgence, ils peinent à formuler une parole intérieure. Dans ce contexte, l’écriture redevient une ressource. Non pas un simple jeu ou un ornement mais un axe de verticalité, un geste structurant, un acte transformateur. Écrire est une poétique du monde par le geste. »
Gageons que les lecteurs de Écrire juste pour soi se laisseront tentés par cette « médecine de velours » qui les aidera à « traverser la vie » .