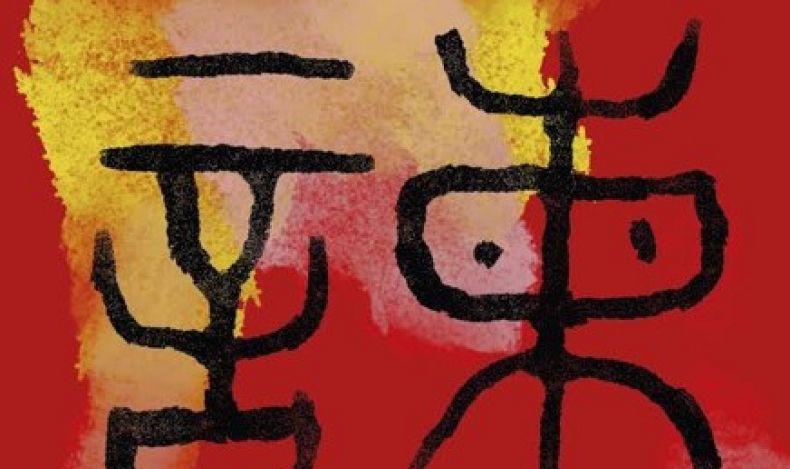Une anthologie inédite révèle des voix chinoises qui, malgré la censure, analysent lucidement le présent de la Chine et défendent droit, vérité et bien commun.
En Chine, l’espace du débat se rétrécit. Des comptes sur les réseaux sociaux disparaissent. Des carrières s’arrêtent. Des textes s’effacent. Penser en résistance dans la Chine d’aujourd’hui (Folio Essais, Gallimard, 2025), dirigé par Anne Cheng, sinologue au Collège de France, et Chloé Froissart, politiste et sinologue à l’Inalco, ouvre au lectorat francophone un accès direct à des textes publiés par des intellectuels chinois. Beaucoup ont été censurés, retirés des plateformes, ou ne circulent plus que hors du pays. L’intention, simple et forte, est de faire entendre des voix actuelles qui décrivent, analysent et proposent avec courage, malgré la contrainte.
Un projet au service des textes
Ce livre s’inscrit dans un travail éditorial au long cours. La pensée en Chine aujourd’hui (2007) avait passé en revue les grands sujets d’un espace intellectuel en recomposition à l’approche des Jeux Olympiques de Pékin. Penser en Chine (2021) avait éclairé les tensions d’une puissance qui se raidit. Le nouveau volume met au premier plan la résistance académique : comment continuer à enquêter, argumenter, transmettre, quand l’emprise politique s’intensifie.
Rendre ces textes accessibles n’allait pas de soi. Plusieurs sont traduits pour la première fois. D’autres ont été restaurés après leur disparition des sites chinois. L’ensemble ne rassemble pas des inédits commandés pour l’occasion mais documente ce qui s’est écrit en Chine, parfois brièvement, et ce qui a été sauvegardé au-delà de ses frontières. Le choix des quatorze voix inclut juristes et constitutionnalistes, historiens, philosophes, politistes, sociologues, anthropologues, ainsi que poètes et essayistes. Parmi eux : Guo Yuhua, Ge Zhaoguang, He Weifang, Ilham Tohti, Rahile Dawut, Tsering Woeser, Wang Lixiong, Xu Jilin, Xu Zhangrun, Zhang Qianfan. Beaucoup écrivent depuis la marge, victimes d’interdiction d’enseigner, de retraite forcée, de surveillance, voire de détention. Tous poursuivent le même but, écrire ce qui se passe et dire ce qui est.
Quatre lignes de tension
Le livre se lit comme un parcours à la découverte de quatre contradictions structurantes du régime actuel. Chaque partie réunit trois ou quatre textes traduits, présentés par une notice, qui en éclairent les effets et la manière d’y faire face.
D’abord l’histoire. Écrire l’histoire, quand le pouvoir la réécrit, devient un travail de sauvegarde. Des chercheurs rouvrent des dossiers sensibles : campagnes politiques, zones d’ombre du récit national, archives refermées. Ils collectent, éditent, publient sur des blogs, déplacent les textes hors des plateformes contrôlées. La vérité factuelle, même parcellaire, déjoue la performativité du récit d’État. Elle éclaire l’action publique et arme les citoyens. « Qui veut effacer un pays commence par effacer son histoire » dit un adage du XIXe siècle repris par l’historienne Zi Zhongyun.
Vient ensuite le droit. Des juristes défendent la primauté de la Constitution sur la décision du Parti communiste. Ils rappellent les garanties procédurales, pensent les limites du pouvoir administratif, discutent la notion de « socialisme constitutionnel » pour dire qu’un compromis est possible. Ils aspirent à réconcilier État-parti et société par la justiciabilité des droits et la prévisibilité des normes. Leur résistance est technique autant que civique : lire les textes, documenter les zones grises, publier au dehors si nécessaire, tout en s’adressant au public chinois. Le prix se paie en interdictions, en révocations, parfois en prison. Mais leur message reste clair : sans droit lisible, il n’y a ni sécurité, ni confiance, ni avenir commun.
La troisième partie du livre montre le devenir de la pluralité prise dans la contrainte d’« unité ». Le Tibet, le Xinjiang, les langues et les religions minoritaires disent la tension entre un discours d’inclusion et une pratique d’homogénéisation forcée. La sécurité, omniprésente, justifie l’extension des dispositifs de contrôle : numériques, policiers, administratifs. Des chercheuses et des écrivaines sauvent, au prix de leur liberté, des mémoires menacées, rappelant qu’une nation ne se réduit pas à une identité unique et que l’unité n’abolit pas la diversité.
Enfin, le livre s’intéresse aux appels à la mobilisation citoyenne par des universitaires qui posent des faits et cadrent l’action collective. Enquêtes de terrain, journalisme d’investigation, campagnes d’accès à la justice, archives citoyennes. Ce sont des coalitions brèves, des gestes modestes, des collectifs qui se forment le temps de prouver un fait. Certes, la technologie resserre l’étau : fermeture de comptes, filtrage algorithmique, judiciarisation sélective. Mais les tactiques s’ajustent : écrire court, changer de registre, multiplier les canaux, archiver hors ligne. Il s’agit finalement de rappeler des gestes civiques simples comme se regrouper, établir des faits, réclamer des comptes.
Une tradition critique réactivée
En Chine, la fonction critique des intellectuels ne vient pas de l’occident. Elle s’appuie sur des traditions anciennes. Le droit de remontrance autorisait les lettrés à avertir l’empereur. La rectification des noms veut que l’on appelle les choses par leur nom pour agir juste. En 1919, le Mouvement du 4 Mai a ouvert un espace intellectuel moderne, tourné vers la science et la démocratie. Les textes de l’anthologie se placent dans ces sillons. Ils refusent l’opposition simple entre « valeurs chinoises » et « universelles ». Leur enjeu est de faire de la liberté la règle, et de l’égalité la pratique, avec des mots audibles en Chine.
En dépit de cette cible nationale, ces intellectuels partagent entre eux le goût du lien avec l’extérieur. Curieux, érudits et comparatistes, tous entretiennent des échanges au-delà des frontières. Correspondances, séminaires, traductions, archives déposées à l’étranger quand il le faut. Cette circulation protège les textes et nourrit la pensée dans un esprit de solidarité intellectuelle. Elle est aussi au cœur du projet de ce volume car le travail des traducteurs et des éditrices fait exister une communauté de lecture qui dépasse les censures locales.
Pour un lectorat francophone, l’ensemble dialogue avec David Ownby (L’essor de la Chine et les intellectuels publics chinois, Collège de France, 2023). Par son blog et ses conférences au Collège de France, Ownby a cartographié les intellectuels publics qui demeurent publiables en Chine et choisissent des voix minimales pour durer. Le présent volume déplace le regard vers des textes plus exposés qui ont donné lieu à radiations, détentions, marginalisations. Les deux projets se complètent. L’un montre comment la pensée se faufile. L’autre donne à lire ce qui s’écrit quand la parole coûte. Ensemble, ils dessinent un spectre qui se rétrécit dangereusement.
Le ton de ces écrits est dépouillé sans pathos. Lucidité sans désespoir. On pense à John Berger qui dans Hold Everything Dear. Dispatches on survival and resistance (2007) convoque d’autres voix déterminées quoique sans consolation : Pasolini, Francis Bacon, Nâzim Hikmet, Eqbal Ahmad, Andreï Platonov. Les intellectuels chinois de cette anthologie auraient trouvé place à leurs côtés. Même regard droit. Même refus du désespoir et de la démission. Même pratique concrète qui consiste à sauver des preuves, archiver, argumenter, puis enquêter, publier, traduire, transmettre.
Un appel aux intellectels
Si l’ouvrage apporte des repères solides pour comprendre la scène intellectuelle chinoise au-delà des idées reçues, un lectorat non spécialiste peut être gêné par la densité qui impose des allers-retours entre disciplines, ainsi que par la nécessité d’une bonne connaissance de l’histoire des idées en Chine. Ce sont les limites d’une anthologie-ressource, liées au choix de laisser parler les textes. L’apport est toutefois indéniable : la traduction attentive, le cadrage éditorial et la mise en contexte offrent une matière première exceptionnelle pour appréhender la Chine d’aujourd’hui.
Penser en résistance dans la Chine d’aujourd’hui est aussi un livre militant. Il met à nu la nature totalitaire du régime actuel et de ses pratiques de répression ciblée, contrôle administratif, censure des personnes et des textes. La technologie numérique rétrécit encore les marges d’expression, dans une société de surveillance permanente.
Au-delà du cas chinois, l’ouvrage agit comme une invitation adressée aux intellectuels et aux universitaires, en Chine comme ailleurs : poursuivre la lutte contre la résignation, la peur et l’autocensure. La réponse de ces intellectuels tient à des pratiques simples et tenaces telles que traduire, partager, archiver, enseigner. Elle nous rappelle l’importance que la recherche en sciences sociales reste lisible, circule, et nourrisse l’exigence commune de vérité.
Pour aller plus loin :
Un entretien avec Anne Cheng et Chloé Froissart est disponible sur le site de la librairie Mollat, et consultable ci-dessous :