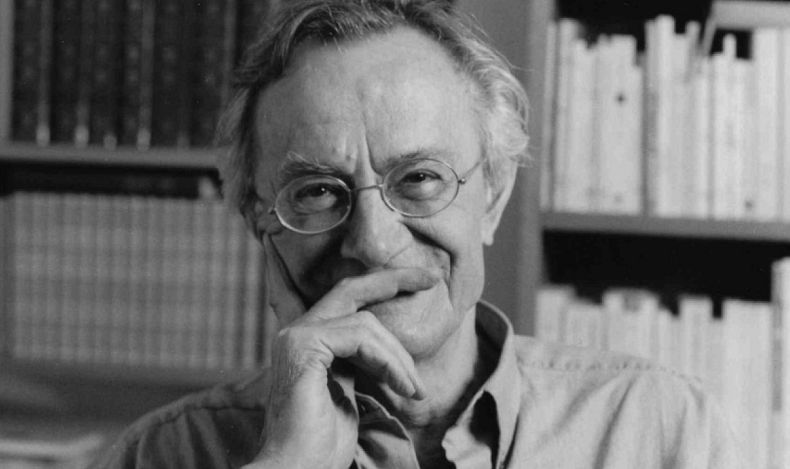Un numéro consacré à la pensée de Lyotard, sa critique des grands récits, son esthétique et la portée politique de son concept de différend.
Il fut un temps où l’on parlait beaucoup de Jean-François Lyotard (1924-1998) et de ses écrits, tant il était difficile d’échapper à sa pensée dans les débats intellectuels vifs de l’époque — qu’ils portent sur la postmodernité, l’esthétique ou l’altérité. D’une certaine manière, sa pensée était une pensée-monde, profondément enracinée dans les mutations artistiques et les transformations des savoirs et des discours, particulièrement au cours des années 1960-1970. Mais la diffusion de son œuvre a été marquée par une mécompréhension fondamentale. Il n’est donc pas inutile, quelque trente ans après sa disparition, d’en éclairer certains aspects, comme le propose ce nouveau numéro des Cahiers critiques de philosophie.
La vie et l'œuvre de Lyotard
Reçu à l’agrégation de philosophie, Lyotard enseigne d’abord en Algérie, puis dans la Sarthe. Membre du groupe « Socialisme ou Barbarie », il rejoint ensuite l’université : la Sorbonne (1959-1967), Nanterre, puis Vincennes (1971-1987), tout en enseignant parallèlement aux États-Unis. Aux côtés de Jacques Derrida, Jean-Pierre Faye, François Châtelet et Dominique Lecourt, il fonde en 1983 le Collège international de philosophie.
Son œuvre n’est pas d’accès facile. Elle exige une solide maîtrise de nombreuses références — en psychanalyse (notamment dans le champ de l’esthétique), en sociologie, et surtout en philosophie — sans oublier la théologie, domaine qu’il connaît intimement, comme en témoigne son ouvrage sur Augustin d’Hippone.
Lyotard devient connu du grand public pour ses réflexions sur la justice, centrées sur l’idée qu’on ne peut plus penser le devenir historique dans le cadre des grands récits hérités des Lumières (Hegel, Marx). Trop souvent, pourtant, on ne retient de sa pensée que deux notions — le « différend » et la « postmodernité » — sans les replacer dans le contexte de ce qu’on pourrait appeler son « paganisme critique » (au sens de la critique kantienne).
Un irrationalisme, ou un nouveau criticisme ?
Accusé par Jacques Bouveresse (Rationalité et cynisme, 1984), puis par Vincent Descombes, d’avoir renoncé au rationalisme, Lyotard reste impassible. Bouveresse, en effet, raisonne encore selon une opposition réductrice : rationalisme versus relativisme. D’où son accusation d’« irresponsabilité » — Lyotard sombrerait, selon lui, dans un irrationalisme et donc un relativisme total, que les philosophes de la communication lui reprochent également.
Or, si Lyotard ne renonce pas au rationalisme, il récuse bel et bien la raison totalisante (celle qui subsume toutes choses sous une totalité de sens univoque), tout comme la raison dialectique (celle qui tend à absorber toute différence). C’est dans ce double refus que s’inscrit son « incrédulité » à l’égard des grands récits ou « métarécits » (celui des Lumières, du progrès, ou de l’Esprit) — qu'on lui a souvent reprochée car réduite à une posture de scepticisme généralisé.
À ces velléités de maîtrise, il oppose l’expérience de l’inarticulé, de l’insignifiant en littérature, et le « différend » en politique — lequel a, lui aussi, fait l'objet de nombreuses incompréhensions. Le différend n’est ni la simple différence (passive), ni le désaccord entre deux interlocuteurs : c’est une situation où aucun langage commun ne permet de trancher le conflit, qui implique une forme de lucidité politique. Lyotard en fait moins une théorie générale qu’une attitude critique, attentive à la singularité irréductible de chaque cas, mais en aucun cas une clé universelle d’interprétation.
En somme, Lyotard ne prône pas le rejet de tout sens, mais la nécessité de réécrire la modernité autrement, non par refondation, mais par une anamnèse interminable. Le terme d’« anamnèse » est emprunté à la psychanalyse — quoiqu'il ne s’agisse, pour Lyotard, ni de retrouver un souvenir perdu, ni de restaurer un passé. Le philosophe définit l’anamnèse comme l’acte qui consiste à repérer, dans le visible, les traces d’un geste premier qui l’excède. Les notions majeures de « différend » et de « postmoderne », visent, en ce sens, à donner place à une part irréductible de notre existence, renvoyée au silence de l’impossible dire. De ce point de vue, Lyotard se tient toujours du côté de l’ouvert, de l’imprésentable, de l’insurmontable.
Cette orientation, loin de marquer une rupture avec la tradition critique, en renouvelle plutôt la portée. Comme le souligne Gérald Sfez dans l’entretien mené dans les Cahiers par Nicolas Poirier et Fabien Aviet, « la philosophie de Kant fut l’un de ses phares ». De la Critique de la raison pure à la Critique du jugement, Lyotard retient l’idée d’une pluralité hétérogène du réel, opposée à tout discours de surplomb et à toute confusion entre les registres de discours. Les registres du descriptif et du prescriptif ne doivent pas être confondus ; aucune posture surplombante ne peut prétendre dominer les registres d’action et de pensée.
Sortir de l’esthétique traditionnelle
C’est souvent par l’esthétique que l’on aborde la pensée de Lyotard. Sa démarche consiste à penser l’art en dehors des cadres de l’esthétique traditionnelle — celle de la représentation, ou de la croyance en une adéquation parfaite entre l’image et le réel. Car il y a, dans les œuvres d’art, quelque chose d’irréductible aux catégories interprétatives. Mais cette orientation n’implique en rien un abandon du politique, comme le rappelle le dossier.
En matière d’esthétique, Lyotard s’attache à la pluralité des expériences, à la multiplicité des occurrences et à la singularité de chaque cas, sans jamais revendiquer une représentation unifiante. Claire Pagès montre, à travers l’exemple de Daniel Buren, comment Lyotard met au jour, dans le champ visuel, l’invisible lui-même — sans jamais dire exactement ce qu’il y a à voir. Que nous donne à voir la peinture contemporaine (Monory, Buren…), sinon la manifestation du sensible dans sa forme la plus nue, avant qu’il ne soit soumis à la loi du discours ou de la représentation ?
Dylan Vaughan, de son côté, ouvre un autre versant de la réflexion lyotardienne : celui de l’événement et de l’indéterminé. Son analyse n’est pas anodine, car elle répond aux critiques récurrentes de relativisme et de nihilisme adressées à Lyotard à propos de la postmodernité. Vaughan retrace ainsi l’évolution de sa pensée, de l’épistémologie à l’esthétique, en passant par l’éthique et la politique. Chez Lyotard, l’art témoigne de cette faille par laquelle l’individu refuse de se soumettre aux impératifs de la bonne intégration, tandis que le différend engage une obligation de juger et d’agir — fût-ce pour suppléer au défaut d’une justice positive défaillante. C’est là le ressort de la transmission de l’insoutenable.
Si, chez Lyotard, l’esthétique semble se concentrer sur les arts plastiques, trois contributions rappellent à juste titre son intérêt pour la poésie, la musique et les performances. On se souvient notamment de l’exposition emblématique du Centre Pompidou, Les Immatériaux (1985).
Politique
Mais c’est plutôt sur la dimension politique de l’œuvre de Lyotard que nous pouvons conclure. Ce qu’il affirmait trouve aujourd’hui une résonance particulière : il n’existe pas d’agent historique chargé de montrer la voie à suivre. Le philosophe doit donc demeurer à l’écoute interminable des luttes.
Chacun jugera de l’appréciation de Gérald Sfez, selon laquelle Lyotard a développé l’une des philosophies politiques les plus lucides de notre temps. Toujours est-il que sa pensée se concentre sur un aspect parfois négligé dans la conjoncture actuelle : le rapport entre la loi et le traitement des torts ; autrement dit, sur le jugement, mais un jugement capable de prendre en compte l’irréparable, contrairement au jugement judiciaire. Il y a toujours un « autre côté » qui échappe à la compétence du droit, fût-il parfait dans son ordre. De ce point de vue, il ne s’agit pas seulement de constater les torts, mais de relever le tort fait au tort lui-même — celui que produisent les tentatives d’effacement, cette « quantité de silence » dont souffrent beaucoup de consciences modernes et dont Lyotard n’a jamais cessé de parler.