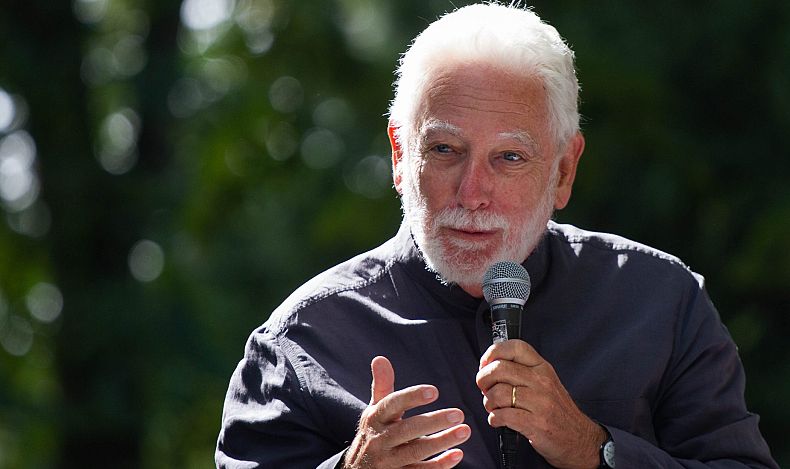Philippe Descola montre comment l’anthropologie peut repenser la politique en étudiant la composition de collectifs humains et non-humains, et leurs manières de « faire-monde ».
Le nouvel ouvrage de Philippe Descola peut se lire comme le prolongement de Par-delà nature et culture (2005). Dans ce livre devenu classique, l'auteur analysait, à partir du travail de terrain mené auprès des Achuar en Amazonie, les grandes ontologies — ces cadres de pensée qui organisent la manière dont les humains perçoivent et ordonnent le monde. Il distinguait alors quatre grands « modes d’identification » : animisme, totémisme, naturalisme et analogisme, observés dans des pratiques et des représentations très diverses. Mais la question politique y était à peine esquissée : comment les collectifs humains s’organisent-ils concrètement, et comment associent-ils aussi les non-humains ? Quelle confrontation entre les modernes et les « extramodernes » pourrait nous éclairer, voire ouvrir la voie à de nouveaux agencements communs ?
C’est à ce chantier que Descola s’attelle dans Politiques du faire-monde, issu des « conférences Tanner » données à Berkeley en 2023. Ces interventions, conçues pour « enrichir la vie morale et intellectuelle de l’humanité », prolongent en réalité une réflexion critique sur les notions occidentales que nous croyons universelles — « société », « cité », « politique » — mais qui perdent tout sens dès qu’on les déplace dans d’autres contextes. D’où la question centrale : que peut nous apprendre l’anthropologie pour penser la politique et les différentes manières de « faire-monde » ?
On remarquera que, de manière significative, le titre de l’ouvrage s’affiche au pluriel : il ne s’agit pas de chercher une politique unique, qui conviendrait à tous. Descola demeure descriptif : il s’intéresse aux manières nécessairement plurielles (et donc aux « politiques ») de composer un monde commun, ou à ce qu'il appelle par ailleurs des « mondiations ».
L'anthropologie contre les illusions de l'universel
Depuis longtemps, une hypothèse traverse les esprits de ceux qui sont familiers des ouvrages d'anthropologie : si de manière universelle l'humanité s'appuie, pour fonder ses liens sociaux, sur l’interdit de l’inceste, ne pourrait-il pas exister un principe équivalent permettant de fonder, de manière tout aussi universelle, une politique ?
Cette piste a été abondamment creusée, mais elle se heurte à deux écueils. D’une part, elle reconduit les catégories propres à l’ontologie occidentale et les impose à tous comme si elles allaient de soi. Ainsi, ces bases supposément universelles ne sont en fait que des particularismes culturels ayant été érigés en universaux. D’autre part, cette piste gomme la multiplicité des expériences humaines et menace le relativisme méthodologique qui est le cœur de l’anthropologie.
L’ambition de Descola est différente : inventer des outils d’analyse qui se dégagent au maximum des particularismes historiques sur lesquels reposent en majorité les concepts des sciences sociales (société, nature, progrès...).
Le problème des règles
Que l’organisation collective suppose des règles, nul n’en doute. Que ces règles diffèrent, voire s’opposent, également. Le vrai problème devient alors : qui est habilité à trancher entre des propositions concurrentes, et qui peut en débattre ?
La question est d’autant plus vive aujourd’hui que les grands récits normatifs ont perdu toute crédibilité. Ni le discours théologique et son Dieu régulateur, ni celui de la « civilisation européenne » et de sa Vérité imposée, ni celui des Lumières centré sur un modèle unique de l’Homme n’ont plus force de fondement commun. Non seulement ils n’ont plus de légitimité, mais parce qu’ils ont longtemps dominé, ces récits portent en outre une responsabilité dans les catastrophes historiques récentes (qu'elles soient sociales ou écologiques).
Alors, sur quoi fonder une règle commune, un principe de justice partagé, surtout lorsqu’il s’agit de relier les mondes humains et non-humains ? Faudra-t-il attendre qu’une voix domine et réduise les autres au silence ?
Penser les collectifs
C’est ici que l’anthropologie ouvre une autre voie : non plus penser la politique comme un simple art de gouverner, mais comme l’élaboration de collectifs.
Descola propose de voir la politique comme un système de partage et de distribution : partage des êtres appelés à s’associer, et distribution des liens possibles entre eux. Ce sont précisément les « modes d’identification » qu’il avait dégagés dans Par-delà nature et culture. L’ordre social et politique repose toujours, en fin de compte, sur la définition de qui participe et peut participer.
Pour cela, l’auteur invite à adopter un vocabulaire moins marqué par l’histoire de la philosophie occidentale. Ainsi du mot « collectif », qu’il préfère à « société » : ce terme, souligne-t-il, a l’immense mérite de ne préjuger ni du contenu de l’association ni des formes d’assemblage. Il permet surtout d’éliminer toute séparation ontologique entre regroupements humains et non-humains : espèces, troupeaux, bandes, branches techniques, panthéons, collections…
On comprend alors que limiter l’analyse aux seuls humains a longtemps bloqué la réflexion sur les dimensions proprement politiques de la vie collective hors des sociétés modernes occidentales. Cette réduction, qui tient à un dualisme fort entre nature et culture, a ses raisons, notamment historiques, lesquelles nous ont enfermés dans une vision appauvrissante du vivant ; mais le contexte a changé et il est désormais nécessaire de comprendre les manières humaines d’habiter le monde en relation avec d’autres existants.
Cosmopolitique
C’est à ce prix, précise Descola, que l’on pourra redonner toute sa portée à l’idée de cosmopolitisme. Mais il ne s’agit pas du cosmopolitisme kantien, où l’universel s’identifie à la civilisation occidentale, ni de celui d’Ulrich Beck, qui l’assimile à la conscience d’un destin commun entre les peuples. Dans les deux cas, ce cosmopolitisme est selon Descola « appauvri et normatif », identique partout.
La perspective de l'auteur, plus proche des travaux de Bruno Latour et d’Isabelle Stengers, est celle d’une véritable cosmopolitique. Elle consiste à reconnaître la possibilité de mettre sur un même plan une multiplicité de mondes. Le terme « cosmopolitisme » devient alors le nom des opérateurs qui relient ces mondes, en articulant des êtres et des choses que nous persistons trop souvent à séparer.