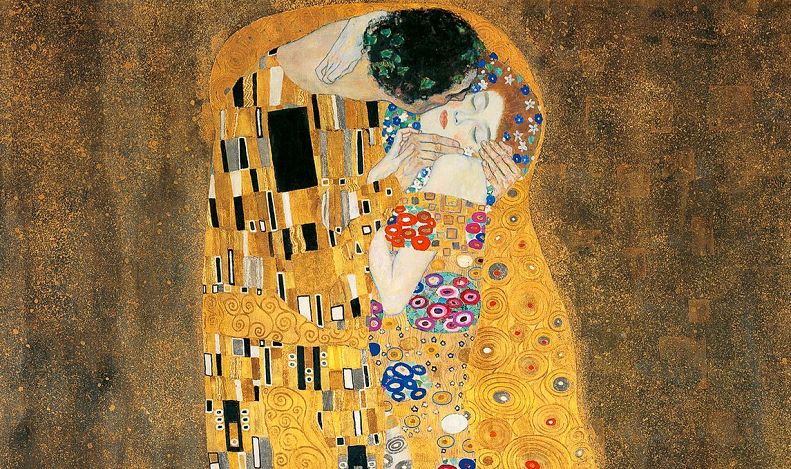Alain Caillé articule la théorie du don à la question de la reconnaissance et de la valeur des personnes pour éclairer ce qui fonde notre désir d’être estimés.
La question de notre valeur nous habite profondément. Cette valeur se façonne dans chaque domaine où nous nous engageons : par l’apprentissage, l’action, ou encore par notre appartenance à un collectif. Nous aspirons à ce que cette valeur soit reconnue par ceux avec qui nous interagissons – comme le signe d’une contribution significative, positive et porteuse de sens pour eux. Sans cette reconnaissance, comment pourrions-nous nous sentir véritablement investis d’une valeur ?
C’est en articulant la problématique de la reconnaissance, la question de la valeur des sujets et la théorie du don qu’Alain Caillé formule ici une proposition originale et ambitieuse. Une manière d’éclairer ce qui anime les êtres humains, les raisons qui les poussent aussi bien à coopérer qu’à s’affronter, parfois jusqu’au conflit ou à la guerre. « Les humains désirent être reconnus comme donateurs, de bien ou à défaut de mal, comme receveurs légitimes d’un don (…) et/ou comme participant du mouvement de la donation (de la vie, de la liberté, de la gratuité, de la beauté et du gracieux). C’est ainsi qu’ils entendent manifester leur valeur. »
L’ouvrage, dont la forme pourra surprendre, ne se contente pas d’énoncer une thèse audacieuse : il en explore les ramifications et s’efforce d’en tirer les conséquences. En même temps, il nous partage les « pièces du puzzle » qu’il a rassemblées autour de la question de la valeur des personnes. La seconde partie du livre revient ainsi sur plusieurs notions clés, dont la plus importante est sans doute une relecture stimulante de l’œuvre de Marcel Mauss, à laquelle Alain Caillé a consacré une part majeure de ses recherches.
Nonfiction : Vous avez consacré la première partie de ce livre à examiner la question de la valeur des personnes. Pourriez-vous dire un mot, pour commencer, de ce qui vous paraît, dans le monde actuel, exacerber l’importance de cette question ?
Alain Caillé : Jusqu’à il y a peu, c’étaient les questions et les enjeux économiques qui occupaient la première place dans les débats politiques. Il ne fait pas de doute qu’ils sont d’une importance extrême. Notre monde est à la fois la proie et le témoin effrayé de gigantesques conflits géostratégiques animés par le souci de développer une économie la plus puissante possible et de s’approprier des ressources précieuses, de l’eau, de la terre, du pétrole, des minerais, des terres rares, etc. On le voit partout, en Afrique notamment, et plus particulièrement encore en République démocratique du Congo. La politique de Trump, quant à elle, sacrifie tout aux intérêts économiques immédiats des États-Unis – qu’il ne distingue d’ailleurs pas de ses intérêts financiers personnels. Le paradoxe apparent, toutefois, est qu’il a bénéficié du vote des classes populaires, lesquelles auraient sûrement eu plus intérêt, d’un point de vue strictement économique, à voter Kamala Harris. L’explication en est que, pour elles, la question de la valeur qui leur est reconnue prend le pas sur la valeur économique.
En affichant l’objectif de rendre à l’Amérique sa grandeur (MAGA), c’est leur valeur, trop déniée par les élites culturelles, que Trump donne le sentiment de vouloir rendre aux classes populaires. Ou, pour le dire autrement, il propose d’un côté aux grandes entreprises, aux milliardaires et aux géants de la Tech de maximiser la valeur de leur portefeuille financier, et de l’autre, il offre aux catégories sociales les moins bien loties la possibilité d’affirmer leur valeur en proclamant de plus en plus haut et fort les valeurs auxquelles elles croient ou veulent croire. Car on pense avoir de la valeur au prorata des valeurs que l’on professe, pour autant qu’elles sont reconnues par d’autres auxquels on reconnaît de la valeur. Il y a là ce qu’on pourrait appeler une circularité axiologique auto-renforçante : j’ai de la valeur parce que j’ai des valeurs partagées par des gens à qui j’attribue de la valeur et qui m’en confèrent en retour parce que j’ai les mêmes valeurs qu’eux.
De plus en plus, les luttes économiques de redistribution (pour le dire dans le langage de la sociologue américaine Nancy Fraser) se doublent donc de luttes pour la reconnaissance. Il est même probable que celles-ci l’emportent désormais sur les luttes proprement économiques. Et cela est vrai tant à l’échelle mondiale qu’aux échelles microsociales.
À l’échelle mondiale, le fait le plus saillant est la lutte des anciens empires, vaincus, dominés et humiliés par l’Occident, pour retrouver au moins une part de leur grandeur et de leurs valeurs passées. C’est particulièrement flagrant dans le cas de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, qui aspire avant tout à être reconnue à nouveau comme une grande puissance. Mais c’est tout aussi évident en ce qui concerne la Chine, la Turquie d’Erdogan, l’Inde de Modi, etc. Au sein de chaque pays, de même, on voit se développer et s’exacerber la lutte pour la reconnaissance de chaque sous-culture présente, de chaque tradition religieuse, de chaque pratique ou orientation sexuelle, et – en amont de toutes ces luttes de reconnaissance – la lutte pour la reconnaissance de la valeur respective des femmes et des hommes. Cette question des rapports hommes/femmes constitue sans doute, en dernière instance, le facteur déterminant de la lutte pour l’affirmation de la valeur qui se joue entre le Nord et le Sud global – les pays du Sud accusant l’Occident de dégénérescence et ceux du Nord les accusant d’arriération barbare. Mais c’est elle également qui oppose, au Nord, les catégories populaires aux élites culturelles.
Pourriez-vous exposer ici la proposition théorique, très ambitieuse, que vous avez choisi de présenter dès l’introduction ?
Si elle est ambitieuse, j’ai toutefois choisi de la présenter et de la traiter de la manière la plus modeste possible. Pour simplifier à l'extrême, disons qu’il existe deux grandes manières de penser ce qui anime les humains au plus profond. Pour la première, c’est l’intérêt économique ou le besoin matériel (ou sexuel), la lutte contre la rareté. On a là le discours orthodoxe standard. Pour la seconde, c’est la quête de reconnaissance, que ce soit dit en ces termes, comme chez Hegel, Charles Taylor ou Axel Honneth, par exemple, ou, de manière un peu différente, comme chez La Rochefoucauld, Rousseau, Hannah Arendt ou René Girard, et tant d’autres. Je m’inscris pour ma part dans ce deuxième ensemble.
Il conviendrait de parler de manière spécifique de chacun de ces auteurs. Parmi eux, celle dont je me sens le plus proche est Hannah Arendt, qui traite magnifiquement du désir d’apparaitre, de se manifester (Selbstdarstellung) au sein d’une pluralité humaine. Mais ne parlons ici que d’Axel Honneth, qui est aujourd’hui considéré comme le théoricien par excellence de la lutte pour la reconnaissance, celui auquel la plupart des débats renvoient. Or, après m’en être senti très proche, c’est peut-être de lui que je me sens désormais le plus éloigné. D’abord, parce que son approche est au bout du compte presqu’exclusivement normative. Elle nous dit que dans une société bonne, chacun devrait être reconnu, c’est-à-dire selon lui aimé, respecté et estimé. Certes, il est assez problématique d’imaginer que chacun puisse être aimé ou estimé de manière égale. Mais le problème principal est que cette formulation ne nous dit rien, en définitive, sur les motivations profondes des sujets humains. Elle laisse croire que tous les humains seraient mus en dernière instance par l’aspiration à une reconnaissance mutuelle rationnelle partagée, ce qui ne saute pas aux yeux. Cette théorie de la lutte pour la reconnaissance ne parle en réalité guère de lutte. Par ailleurs, elle ne nous dit pas à quel titre nous entendons être reconnus.
À cette question, je propose deux réponses qui me semblent manquer chez les auteurs que je viens de mentionner. La première est que nous désirons être reconnus comme ayant de la valeur. La seconde est plus complexe et comporte deux volets.
Le premier volet consiste à dire que l’on reconnaît de la valeur – et que l’on accorde de la gratitude (deuxième sens du mot “reconnaissance” en français) – à celles et ceux qui ont donné quelque chose. On salue alors leur générosité, leur créativité, leur capacité à engendrer. Sur ce point, on retrouve Marcel Mauss et la thématique du don, totalement absente chez les auteurs cités. Le second volet soutient, réciproquement, que l'on reconnaît également de la valeur à ceux à qui il a été donné et qui ont reçu quelque chose de précieux (un héritage important ou un titre de noblesse, par exemple) ou quelque chose de plus impalpable (une forme ou une autre de beauté, d’intelligence supérieure, de vitalité ou de grâce, par exemple). Cette fois, ce n’est plus Mauss qui sert de point d'appui, mais plutôt la tradition phénoménologique allemande. Celle-ci s’appuie sur une particularité de la langue allemande dans laquelle « il y a » se dit : es gibt, soit littéralement : « ça donne ». Mais qui donne ce qui est là, ce « il y a » ? Personne, et à personne en particulier. C’est le domaine de ce que les philosophes de la tradition phénoménologique appellent celui de la donation (Gegebenheit), celui des dons (des dons impersonnels) souvent les plus précieux : la vie, la terre, la pluralité des espèces animales, le cosmos, les paysages, etc. C'est le lieu des valeurs incommensurables.
S'agissant de la théorie du don de Mauss, justement, pourriez-vous expliquer les ajustements que cette proposition devrait conduire à faire ?
Ils sont assez nombreux. Le plus évident, eu égard à ce qui est au cœur de notre entretien, est de souligner que le célèbre Essai sur le don de Mauss (1924-25), qui rassemble tout le savoir ethnologique de son temps, atteste d’au moins une certaine universalité de la quête de reconnaissance par le don, même si Mauss ne le dit pas explicitement ainsi. Pour bien comprendre ce dont il s’agit, il est nécessaire de revenir sur un cas assez singulier et déconcertant dans l’histoire des idées. Pendant longtemps, dans la philosophie française d’après-guerre, Hegel a été lu et compris dans le sillage des cours flamboyants donnés par un philosophe d’origine russe, Alexandre Kojève, qui a notamment mis en avant ce qu’il a appelé la dialectique du maître et de l’esclave dans la Phénoménologie de l’esprit de Hegel (là où Hegel, moins grandiloquent, parle de dialectique du maître et du serviteur). Ces cours donnés avant la Seconde Guerre mondiale ont été édités par Raymond Queneau en 1947, sous le titre Introduction à la lecture de Hegel. En lisant cette introduction, j’ai toujours senti de larges échos avec l’Essai sur le don de Mauss. Et, réciproquement, les passages de Mauss sur le potlatch, notamment, évoquaient pour moi irrésistiblement la lecture de Kojève. Ce n’est que très récemment que j’ai fini par comprendre (sans savoir alors que l’historien Carlo Ginzburg l’avait fait avant moi) que, comme il l’a avoué lui-même, Kojève n’avait pas fait une lecture fidèle de Hegel, mais avait surtout voulu « frapper les esprits ». Ce qu’il n’a pas avoué, en revanche, c’est qu’il avait tout simplement plaqué sa lecture de l’Essai sur le don sur Hegel. Une fois ce premier point précisé on sait mieux de quoi l’on parle.
Un deuxième ajustement nécessaire, du même ordre, a trait à tout ce qu’écrit Mauss sur les choix des civilisations, sur l’arbitraire des coutumes, des manières de marcher, d’habiter son corps, de construire des maisons, de manger, etc. Tout cela aurait pu ou pourrait être autrement que ça n’est. Or, là encore, le choix de telle coutume particulière est précisément destiné à affirmer une certaine valeur que l’on croit acquérir en l’effectuant, puisqu'on affirme en même temps que c’est ainsi qu’il faut faire les choses et se comporter, et non autrement. Qu’on pense ici, simplement, à la logique de la mode.
Par ailleurs, si l’on veut commencer à décrire et à comprendre un peu finement comment la reconnaissance entre en jeu dans et avec le don, il convient de détailler les moments du cycle du don (donner, recevoir et rendre selon Mauss) – en ajoutant celui de la demande –, et de se demander comment et pourquoi la reconnaissance va au donateur plutôt qu’à celui qui demande ou qui reçoit. De montrer également comment le don peut être don de mort et de méfaits à défaut d’être don de vie et de bienfaits. De faire voir, enfin, que ce qui est don pour l’un ne l’est pas pour un autre, etc. C’est à quoi nous nous sommes employés, Jean-Edouard Grésy et moi, dans Œil pour œil, don pour don. La psychologie revisitée (DDB, 2018), en montrant comment le cycle du don, et donc de la reconnaissance, peut être biaisé par de multiples dérapages selon que l’on demande, que l’on donne, que l’on reçoive ou que l’on rende trop ou pas assez. Untel, par exemple, croit être généreux et avoir beaucoup de valeur à ce titre, mais il ne voit pas que par l’excès même de ses dons, il humilie ceux qui les reçoivent ou, pire, les empêche de donner à leur tour.
Pourriez-vous dire un mot, pour finir, des conséquences que vous pensez devoir en tirer, pour la société et/ou les personnes qui la composent ?
Un dernier mot sur la lecture qu’il convient de faire, selon moi, de l’Essai sur le don, ce texte que je tiens, vous l’aurez compris, pour le plus important peut-être de toute l’histoire de la philosophie politique et des sciences sociales. Il y en a trois grands types de lecture possibles.
La première, la lecture économiciste, peut s'autoriser des deux premières pages de l’Essai. Elle voit dans les relations de don le masque ou l’euphémisation de l’échange marchand et du donnant-donnant régi par l’intérêt personnel. C’est la lecture de Bourdieu, notamment, pour laquelle la générosité affichée n’est en définitive qu’un faux-semblant de l’intérêt économique.
La deuxième, moins courante, serait pourtant en cohérence avec les deux tiers ou les trois quarts de l’Essai. Elle fait valoir l’universalité – une certaine universalité –, de la lutte pour la reconnaissance par le don agonistique, par la rivalité par le don. C’est la lecture de Baudrillard, notamment, dans le sillage de celle de Georges Bataille.
La troisième est celle que nous avons privilégiée dans La Revue du MAUSS. Elle procède des conclusions morales, politiques et sociologiques de l’Essai qui constituent un vibrant plaidoyer pour un socialisme démocratique et un humanisme qui sache s’inspirer de ce qu’il y a lieu de retenir du passé de l’humanité.
Dans mon dernier livre, celui qui fait l’objet de notre entretien, parlant de l’aspiration des humains à faire reconnaître leur valeur, j’ai donné plus de place et d’importance que je ne l’avais jamais fait à la deuxième lecture. N’est-elle pas en contradiction avec les conclusions humanistes et démocratiques de Mauss et du MAUSS ? Si chacun lutte avant tout pour faire reconnaître sa valeur, le risque est grand, en effet, de basculer dans la guerre de tous contre tous ou dans une aspiration plus ou moins nietzschéenne à l’apparition du surhomme. Ce serait oublier que dans l’Essai sur le don, Mauss précise bien qu’il ne traite que de ce qu’il appelle les « prestations totales agonistiques » et laisse de côté les prestations totales non agonistiques, autrement dit les multiples formes de partage.
Pour en revenir à votre dernière question, on peut dire que la société bonne est celle qui offre le plus de possibilité au plus grand nombre d’être reconnus comme donateurs et généreux. Non pas ceux qui ont le plus d’argent ou de pouvoir, mais ceux qui peuvent être reconnus parce qu’ils excellent dans des activités prosociales. Ainsi, celles et ceux qui se vouent à l’éducation des enfants, à la lutte contre le réchauffement climatique, à l’engagement associatif, à la cuisine, à l’art, au sport, à l’inventivité démocratique, etc. Ce projet de société est celui que le convivialisme tente de faire triompher à l’échelle mondiale. Le Nouveau manifeste convivialiste (à paraître en octobre 2025 aux éditions Le Bord de l’eau sous le titre Convivialisme ou barbarie) expose ce projet en plaçant au centre de sa réflexion le problème que pose l’exacerbation mondiale des luttes pour la reconnaissance.