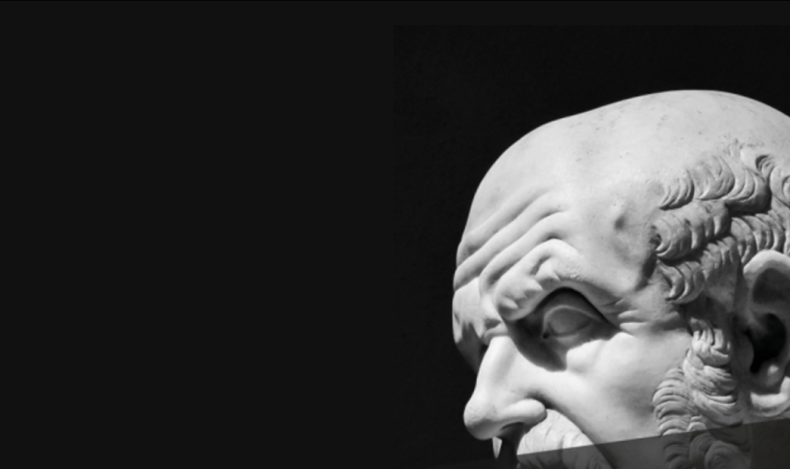Loin d’être anecdotiques, les discours sur les chauves et les pratiques de distinction par la chevelure sont un levier central de la mise en ordre sociale et politique des sociétés antiques.
* Read it in English.
À Rome, l’organisation civique et la pérennité des hiérarchies socio-politiques impliquaient en théorie une relative homogénéité corporelle au sein de chacun des ordres (sénateurs, chevaliers, esclaves…), afin de maintenir une cohésion civique. Cet idéal, difficile à appliquer dans les faits, associait le moindre détail arboré à une éventuelle distinction, souvent politique, qui était soumise au jugement des pairs.
Dès lors, se dévoilait bien souvent une lecture morale de l’apparence corporelle, renforcée par les théories dites « physiognomoniques » lorsque cette spécificité était d’ordre physiologique. Plus une particularité était éloignée de l’idéal corporel romain fondé sur une esthétique des vertus, plus elle était assimilée aux valeurs péjoratives qui alimentaient l’inventaire des stéréotypes disqualifiants. Le chauve était ainsi la cible de stéréotypes péjoratifs qui faisaient de lui un ivrogne, un dépravé sexuel ou un coquet efféminé.
Dans leur ouvrage, Robinson Baudry et Caroline Husquin s’attachent à retracer les raisons qui fondent cette dépréciation esthétique, morale et civique. Faisant de la calvitie, volontaire ou non, un objet historique, les auteurs cherchent à analyser la permanence des discours et des représentations sur le temps long – depuis le IIe s. av. n. è. jusqu’au Ve s. de n. è. – pour mieux saisir les différentes variations qui fondent cette dépréciation relativement généralisée.
Une nouvelle histoire des corps
En ce sens, leur approche s’inscrit résolument dans le renouvellement des études sur le corps débuté au cours des années 1990 et qui gagna plus tardivement l’histoire ancienne. En saisissant des objets du quotidien, ordinaires dirions-nous, qui peuvent paraître anodins, il s’agit d’en analyser la construction culturelle à travers le temps et ainsi en proposer une histoire politique et anthropologique.
Si une histoire du poil a déjà été proposée pour d’autres périodes (Marie‑France Auzépy, Joël Cornette [dir.], Histoire du poil, Belin, 2017), notamment pour l’Antiquité grecque (Pierre Brulé, Le Sens du poil, Belles Lettres, 2015), l’étude de la calvitie reste un objet inédit pour le monde romain et offre une synthèse efficace au regard du faible nombre de sources à notre disposition. Loin de proposer une simple typologie de la calvitie, les auteurs réussissent à analyser en profondeur les exemples mobilisés pour éclairer les logiques structurelles. Ces dernières permettent alors de proposer une histoire politique non pas de la calvitie, mais à partir de celle-ci.
Articulant études serrées des cas et développements d’ordre général, presque méthodologique, l’ouvrage présente cette histoire avec une clarté remarquable, permettant à des lectorats variés d’accéder aux enjeux que soulève la nature des sources mobilisées (l’iconographie occupant, en la matière, une place réduite).
Diffusion du stéréotype
Après une introduction générale qui brosse à grands traits les enjeux de la période au regard des récents apports de l’historiographie, l’ouvrage débute sur l’épineuse question des enjeux définitionnels, c’est-à-dire sur la manière dont les Anciens considèrent la calvitie et donc, plus largement, la pilosité. Cette dernière correspond à un ensemble de normes dont la maîtrise, notamment technique (épilation, rasage, etc.), permet de répondre aux attentes corporelles, par définition changeantes au fil des décennies, mais toujours structurées autour de la décence du citoyen. La calvitie se situe ainsi aux antipodes de l’idéal civique et, dès lors, le chauve est affublé de plusieurs stéréotypes qui l’éloignent des normes sociales et corporelles. En creux, se pose alors la question de la beauté corporelle et de la masculinité selon des critères spécifiques aux élites.
Les discours et les représentations favorisent ainsi un déterminisme social. Les plus jeunes, atteints d’une calvitie précoce, sont considérés comme des personnes davantage susceptibles de faire montre de pratiques indécentes (ivrognerie, dépravation sexuelle ou coquetterie excessive). La diffusion de ces idées dans la société (plèbe urbaine, soldats, etc.) s’observe notamment par le grand nombre de traités médicaux qui visent à fournir des remèdes pour soigner cette embarrassante calvitie qui peut nuire à la réputation et, parfois, mener à la honte. Qu’elle soit hippocratique ou magique, la médecine propose souvent plusieurs solutions pour conserver ou faire repousser les cheveux. Néanmoins, face aux prix élevés de certains remèdes, notamment ceux composés de produits lointains, plusieurs traités proposent des alternatives plus accessibles à Rome : graisse d’ourse, moutarde, ladanum, excréments d’animaux.
Par ailleurs, à travers certains remèdes contre la calvitie, on voit déjà poindre un des grands enjeux du sujet, c’est-à-dire la calvitie volontaire. Malgré le lien entre la calvitie et la déviance sexuelle également établi par les médecins, ces derniers suggèrent exceptionnellement de se raser le crâne pour aérer les pores de la peau et ainsi soigner certains maux de tête, malgré le risque d’une dépréciation publique.
« Stigmates » et hiérarchies socio-politique
Si la première partie de l’ouvrage visait à mieux circonscrire le sujet, la deuxième s’attache plus précisément à la question des stéréotypes et des préjugés souvent décelables à partir des railleries dont les chauves font l’objet, comme César qui fut moqué par ses troupes en 46 av. n. è. Si la question n’est pas si simple, dans la mesure où la calvitie est parfois valorisée, puisqu’elle peut signaler la sagesse du vieillard (comme l’illustre la statue du Togatus Barberini aux traits vieillis), les préjugés sont souvent tournés vers des considérations morales. L’analyse historique s’attache dès lors à dégager les raisons sociales, économiques et politiques qui structurent ces discours dépréciatifs.
Au regard de la dévalorisation qu’entraîne cette particularité physique, la calvitie volontaire implique une incompréhension chez une grande partie des populations, surtout vis-à-vis des prêtres d’Isis, dont les corps ne répondent à aucune des normes romaines. Cette incompréhension s’explique surtout parce que le rasage du crâne est révélateur du statut civique et juridique. En effet, cette pratique était communément réservée aux esclaves qui avaient reçu une promesse d’affranchissement, ce qui, à bien des égards, peut être assimilé à un stigmate, dans la mesure où il révèle davantage encore aux yeux de tous un statut subalterne. Proche du « rite de passage », la taille des cheveux signale le changement de statut, comme c’est également le cas pour l’enfant qui abandonne ses premiers poils de barbe pour marquer son passage à l’âge adulte. Néanmoins, le crâne rasé est bel et bien la marque des personnes au statut inférieur, puisque les acteurs (à la profession dépréciée et indigne) n’avaient pas non plus de cheveux. Plus encore, la tonte de la tête était, de façon plus récurrente, réservée aux esclaves fugitifs et aux condamnés aux travaux forcés : accompagnant le marquage au fer, elle constituait dans ce cas un véritable stigmate.
La tonte des cheveux éclaire donc les dispositifs de contrôle dans une société esclavagiste où les hiérarchies sociales et statutaires doivent être lues directement sur les corps. Le contrôle de soi, mais aussi de l’ensemble des populations, apparaît alors comme un des enjeux fondamentaux du livre, car il interroge, en creux, la définition même de la déviance corporelle à partir du poil. C’est donc la contrainte sur les corps qui est ici au centre du propos, comme l’illustre un épisode durant la révolte du brigand Bulla Felix de 206 de n. è. lors duquel les rebelles rasent le crâne d’un centurion fait prisonnier : par ce geste, ils transfèrent leur stigmate et, in fine, inversent les statuts. Cette infériorisation par les corps est parfois mobilisée par les historiens anciens pour affirmer la domination romaine sur le bassin méditerranéen. Ainsi, en 167 av. n. è., Prusias II, roi de Bithynie, se serait rasé le crâne pour manifester sa soumission au Sénat romain, tout comme plusieurs princes étrangers auraient fait tondre leur femme pour signifier leur deuil à la suite de la mort, en 19 de n. è., de Germanicus, pressenti pour succéder à Tibère. Certes, l’authenticité de ces épisodes est suspecte, mais ils témoignent de la valeur accordée aux cheveux dans le cadre de la manifestation de la domination, dans une société où la hiérarchie s’exprime particulièrement à travers l’apparence.
La calvitie comme outil de la dépréciation politique
La dernière partie du livre apparaît comme le cœur de la réflexion portée par les auteurs, dans la mesure où elle propose une analyse politique, non pas de la calvitie, mais des discours la concernant. Suivant un plan chronologique séquencé autour des grandes scansions académiques (République, Haut-Empire, Antiquité tardive), ces analyses ne se veulent pas exhaustives, mais se concentrent sur des cas particuliers, comme les procès d’époque républicaine durant lesquels la calvitie peut devenir un argument qui renforce l’accusation portée. En contexte militaire, plusieurs insultes sur les chauves, portées à haute voix ou inscrites sur des balles de fronde, associent la calvitie et la passivité sexuelle : en témoignent les outrages visant Lucius Antonius, le frère de Marc Antoine, assiégé à Pérouse en 41 av. n. è. et dont la légère calvitie est par ailleurs attestée par ses émissions monétaires.
La partie dédiée au Haut-Empire s’attache à l’étude privilégiée des empereurs et des logiques qui régissent la rédaction de leurs biographies. Les premières pages, assez longues, visent à éclairer les biais véhiculés par les sources aristocratiques, qui sont avant tout le reflet de la nature des relations qu’entretenait tel empereur avec le Sénat. Le corps des empereurs, décrit notamment par les biographes, doit ainsi être considéré à partir de lectures morales et politiques, et non comme une représentation réaliste. On comprend ainsi aisément pourquoi le premier empereur chauve évoqué par Suétone est Caligula, alors qu’on sait, grâce à Tacite et Cassius Dion, que Tibère l’était lui aussi. La réponse tient simplement aux relations que Caligula entretenait avec le Sénat. La calvitie apparaît alors comme une tare parmi d’autres qui, cumulées, permettent de brosser le portrait du mauvais empereur. Ainsi, selon Suétone, la jalousie de Caligula l’aurait amené à faire raser toutes les personnes aux belles chevelures qu’il croisait, afin de les « défigurer ». Finalement, après Domitien, qualifié de Néron chauve par Juvénal, la calvitie des empereurs n’est plus évoquée, ce qui signale un déplacement des considérations physiologiques et des valeurs exaltées par l’aristocratie. Ce phénomène est clairement attesté à partir des Antonins (IIe s. de n. è.), quand la calvitie totale ou partielle occupe une place de plus en plus importante dans la statuaire impériale, afin de mettre en valeur la sagesse qui découle de l’âge.
Le dernier point du livre porte surtout sur L’éloge de la calvitie rédigé au début du Ve siècle par Synésios de Cyrène (c. 370-413), le futur évêque de Ptolémaïs. Il s’agit du seul témoignage direct d’un chauve sur sa calvitie que nous ayons conservé pour l’Antiquité. Rédigé dans la plus stricte tradition de la rhétorique, l’œuvre se veut une réponse à L’éloge de la chevelure rédigé par Dion de Pruse trois siècles plus tôt et dont la lecture aurait heurté les sentiments de ce notable grec. Pour ce faire, l’auteur, qui témoigne d’un « lien émotionnel » avec ses cheveux désormais perdus, retourne l’ensemble des éléments disqualifiants de la figure du chauve pour en faire des qualités morales, physiques et intellectuelles. Cet éloge paradoxal permet à l’auteur de réfuter l’ensemble des stéréotypes, dont certains remontent à l’époque républicaine (laideur, stupidité, couardise, débauche, etc.). Sous sa plume, ce sont les chevelus qui, finalement, deviennent les efféminés, puisqu’ils sont contraints de prendre grand soin de leur apparence. L’argument de Dion de Pruse faisant des cheveux la marque du courage, comme l’attestent les pratiques spartiates, ne peut être soutenu, puisque les Lacédémoniens auraient été défaits lors de la bataille des Thermopyles après s’être brossé trop longuement les cheveux la veille. Au contraire, puisque les troupes d’Alexandre se rasèrent le crâne avant la bataille de Gaugamèles où ils vainquirent, ce sont bien les chauves qui l’emportent par la force.
En conclusion, les auteurs insistent sur les similitudes trompeuses entre nos sociétés et celles de l’Antiquité, pour mieux souligner toutes les différences qui les opposent. Le « territoire des écarts » que constitue l’Antiquité, comme le soulignait Florence Dupont, ne peut présenter que des analogies équivoques : les préjugés en défaveur ou en faveur de nos chauves ne sont pas ceux de l’Antiquité. Les sciences historiques se doivent ainsi de saisir avec rigueur les constructions culturelles propres à chaque objet historique, quand bien même il pourrait paraître atemporel. C’est ce que réussit à réaliser cet ouvrage, aussi instructif pour les spécialistes que pour le grand public.