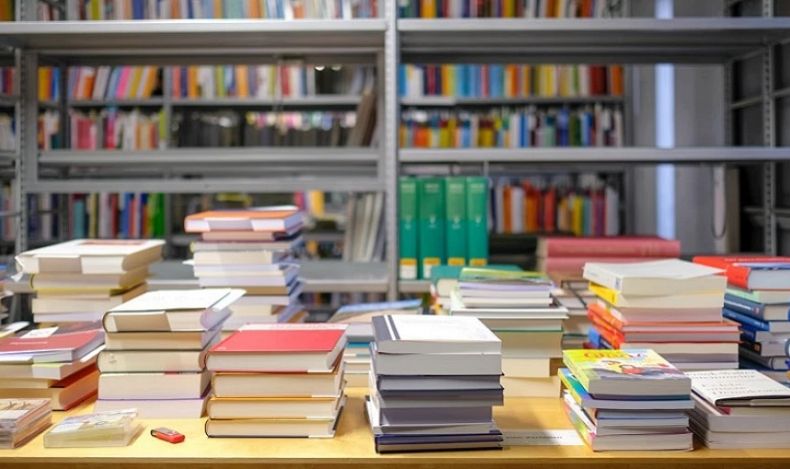Un essai dense et stimulant qui explore la figure de l’éditeur, à travers l’histoire, les discours et les représentations fictionnelles.
Professeur à l’Université de Sherbrooke (Québec), titulaire de la chaire de recherche du Canada sur l’histoire de l’édition et la sociologie du littéraire durant dix ans (2011-2021), Anthony Glinoer a consacré un grand nombre de travaux au sujet des maisons d’édition. Ce nouvel ouvrage s’inscrit ainsi dans la succession de son livre Les maisons d’édition francophones au prisme de leurs archives (direction, Éditions des Archives contemporaines, 2022), du numéro de Mémoires du livre/Studies in book culture sur les discours de l’éditeur (codirection avec Julien Lefort-Favreau, 2019) et de Naissance de l’éditeur (codirection avec Pascal Durand, Les Impressions nouvelles, 2008), qui a fait date. Ces derniers pointaient l’émergence des éditeurs, analysaient leurs propos, ou développaient des travaux monographiques (ce que Glinoer a également fait dans des articles, par exemple sur Fides). Ce nouvel ouvrage propose à la fois une synthèse de plus amples travaux, et vient apporter, notamment en troisième partie, un nouveau regard.
Dès la couverture, en sous-titre, un plan clair et efficace est annoncé : « Histoires », qui nous remémore Naissances de l’éditeur, « Discours », qui rappelle le numéro de Mémoires du livre, et « Imaginaires », une thématique jusqu’alors non abordée dans un aussi gros ensemble.
L’avènement des éditeurs
« Histoires » est sans doute la plus balisée des sections. Glinoer semble résumer de nombreux travaux passés, tout en les actualisant. Un certain déséquilibre se fait sentir puisque c’est la seule partie où le propos remonte à des périodes très anciennes – dans les deux autres cas, les sources sont au plus tôt modernes, souvent contemporaines, mais cela va de pair avec la naissance de la fonction d’éditeur.
La présentation est claire, on passe du manuscrit recopié à l’imprimerie, on traverse l’installation d’éditeurs-libraires-imprimeurs, puis le détachement des fonctions, le passage du feuilleton au livre… Des petites sections (sous forme d’encadrés) précisent tel ou tel point – un comparatif Laffont/Pauvert, un focus sur l’édition de poésie. Sont aussi décrites certaines stratégies, notamment celle, bien connue, des prix littéraires, etc. Le propos est solide, mais certains choix peuvent surprendre, telle que la relative absence de l’édition jeunesse ou d’image par exemple.
Comment les éditeurs prennent-ils la parole ?
« Discours » se penche sur la prise de parole des éditeurs, et tente d’en établir une typologie. Cette partie semble largement fondée sur une série d’articles parus dans Histoires littéraires entre 2021 et 2023. Les sections sont courtes, exemplifiées, très largement contemporaines même si l’ouverture par les catalogues de libraires-éditeurs permet de faire le lien entre le discours promotionnel déjà ancien, et la construction d’images liées. Chaque section remonte aux premiers exemples trouvés par Glinoer dans un impressionnant travail de fouilles archivistiques.
Il tente ensuite de développer les grands traits saillants de chaque type de propos. Un éditeur ne se dévoile pas de la même manière dans un recueil d’entretiens, dans un ouvrage anniversaire à la gloire de sa structure, dans une préface que dans ses mémoires (pas toujours éditées par lui-même) ou un manifeste. Les années contemporaines ont produit une grande masse de sources. Glinoer y distingue les « livrets de famille » hagiographiques, de textes se voulant parfois plus audacieux et engagés, mais où l’éditeur a souvent le beau rôle, soit d’entrepreneur, soit de visionnaire, voire les deux. Il est également intéressant de noter que de manière générale, on trouve aussi bien des « editor » que des « publisher », pour reprendre une distinction anglo-saxonne, ce alors que les « editor » sont bien souvent des gens de l’ombre.
Dans cet ensemble, on notera aussi la volonté de recenser un certain nombre de « livres sur » (dictionnaires, pamphlets sur le milieu littéraire...) où le discours d’éditeurs est présent quoique moins directement. Si Glinoer cherche là aussi la trace de la diversité de l’édition, on reste néanmoins dans le champ de l’édition « littéraire » malgré la diversité des formes publiées Toutefois, alors que la bande dessinée a vu un très grand nombre d’ouvrages publiés (dans différents axes typologiques forgés par Glinoer) parlant des éditeurs, le neuvième art est singulièrement absent. Est-ce parce que cette forme a été largement portée éditorialement par les magazines plutôt que les livres ?
Cette réalité est indiscutable, mais depuis quarante ans, l’album occupe une place prépondérante et de très forts discours sur le sujet. Un petit focus est spécialement dédié aux éditeurs de poésie, mais se distinguent-ils vraiment des éditeurs de romans et essais ? Il aurait été intéressant de voir une analyse sous cet angle : le genre publié distingue-t-il l’éditeur dans sa façon de prendre la parole ? On ne le sait pas vraiment. Si l’on ne dispose sans doute pas de nombreux mémoires d’éditeurs de livres pratiques ou technique — ce qui est significatif, comme le relève l’auteur —, il existe tout de même des études sur d’autres genres que ceux étudiés, et elles auraient gagnées à être davantage mobilisées.
L’éditeur comme personnage de fiction
« Imaginaires », enfin, se penche sur la représentation des éditeurs dans la fiction, avec un peu de cinéma, une petite section sur la bande dessinée, mais un corpus largement centré sur le roman ou la biographie romancée. Une intéressante annexe réunit d’ailleurs ce corpus avec de brefs résumés. Glinoer a effectué de savantes recherches pour tenter de trouver des figures d’éditeurs avant le Dauriat des Illusions perdues de Balzac, qui fige pour un temps l'image de l’éditeur littéraire. On découvre alors la très méconnue Vraie Histoire comique de Francion de Charles Sorel (1858), dont le personnage principal mêle des traits de l'esthète, du commerçant, de l'ami des auteurs et du stratège…
On trouve là déjà esquissés plusieurs portraits de l’éditeur : le personnage vil uniquement intéressé par l’argent ou la distinction (au sens bourdeusien), celui qui veut s’élever au niveau des auteurs qu’il publie, l’amateur sincère prêt à se ruiner, l’éditeur-dictateur qui reprend avec force les œuvres proposées, presque co-auteur même s’il ne signe jamais de livre, le quasi-père de substitution, parfois. Aux romans s’ajoutent peu à peu des textes rendant hommage à des éditeurs : pièces atypiques, parfois même conçues sans intention de publication (le Jérôme Lindon d’Echenoz, d’abord lettre de deuil), soudain offerte à un grand public a priori peu sensible à ces détails littéraires.
Le relevé des titres parus sur les dernières décennies est édifiant : un véritable genre s’est créé, montrant à la fois un monde se parlant à lui-même et l’envie des auteurs (ou, parfois, collaborateurs) de témoigner de l’attachement profond à des figures de l’ombre. À ce titre, un point frappant est le constat sans appel que l’éditeur représenté dans la littérature, qu’il soit ou non fictionnel, est systématiquement « littéraire, parisien, indépendant, masculin, blanc, hétérosexuel » . Si ce n’est pas une surprise, cela ne cesse d’interroger alors même qu’un éditeur comme Actes Sud, à forte valeur symbolique et dont les fondateurs ont pris la parole dans le débat public (jusqu’à, pour l’une d’elles, devenir une éphémère ministre de la Culture), fait de son ancrage arlésien une constituante identitaire. On ne peut pourtant que rejoindre la conclusion, tant la démonstration est implacable — et de fait, s’il existe assurément des contre-exemples, ils ne viennent pas facilement à l’esprit.
Être éditeur n’est pas un ouvrage universitaire, et si l’aspect pointu de son sujet n’en fait sans doute pas un livre très grand public, l’auteur a bien en tête de s’adresser à une audience plus vaste. En témoigne un style limpide, qui ne quitte jamais le livre, et un usage limité de concepts complexes – ils sont en tout cas toujours définis en note. Cela n’empêche nullement la rigueur et la précision, mais il est agréable de voir qu’un effort particulier a été porté sur la transmission d’un travail scientifique. Pour peu que l’on s’intéresse au monde du livre, l’ouvrage vient remplir un espace entre les nombreux témoignages déjà existants, et met en lumière les stéréotypes, les absences et les récurrences, qu’il s’agisse d’éditeurs réels voulant construire leurs légendes ou de représentations fantasmées. L’approche pluridisciplinaire, mêlant histoire du livre, cultural studies, sociologie des pratiques culturelles, littérature comparée et bien d’autres, apporte une richesse de regards bienvenue.
Le seul reproche qu'on pourrait adresser à l'ouvrage est une impression d’inachevé, suscitée par le choix d’une thématique condensant trois sujets, les deux derniers mériterant des développements plus longs pouvant embrasser plus largement le champ éditorial. Ce sentiment est renforcé par le déséquilibre en termes d’ampleur chronologique ou de genres abordés entre ces parties. Qu’importe, le terrain est désormais solidement balisé, et Glinoer va jusqu’à parsemer à plusieurs reprises son texte de différents réservoirs de sources potentielles à explorer pour les chercheurs ou amateurs souhaitant approfondir.