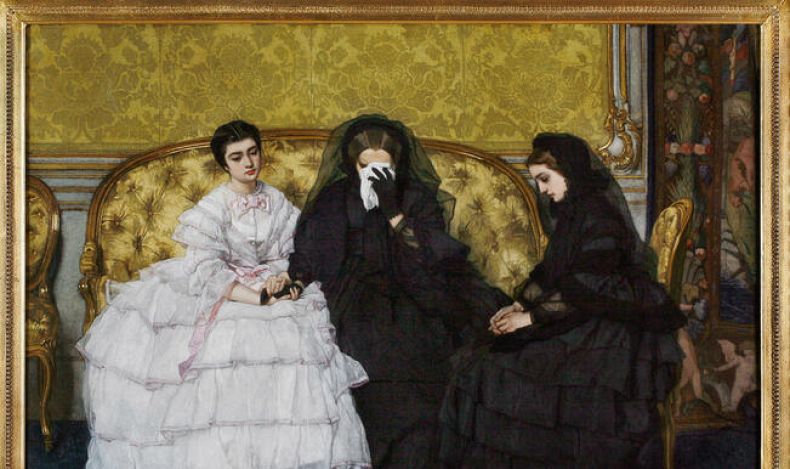Plus de deux cents textes composent ce véritable nuancier de la douleur où l’on découvre les stratégies déployées par les auteurs de l’Antiquité au XVIIe siècle pour consoler autrui.
Cette Bibliothèque idéale rassemble des textes écrits entre l’Antiquité et le XVIIe siècle. Au cours de cette période, la consolation est un motif récurrent. On la retrouve dans de nombreux genres littéraires, de la lettre au traité en passant par le dialogue, l’épopée ou encore le « dit » médiéval. Définie comme l’action de « dissiper ou du moins modérer » la souffrance d’autrui, elle se veut « perlocutoire », c’est-à-dire qu’elle « vise une efficacité sur le sujet souffrant ».
Or, comme le remarquent les autrices, « la consolation en tant que forme discursive ne fait plus guère partie du champ littéraire et semble avoir disparu de notre horizon culturel ». Le lien qui unit la consolation à la rhétorique s’est distendu parce que cette dernière est « jugée contraire à la sincérité ». Certes, nous avons encore besoin de réconforter autrui ou d’être réconforté nous-même, mais nous n’explorons plus les possibilités littéraires qu’offre la consolation. Soigner est pour nous le propre de la médecine, non de la littérature. De ce point de vue, les textes présentés dans cette anthologie peuvent déconcerter par leur caractère exhortatif : nous trouverions indélicat de consoler un prisonnier de guerre en affirmant, comme René Milleran, que « la prison n’est pas un si grand mal », et qu’être regretté dans tout Paris vaut mieux que « la plus belle liberté du monde » !
Le discours consolatoire ne saurait, pour autant, être relégué au rang des curiosités historiques. Il a son unité et son esthétique propre. « Face aux fléaux en tous genres qui affligent le genre humain s’est progressivement forgé un ensemble cohérent et structuré d’arguments et de procédés, largement diffusés et recomposés au fil du temps et des textes. » Pour donner à lire cet « ensemble cohérent », les autrices s’attachent à faire dialoguer les textes de façon thématique et historique. C’est l’approche historique qu’il nous semble le plus commode d’adopter ici, car même au sein des sections thématiques, les textes sont présentés dans l’ordre chronologique.
La sagesse antique ou l’art de consoler
Tout commence avec l’Iliade, plus exactement avec cette scène « paradigmatique » que constitue la visite rendue par Priam à Achille. Rappelons qu’Achille a tué Hector, le fils de Priam, pour venger la mort de son ami Patrocle. Lorsque Priam vient réclamer la dépouille de son fils, une étrange scène de consolation a lieu : Achille et Priam, pourtant ennemis, expriment ensemble leur douleur. Leur rencontre « donne lieu au premier discours de consolation de la littérature grecque qui nous soit parvenu ». On y trouve des arguments qui seront récurrents dans la littérature consolatoire : « 1/ le malheur est inhérent à la condition humaine ; 2/ les lamentations sont inutiles ; 3/ il faut contenir sa peine pour ne pas ajouter aux maux présents. »
Mais c’est surtout dans les textes philosophiques que la consolation se fait entendre. Ainsi Socrate, condamné à mort, réconforte les Athéniens en posant une alternative qui exercera une influence durable sur les discours visant à réconforter autrui : soit la mort n’est rien (c’est l’argument, devenu topique, de l’insensibilité post mortem), soit elle est une migration vers un ailleurs – dans les deux cas, elle n’est donc pas à craindre : « S’il est vrai […] que là-bas sont réunis tous ceux qui sont morts, que pourrions-nous imaginer de meilleur ? » Et Socrate d’ajouter que la mort est une occasion de faire société avec de célèbres défunts comme Orphée, Homère ou Ulysse. Dans le Phédon, il le redit à ses disciples : « Après avoir bu le poison, je ne resterai plus auprès de vous, mais […] j’irai vers des félicités qui appartiennent aux Bienheureux. »
Deux courants philosophiques vont également exercer une influence durable sur le discours consolatoire : l’épicurisme et le stoïcisme. C’est sans doute ce dernier qui est le mieux représenté dans l’anthologie. En effet, la pensée stoïcienne « insiste sur le rôle de l’opinion et de la volonté dans le chagrin » ; elle donne, de ce point de vue, un rôle important au consolateur dont la tâche est de ramener son destinataire à la raison. Plusieurs extraits de la Consolation à Marcia, œuvre de Sénèque, jalonnent ainsi l’ouvrage. Le philosophe y explique que la tristesse causée par la perte d’un être cher est un sentiment né du regret, donc de l’imagination . Nous nous représentons que les morts souffrent, alors qu’il n’en est rien puisqu’« [a]vec la mort s’évanouissent toutes les souffrances ». Il est, dès lors, nécessaire de se concentrer sur ce qui dépend de nous et de contenir sa peine : « [J]e ne puis avoir aujourd’hui ni complaisance ni ménagements pour une douleur si tenace : il faut la brutaliser », écrit le philosophe à celle qui a perdu un jeune enfant . À sa mère, inconsolable depuis son exil, il recommande encore de se consacrer à l’étude. En ce sens, le stoïcisme est une école de la consolation, qui entend nous convaincre que la tristesse « ne relève point de la nature, mais de notre libre choix et d’une opinion trompeuse » .
À partir du IIIe siècle, on entre dans l’ère chrétienne : la consolation est alors centrée « sur la notion d’épreuve et sur l’espoir de la résurrection ». Les auteurs exhortent ceux qui souffrent à endurer patiemment les épreuves qu’ils traversent. La mort elle-même est un réconfort : elle nous rapproche de Dieu.
Consolations médiévales : l’héritage de Boèce
Même si « dans le premier Moyen Âge des XIIe et XIIIe siècles, le genre de la consolation semble plus rare », la période médiévale occupe une place de choix dans l’anthologie. Une œuvre, la Consolation de Philosophie de Boèce, va exercer une influence déterminante sur des auteurs comme Jean de Meun (XIIIe siècle) ou Christine de Pizan (XVe siècle). Cette dernière évoque ainsi, dans Le Chemin de longue étude, sa lecture de ce livre et l’enseignement qu’elle en a tiré. Emprisonné en 524, Boèce imagine, dans l’attente de la mort, un dialogue entre une figure allégorique (Philosophie) et un condamné. Sa Consolation va devenir une référence dans l’histoire du genre : en premier lieu, elle introduit une forme nouvelle, le prosimètre, dans laquelle la prose et le vers se répondent ; en second lieu, elle pose une question fondamentale : « Qui, de la Philosophie ou de la poésie, est la meilleure consolatrice ? »
Ce débat est loin d’être tranché : si, au début du récit de Boèce, Philosophie chasse les muses, « sirènes de la douceur », pour s’imposer comme figure consolatrice, les œuvres de Guillaume de Machaut et de Charles d’Orléans ne laissent pas d’explorer les pouvoirs de la poésie et de l’imagination. Dans le contexte troublé de la guerre de Cent Ans, le discours consolatoire se fait allégorique et emprunte les habits de la fin’amor. C’est ainsi que « la consolation […] innerv[e] tous les textes lyrico-narratifs de Machaut, appelés “dits” ». Le poète y « mêle consolation amoureuse et consolation politique » : le chagrin provoqué par une défaite ou un emprisonnement prend les « couleurs d’une peine amoureuse ». Charles d’Orléans construit, quant à lui, « une lyrique toute d’intériorité où les forces de consolation ne peuvent être puisées qu’en soi ». Il explore ainsi une voie singulière dans les rondeaux et ballades écrits durant sa captivité, mettant en scène l’opposition entre Réconfort et Mélancolie. Au XVIe siècle, Jean-Antoine de Baïf fera encore l’éloge de la poésie : non seulement la Lyre apporte « soulas » et « réconfort », mais elle « rend aux esprits le bon sens ».
Rhétorique consolatoire à l’époque moderne
Un dernier tournant s’opère au XVIe siècle. La rhétorique se met au service de la consolation. Les lettres de réconfort font désormais partie des recueils de Lettres familières, preuve que le discours consolatoire est digne d’être publié : « Les correspondances entre les grands présentent des lettres de consolation ou de condoléances qui témoignent d’un art consommé de la rhétorique. » Mentionnons à cet égard la lettre émouvante adressée par Henri IV à Philippe Duplessis-Mornay pour la mort de son fils. Acteurs de ce phénomène, les traités épistolaires se développent. Celui d’Érasme, par exemple, servira de référence dans toute l’Europe, comme en témoigne la parution en 1586 du premier traité d’épistolographie en anglais .
La pratique de la lettre de réconfort n’est du reste, pas nouvelle en elle-même. Au IIIe siècle, Crantor de Soles a composé un traité – aujourd’hui perdu – qui a exercé une influence certaine sur l’œuvre de Cicéron ou celle de Plutarque. D’une manière générale, même si « la Renaissance a […] développé des pratiques singulières », les auteurs de la première modernité conçoivent leurs écrits consolatoires en dialoguant avec ceux de l’Antiquité. Montaigne en est un bon exemple, qui ne trouve pas les mots pour consoler sa femme et demande à Plutarque de le faire : « Je laisse à Plutarque la charge de vous consoler. »
Comment consoler efficacement autrui ?
L’une des questions qui traversent l’ouvrage est de savoir si la consolation peut s’avérer efficace pour consoler autrui. Et par quels moyens ? Si nous envisageons aujourd’hui la médecine et la rhétorique comme deux pratiques bien distinctes, il n’en a pas toujours été ainsi. L’analogie entre le médecin et le consolateur est par exemple filée par Plutarque dans la Consolation à Apollonios : « Le discours est un médecin pour l’âme malade. » On la retrouve sous la plume de Sénèque qui exhorte Marcia à ne pas se morfondre ou chez Cicéron qui, dans la troisième Tusculane, présente les moyens dont dispose la philosophie pour guérir « cette maladie de l’âme » qu’est le chagrin. Le consolateur devient celui qui met en garde le sujet souffrant : une douleur prolongée laisse des séquelles irrémédiables ; il faut vite se ressaisir.
Dans cette perspective, qui n’est pas propre à l’Antiquité mais traverse toute la période, celui qui écrit doit savoir se montrer ferme en exhortant le malade à « se relever ». C’est ainsi que le topos de « l’âme virile » se développe. « Et qu’y a-t-il de plus bas et de moins viril que de se laisser volontairement consumer par la douleur ? » demande Sénèque à Polybe. Similairement, Cicéron écrit à T. Fadius : « Ressaisis-toi ! Montre une âme virile. » C’est la prévalence de la polis sur les émotions qui est en jeu derrière cet argument. Dans de nombreux textes, on retrouve l’idée que la consolation doit comme endiguer la peine, même lorsque la cause de l’affliction est un événement grave. Chez Cicéron, par exemple, le réconfort « ne vise pas à éliminer le chagrin mais à le modérer et à en limiter les manifestations extérieures ». C’est pourquoi le philosophe enjoint à Titius – qui a perdu plusieurs enfants – de se montrer exemplaire : « Avec l’exemple que tu as toujours montré, dans ta vie privée, comme dans les affaires publiques, tu te dois d’être fidèle à ta force de caractère et esclave de ta fermeté. » Cette nécessité de contenir son chagrin est encore présente chez Pétrarque, qui imagine le dialogue entre Crainte et Raison. Tandis que la première répète qu’elle est effrayée par la peste, la seconde entend la rassurer en lui rappelant que la mort est chose banale. Or, « [q]u’y a-t-il de moins digne de l’homme que d’appréhender les choses les plus communes ? ».
L’exhortation ne serait toutefois pas efficace si elle n’était accompagnée, sinon de compassion, du moins d’une sensibilité sincère aux maux d’autrui. C’est ce que remarque Grégoire de Nazianze au IVe siècle : « Ceux qui prennent une part égale dans la douleur sont plus propres à consoler ceux qui souffrent. » Avant d’exhorter Antoine Sucquet à ne pas redouter la mort, Érasme s’adresse à lui en des termes compatissants : « La blessure que tu as reçue en tant que père, […] je peux, moi, facilement la deviner d’après ma propre douleur. » La consolation, en ce sens, repose sur un équilibre fragile entre l’expression du réconfort et l’incitation à dépasser la peine. Cet équilibre est parfois difficile à trouver, notamment lorsque le consolateur est lui-même inconsolable. Malherbe, annonçant à son épouse la mort de leur fille, ne peut contenir son chagrin : « [J]e fonds en larmes en vous écrivant ces paroles ; mais il faut les écrire. » Ovide, dans les Pontiques, regrette que son ami Rufinus ne puisse le consoler de son exil à Tomes : « Ton éloquence, écrit-il, n’a pas montré assez de force pour que tes paroles guérissent mon cœur. »
En définitive, le mérite de cette anthologie est de montrer la cohérence du discours consolatoire sur la période étudiée. En effet, les textes choisis sont traversés par des questionnements communs qui font de la consolation un genre à part entière. Une preuve de cela est qu’elle n’est pas seulement une pratique discursive, mais un sujet de réflexion pour les auteurs qui s’y consacrent. La section « Formes et genres » présente ainsi de nombreux textes théoriques qui visent à transmettre l’art de bien consoler – à l’image d’Érasme exposant les « trois façons de procéder pour faire une consolation ». Mais si la consolation est un art, elle ne peut offrir de recettes miraculeuses : les dernières sections du recueil interrogent, parfois avec humour, ses paradoxes ou ses apories . Lucien imagine ainsi les reproches qu’un fils décédé pourrait adresser à son père : « Pourquoi m’insulter en maudissant mon malheur et mon infortune, quand je suis à présent meilleur et plus heureux que toi ? » Mais, qu’il parvienne ou non à soigner l’âme de celui qui souffre, le discours consolatoire demeure un accès privilégié aux tourments de l’âme ; en ce sens, la Bibliothèque idéale nous rappelle, avec Christine de Pizan, que « [l]a peine est bonne quand elle instruit ».