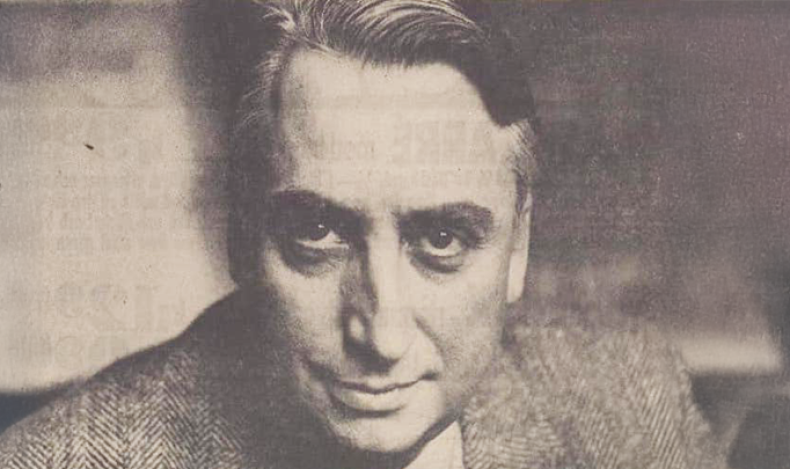336 entrées et quelque 1000 pages pour se souvenir combien la fréquentation de Barthes est intellectuellement vivifiante.
« Et puis au moins, en Cacanie, on se bornait à tenir les génies pour des paltoquets : jamais on n’eût, comme ailleurs, tenu le paltoquet pour un génie », écrivait l’ironique Robert Musil dans L’Homme sans qualités.
Ils furent nombreux, les universitaires des années 1960 (Raymond Picard en tête), à regretter qu’on ne fût pas en Cacanie, et que l’on accordât du crédit aux « impostures » de Barthes. Que diraient-ils à présent qu’on consacre des dictionnaires entiers à l’objet de leur colère ?
Aimer Barthes
Sans doute beaucoup des idées de Barthes sont-elles discutables – mais c’est précisément ce qu’on demande à un critique, à un théoricien : de susciter la discussion, d’enflammer le débat, de nous faire parler, avec passion, avec feu, jusqu’à la déraison, de la littérature. Deleuze disait qu’il ne fallait pas demander aux idées des philosophes d’être vraies, ou justes – mais belles : les idées de Barthes sont belles toujours, justes souvent, vraies parfois (même s’il n’avait pas l’ambition d’« écrire vrai », « les mots ne prouv[a]nt jamais rien »). Elles naissent toutes, sans exception, d’un amour profond pour les objets avec lesquels elles dialoguent, du texte à la mode, de la photographie au catch, de l’amour lui-même (ou du « discours amoureux ») au deuil. Et l’on sait gré à ce dictionnaire (amoureux à sa façon, quoique rigoureusement scientifique) de nous faire parcourir tout l’iris des enthousiasmes de Barthes, jusque dans ses moindres nuances. Tout le monde sait qu’il y a du rouge, de l’orange, du jaune, du vert, du bleu, de l’indigo, du violet dans un arc-en-ciel. Tout le monde sait qu’un Dictionnaire Barthes comportera des entrées « Balzac », « Fragment », « Musique », « Nouvelle critique », « Récit », « Sémiologie », « Voix ». Mais un arc-en-ciel est un dégradé de couleurs, en vérité ; et il fallait bien 336 entrées et quelque 1000 pages pour rendre justice à toute la délicate richesse de la pensée de Barthes.
Ouvrons, alors, ce fort volume aux pages dont on peut supposer qu’elles seront d’abord les moins fréquentées. L’article « Bathmologie », par exemple, nous rappelle combien Barthes était attentif au « jeu des degrés de sens dans lequel est prise l’interprétation de tout discours », au point de proposer ce néologisme dans Roland Barthes par Roland Barthes (1975), et de l’« illustrer la même année dans un article consacré à Brillat-Savarin ».
Naturellement, lisant le nom de l’illustre gastronome, on va voir dans la table des matières s’il n’y aurait pas une entrée « Nourriture ». Il y en a une, qui s’ouvre sur cette citation qui condense tout le génie péremptoire de Barthes : « Le problème des symbolisations alimentaires vaudrait à lui seul une encyclopédie. » On se souvient alors que les Mythologies (1957) traitaient, dans de véritables « instantanés ethnographiques », du « lait » et du « vin », du « bifteck » et des « frites », de la « cuisine ornementale ». On se souvient, aussi, que la section de Michelet par lui-même (1954) consacrée au « blé-silex » soulignait déjà la « double dimension anthropologique et psychologique de l’aliment ». On se souvient, enfin, que Sade, Fourier, Loyola (1971) analysait, chez Sade « les menus d’une alimentation extravagante, démesurée, hautement raffinée et coûteuse » ; chez Fourier « le culte de la gourmandise verbale ».
Michelet, Sade, Fourier, Loyola… On tourne déjà les pages pour aller chercher ces nouvelles entrées. Mais on a soudain l’impression d’être une mouche dont la patte a touché la toile de l’araignée, d’être Icare dans le labyrinthe : le dictionnaire « condamn[e] son utilisateur à une forme de vertige, à une sorte d’enfermement dans l’infini », prévient Claude Coste, le maître d’œuvre de ce Dictionnaire. Les mouches comme Icare, cependant, ont des ailes – même si c’est pour aller se prendre dans une autre toile, pour aller se noyer dans la mer. Alors on s’en remet au hasard, figure trompeuse autant que dérisoire de la liberté, et on rouvre le Dictionnaire à la p. 498 : « Moussu (figure) ». Barthes, un jour, allume une cigarette devant une dame rencontrée en Amérique – Madame Moussu. Cette dernière s’exclame : « Oh, mon fils dit toujours : Depuis que je suis entré à Polytechnique, je ne fume plus. » Le sémiologue moraliste commente : « C’est là une figure de rhétorique dans laquelle l’information principale et la seule, à savoir que son fils était polytechnicien, est donnée à travers une subordonnée. » Et l’on connaît tous quelqu’un à qui la vue d’un concombre rappelle sa soutenance de thèse, le spectacle d’un salon de coiffure ce concours de piano qu’il a gagné adolescent. Mais il n’y a pas que (sympathique) vanité et (bénigne) hypocrisie dans un tel « trope » : il contient au fond toute une poétique doublée d’une éthique. Quoique « très peu discrète », cette figure peut être retournée en un « exercice de délicatesse » qui permet au locuteur de « tempérer l’emportement, ce qui l’a point ». Et l’on songe, par association d’idées (car ce n’est tout de même pas tout à fait la même chose), à Stendhal faisant mourir Fabrice dans une proposition subordonnée : « La comtesse en un mot réunissait toutes les apparences du bonheur, mais elle ne survécut que fort peu de temps à Fabrice, qu’elle adorait, et qui ne passa qu’une année dans sa Chartreuse. »
Stendhal ? Mais, au fait, Barthes n’a-t-il pas « rédigé, en 1957, une préface à Quelques promenades dans Rome suivi de Les Cenci pour la Guilde du Livre à Lausanne » ? Si, mais on laissera le lecteur découvrir par lui-même comment « Barthes se reconnaît en Stendhal », célébrant avec lui l’Italie tout en reconnaissant « son échec à dire l’évidence de la sensation à laquelle elle invite ».
Un dictionnaire bien fait autant que bien plein
À ce dictionnaire il ne manque rien de ce qui fait un bon dictionnaire. Les entrées, intelligemment conçues et structurées, ne laissent rien d’important dans l’ombre, la chronologie est efficace, la bibliographie intelligemment sélectionnée, le double index des noms et (surtout) des notions bien pensé.
Et puis il y a cette belle introduction, où l’on retrouve la plume de Claude Coste telle qu’on avait appris à la connaître dans Roland Barthes moraliste (1998), dans Bêtise de Barthes (2011), dans Roland Barthes ou l’art du détour (2016) : élégante et assujettie au meilleur des maîtres, le bon sens (et il en faut, pour ne pas céder à la tentation de singer Barthes quand on le commente).
Barthes, rappelle Claude Coste dès l’abord, jugeait les dictionnaires « raisonnable[s] » (préface au dictionnaire Hachette, 1980) mais aussi (avec un brin de dédain peut-être) « rassurant[s] » (Mythologies). Un dictionnaire peut-il échapper à l’écueil de la rationalisation, peut-il ne pas appauvrir « le monde et la vie », qui sont « toujours plus riches que les dictionnaires qui tentent de maîtriser l’immaîtrisable, d’immobiliser et d’uniformiser la langue » ? Un dictionnaire peut-il être autre chose qu’un « dictionnaire flaubertien des idées reçues » ? Oui, mais à une double condition, en apparence (mais en apparence seulement) contradictoire. Que le lecteur, d’abord, adopte une posture critique et traite le dictionnaire comme un discours permettant de « prendre conscience des relations complexes que les mots entretiennent avec les choses », comme un « homéostat » qui, à l’instar de la Recherche proustienne, « pren[d] le monde en écharpe ». Que le lecteur, ensuite, adopte une posture amoureuse, sentimentale ou enthousiaste, comme on voudra, et comprenne qu’il y a au fondement de tout dictionnaire un optimisme antimoderne assez proche de celui que Barthes, dans Critique et Vérité (1966), prêtait aux écrivains : « Au fond, l’écrivain a toujours en lui la croyance que les signes ne sont pas arbitraires et que le nom est une propriété naturelle de la chose : les écrivains sont du côté de Cratyle, non d’Hermogène ».
On n’en dira pas plus, si ce n’est que c’est précisément pour de telles propositions invitant à la vigilance autant qu’à l’abandon que l’on aime Barthes – et pour sa fidélité à l’éthique de son héros éponyme que ce Dictionnaire saura se faire aimer.