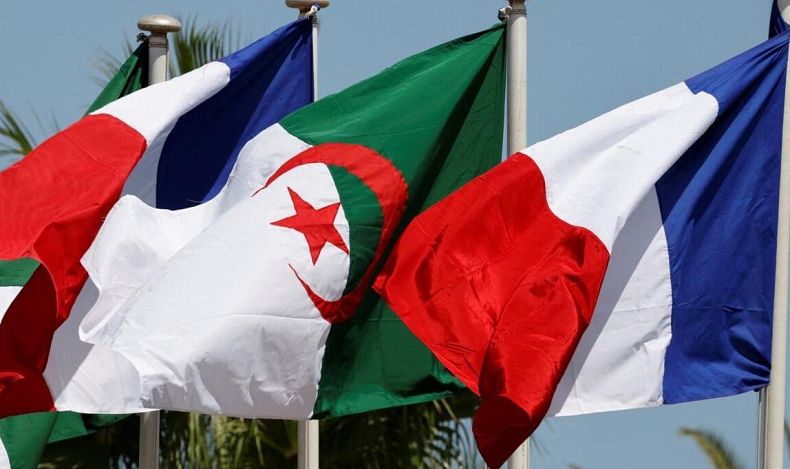Dans "Comment la France a (encore) perdu l’Algérie", la journaliste Mélanie Matarese documente et explique les raisons profondes des échecs politiques et stratégiques français en Algérie.
De part et d'autre de la Méditerranée les discours politiques qui traitent des relations diplomatiques de la France et de l'Algérie demeurent souvent empreints de ressentiment. Dans son ouvrage au titre évocateur et éminemment ironique, Comment la France a (encore) perdu l’Algérie, Mélanie Matarese propose une approche plus factuelle.
Riche d’une expérience de plus de quinze ans dans le journalisme et l’entreprenariat en contexte algérien, elle expose et dissèque avec une rigueur clinique les raisons des échecs politiques et stratégiques français en Algérie, et de l’impossible normalisation de la relation bilatérale franco-algérienne. Loin de tout manichéisme, elle critique aussi bien les dimensions coloniales de la politique française au sein de ses ex-colonies que l’enfermement algérien dans un anticolonialisme réactionnel et stérile légitimant d’insoutenables réflexes antidémocratiques.
La journaliste refuse de se résigner aux conséquences désastreuses du déficit de communication et de collaboration entre Paris et Alger. Elle propose pour cela d’intéressantes pistes pour dépersonnaliser les rapports interétatiques et repenser la relation bilatérale dans le sens d’un meilleur investissement des innombrables potentialités économiques, politiques, géographiques, mais surtout humaines, qui réunissent les deux pays.
Nonfiction.fr : Pouvez-vous nous expliquer le sens du « encore » inséré en rouge et entre parenthèses dans le titre de votre livre ?
Mélanie Matarese : Le choix du mot « encore », sciemment provocateur, ne renvoie bien sûr à aucune nostalgie de cette Algérie française perdue, mais plutôt à un constat établi depuis mon installation à Alger. En vingt ans, j’ai vu la France à la peine pour décrypter les dynamiques sociales et politiques, commettre des erreurs d’analyse et adopter parfois des comportements inappropriés. Cette difficulté à s’adapter, dans un pays en pleine construction et face à des puissances étrangères émergentes particulièrement offensives (Turquie, pays du Golfe), a inévitablement conduit à un recul de l’influence politique, économique et culturelle française.
En réalité, cette perte d’influence, à laquelle s’est greffée une crise de confiance et de capacité à construire un dialogue apaisé, a commencé dès 1962. Depuis l’indépendance, la relation entre les deux pays est restée marquée par des cycles récurrents de tensions et de réconciliations avortées. La situation n’a fait qu’empirer ces dernières années. Mon intention avec ce titre est donc d’inviter à une réflexion sur les choix stratégiques et les postures politiques adoptés par la France, qui contribuent à nourrir les malentendus et les crispations dans cette relation si particulière.
Vous rappelez que, depuis l'indépendance, l’Algérie est pour Paris un État difficile à « lire » de l’extérieur, « un trou noir », une « masse dense et complexe d’où la lumière ne peut s’échapper et à proximité de laquelle l’espace-temps est distendu ». Pour vous, cette « centralité refoulée » de la décolonisation algérienne , explique-t-elle l’incapacité des gouvernements français à penser la complexité du système politique algérien, à changer leur regard monolithique sur ce pays ?
La relation entre la France et l’Algérie reste façonnée par l’histoire coloniale et la guerre d’indépendance. L’expression de Nedjib Sidi Moussa sur la « centralité refoulée » illustre bien cet héritage : la décolonisation algérienne est un point névralgique, jamais pleinement assumé, qui influence la façon dont la France appréhende l’Algérie contemporaine.
Depuis 1962, les gouvernements français abordent la plupart du temps l’Algérie sous un angle affectif et mémoriel, plutôt que politique et stratégique. Cette posture s’explique en partie par le poids symbolique de la guerre d’indépendance, qui a laissé des cicatrices profondes dans la société française. La France oscille ainsi entre fascination et incompréhension, s’accroche parfois à des schémas dépassés pour tenter de maîtriser les paradigmes algériens. Ce prisme colonial conduit à une vision réductrice du pouvoir algérien, perçu comme opaque, autoritaire et imprévisible.
Pourtant, l’Algérie est un État traversé par des jeux de pouvoir complexes où coexistent plusieurs forces – entre autres l’armée, les élites civiles et économiques, les réseaux informels. Méconnaître cette réalité conduit la France à reproduire les mêmes erreurs : s’appuyer sur une élite francophone déconnectée des cercles d’influence réels, ou encore privilégier des interlocuteurs en perte de crédit auprès du pouvoir algérien.
On voit bien que Paris a du mal à se départir du « logiciel » de la Ve République, bâtie dans le contexte de la guerre d’Algérie, avec l’histoire de la déchirure algérienne inscrite dans son ADN politique. Cela est apparu très clairement à maintes reprises ces dernières semaines : les médias, en particulier, sont enfermés dans une vision biaisée de l’Algérie. L’État algérien est perçu comme malfaisant, mu par un seul objectif : nuire à la France. Et pour cela, il manipule et finance ses ressortissants clandestinement installés en France pour déstabiliser l’ancien colonisateur. Ces lectures délirantes et irrationnelles ont mis à jour l’inconscient d’une partie des élites françaises qui n’ont toujours pas digéré que l’Algérie soit devenue indépendante.
En Algérie, « le logiciel français balance entre le paternalisme et les clichés », écrivez-vous. Qu’est-ce qui explique la persistance d’un tel logiciel hérité du colonialisme ? Serait-il juste de parler dans ce cas de complexe de supériorité ?
La persistance du « logiciel français » en Algérie s’enracine dans l’histoire coloniale et dans la manière dont la France continue de percevoir ses anciennes colonies. Cette approche, structurelle, dépasse les individus et les gouvernements : elle résulte d’un héritage institutionnel et mental profond.
La colonisation de l’Algérie a laissé une empreinte durable sur les représentations françaises. L’Algérie n’a pas été simplement un territoire sous influence, mais une colonie de peuplement, administrée comme une partie intégrante du territoire français. Cette spécificité a forgé une relation singulière, marquée par des liens affectifs, identitaires et politiques complexes. Après l’indépendance, la France n’a jamais pleinement intégré cette rupture dans sa manière de penser l’Algérie. Une forme de nostalgie post-impériale s’est installée, où Paris a continué à considérer Alger comme un prolongement naturel de sa sphère d’influence.
La France a souvent adopté une posture moralisatrice, pensant détenir les « bonnes pratiques » en matière de gouvernance, de démocratie ou de gestion économique, ce qui alimente un discours condescendant. Emmanuel Macron a fourni un beau cas d’école, avec ses propos rapportés en 2021 par Le Monde. Lors d’une rencontre avec de jeunes Franco-Algériens et Français ayant un lien avec la guerre d’indépendance, le président avait déclaré : « La construction de l’Algérie comme nation est un phénomène à regarder. Est-ce qu’il y avait une nation algérienne avant la colonisation française ? Ça, c’est la question ». La relation bilatérale mettra plus d’un an à dépasser le cataclysme diplomatique que ces mots avaient provoqué.
Le même logiciel est à l’œuvre quand, en 2017, à Ouagadougou, Emmanuel Macron blague au sujet de son homologue burkinabé en disant : « Du coup il s’en va ! Il est parti réparer la climatisation ! », ou quand, en décembre 2024, il lance aux habitants de Mayotte, dévastée par le cyclone Chido : « Si c’était pas la France, vous seriez 10 000 fois plus dans la merde ! »
Dans les anciennes colonies comme en Algérie, ce type de comportement est particulièrement mal perçu, car il réactive des souvenirs douloureux liés à la période coloniale et nourrit un rejet viscéral de toute ingérence extérieure.
La question coloniale demeure irrésolue entre la France et l’Algérie. Pour vous, qu’est-ce qui empêche la France officielle de sortir de la novlangue des euphémismes ahistoriques (par exemple, « la colonisation est une histoire douloureuse ! ») et de qualifier le moment colonial en Algérie (1830-1962) d’entreprise criminelle et inhumaine ?
D’abord, la Ve République s’est construite dans le contexte de la guerre d’Algérie, et les élites politiques françaises restent, pour beaucoup, héritières de cette histoire. Reconnaître pleinement la violence coloniale reviendrait à fragiliser certains récits fondateurs de l’État français, notamment celui d’une République universelle et émancipatrice. Une reconnaissance trop frontale pourrait être perçue comme une forme d’humiliation à l’intérieur de l’État profond français, notamment dans certains milieux politiques et militaires.
Ensuite, la colonisation et la guerre d’indépendance ont laissé des traces profondes dans la société française : anciens colons, rapatriés, harkis, immigrés algériens et leurs descendants portent des mémoires souvent douloureuses et conflictuelles. Reconnaître la colonisation comme une « entreprise criminelle » risquerait de raviver ces tensions à l’intérieur d’une société française déjà fracturée et d’alimenter des clivages politiques.
Loin de la binarité franco-algérienne, vous avez consacré d’intéressantes pages à l’Italie. Qu’est-ce qui distingue la relation qu’entretiennent Alger et Rome de celle entretenue avec Paris ?
Contrairement à la France, l’Italie n’a pas de passé colonial en Algérie, ce qui l’exonère du lourd contentieux mémoriel qui pèse sur les relations franco-algériennes. Cette absence d’héritage conflictuel permet à Rome d’adopter une posture plus neutre, qui facilite les échanges économiques et diplomatiques fondés avant tout sur des intérêts mutuels dictés par du pragmatisme.
Un acteur clé illustre cette dynamique : Enrico Mattei, fondateur de l’entreprise pétrolière italienne ENI. Dans les années 1950 et 1960, Mattei avait compris l’importance stratégique de l’Algérie et soutenu activement le FLN (Front de libération nationale) en pleine guerre d’indépendance. En défiant les grandes compagnies pétrolières internationales, Mattei avait noué des liens solides avec les dirigeants algériens, misant sur une coopération fondée sur le respect de la souveraineté nationale et des accords commerciaux équitables. Ce positionnement a contribué à forger une confiance mutuelle Alger et Rome, qui perdure aujourd’hui.
L’Italie s’est ensuite imposée comme un partenaire clé dans le secteur énergétique, avec des accords stratégiques sur le gaz et le pétrole. La proximité géographique et la complémentarité des besoins énergétiques ont favorisé cette coopération. En période de crise, comme lors de la guerre en Ukraine, l’Italie a su renforcer ses liens avec Alger pour sécuriser son approvisionnement énergétique.
On pourrait se demander comment ce climat de confiance est possible, alors que le gouvernement de Giorgia Meloni, ouvertement d’extrême droite, aurait pu compliquer ces relations. Ce paradoxe s’explique en grande partie par les garde-fous mis en place par l’État profond italien, qui veillent à préserver des relations équilibrées et à protéger les intérêts de l’État. Un exemple ? Rome résiste de manière catégorique à toute reconnaissance de la « marocanité » du Sahara occidental…
Par-delà la paresse des invectives culturalistes fustigeant la « haine de la France » et le « rejet de l’universel » qui seraient constitutifs de « l’identité profonde du peuple algérien », quel est le message que veulent transmettre les hypernationalistes, les souverainistes et les islamo-conservateurs en critiquant la France et sa langue ?
En Algérie, et peut-être de manière plus évidente encore dans les anciennes colonies françaises en Afrique, c’est une façon de dénoncer la complaisance récurrente des gouvernements français envers les pouvoirs qui se sont succédé. Aux yeux de ces courants, Paris n’a cessé de privilégier la stabilité politique et la préservation de ses intérêts économiques au détriment du soutien aux aspirations démocratiques des Algériens.
La langue française se retrouve alors prise dans ce débat comme un symbole de cette emprise persistante. Pour certains courants souverainistes, critiquer la place du français en Algérie revient à remettre en cause les liens culturels et intellectuels perçus comme les vestiges d’une domination coloniale jamais totalement rompue. Ce rejet ne s’attaque donc pas à la langue en tant que telle, mais plutôt à ce qu’elle incarne dans les rapports de pouvoir et les élites souvent accusées d’être inféodées à des intérêts étrangers.
L’ambassade de France et les réseaux politico-culturels qui gravitent dans son orbite ne s’intéressent quasiment qu’aux écrivains de langue française, et n’accordent aucune importance à ceux qui écrivent en langue arabe, lesquels sont francophones dans certains cas. Voyez-vous dans cette invisibilisation de la majorité culturelle et linguistique du pays un rejet de l’Algérie arabophone ?
Je vois surtout dans cette focalisation sur les écrivains francophones une forme de paresse intellectuelle et la persistance d’une croyance tenace : celle que le français demeure la langue d’un empire encore tout-puissant.
Plutôt que de s’intéresser à la richesse et à la diversité du paysage culturel algérien, les institutions françaises restent enfermées dans une vision dépassée où la francophonie constitue encore un espace d’influence privilégié. Comme si le rayonnement du français suffisait à garantir une forme d’influence durable. Cette posture traduit moins un rejet délibéré de l’Algérie arabophone qu’une difficulté à accepter que la langue française, en Algérie comme ailleurs, n’est plus le vecteur exclusif du savoir et de la création intellectuelle. Elle révèle finalement moins un positionnement stratégique réfléchi qu’une forme de déni face à l’évolution du monde.
Pour finir, la grande proximité des sociétés algériennes et françaises pourrait-elle contrebalancer les agissements des adversaires de la relation bilatérale entre la France et l’Algérie ?
Les liens humains, culturels et sociaux qui unissent les sociétés algérienne et française échappent au politique, ils le dépassent, le contournent, se jouent même parfois de lui. Et c’est précisément cette force qui finira par ouvrir la voie à une réconciliation véritable et sincère.
Je suis persuadée que c’est dans cette capacité qu’ont les populations des deux rives à créer des ponts informels, à dialoguer, à partager, à panser leurs blessures, à se construire une mémoire commune en marge des récits nationaux, à construire ensemble, que réside le véritable moteur d’un apaisement durable.
Le politique, algérien comme français, doit bien réfléchir à cela : veut-il accompagner cette dynamique en la soutenant et en l’encourageant – c’est-à-dire aller dans le sens de l’histoire – ou veut-il s’y opposer, au risque de s’exclure d’une dynamique qu’il ne pourra ni freiner ni contrer ?