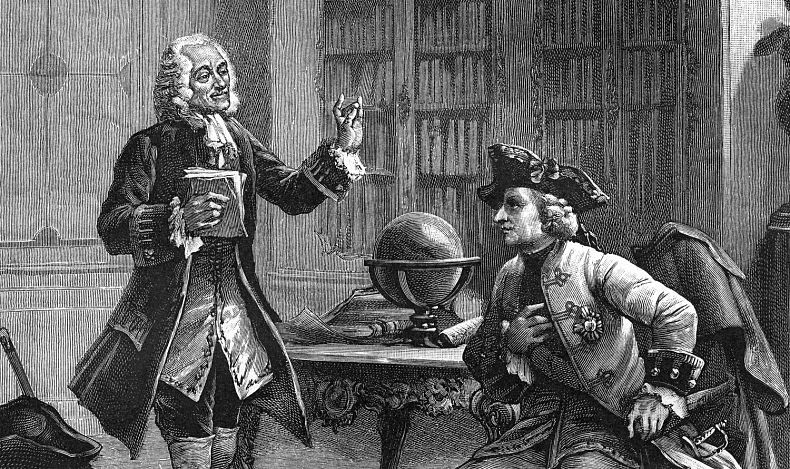Fanny Lederlin interroge le rôle transformateur de la critique aujourd'hui, dans un monde en crise voué à la post-vérité et au complotisme.
Depuis le XVIIIe siècle et le mouvement des Lumières, l’esprit critique s’est érigé en tribunal universel, condamnant le despotisme, le dogmatisme et les injustices. Il examine les conditions de possibilité de chaque objet de pensée et parcourt tous les domaines de la vie sociale, culturelle ou personnelle dont il traque les illusions.
En écrivant un ouvrage intitulé Critique en crise, Fanny Lederlin poursuit une réflexion déjà amorcée dans ses travaux précédents, en se focalisant sur la « méthode » critique. Cette approche repose sur une double exigence, héritée de deux penseurs majeurs de la critique dans la modernité : d’une part, comme l’a établi Kant, il s’agit de fonder en soi-même les principes qui guident la critique, et d’autre part, comme l’a posé Marx, il s’agit d’expliciter les finalités qui orientent la critique.
Chez Marx, en l’occurrence, la critique a vocation à changer le monde. Or, c’est là le cœur du propos de l’autrice : les crises sociales, politiques et écologiques que nous vivons actuellement ont-elles provoqué une crise de la critique qui la rend désormais impuissante à remplir sa fonction ? Et inversement, une crise de la critique nous rend-elle toujours plus aveugles aux crises que traverse le monde contemporain ? L’ouvrage fait le pari qu’une réflexion rigoureuse sur la nature et le rôle de la critique permettrait d’en réactiver la radicalité et l’effectivité.
Temps sombres pour la critique
Quoiqu’elle ne se contente pas de dresser un bilan historique de la critique depuis les Lumières, Lederlin en retrace les évolutions marquantes. Elle s’arrête notamment sur Karl Marx, qui a radicalisé la critique en l’orientant vers une transformation effective du réel. La célèbre onzième Thèse sur Feuerbach rappelle ainsi que la critique ne doit pas seulement « interpréter le monde » (ou décrire ce qui est), mais « le changer » (ou faire advenir ce qui devrait être).
Cependant, l’autrice ne s’arrête pas à ce constat et entreprend d’évaluer l’état actuel de l’esprit critique, dans un contexte où la réalité sociale et politique nécessite de grands changements. Elle affirme que nous « vivons actuellement un mouvement réactionnaire qui peut faire redouter l’éclosion de nouveaux “sombres temps” ». Et d’énoncer ensuite ce à quoi elle fait référence : « le renouveau des fondamentalismes religieux, la propagation du terrorisme, l’exaltation des nationalismes, le regain des conflits armés, le déferlement des sentiments xénophobes et racistes, le retour de l’antisémitisme et les percées de l’extrême-droite, pour ne pas parler de l’arrivée au pouvoir de dirigeants populistes… » Dans ce contexte, l’exercice de l’esprit critique est devenu particulièrement délicat.
D'après l'autrice, la menace majeure qui pèse sur nos sociétés et qui empêche le déploiement salutaire de la critique réside dans la domination du calcul de l’intérêt. Celui-ci écrase la raison et prime sur la délibération publique. Ce triomphe d’un rationalisme dévoyé, parfois résumé sous le terme de « post-vérité », favorise un ordre injuste auquel nous sommes sommés de nous adapter (comme le décrivent les travaux de Barbara Stiegler). S’appuyant sur les analyses d’Hannah Arendt, Lederlin analyse les effets de cette logique de calcul et de manipulation. Elle met en lumière les formes contemporaines de solitude, d’atomisation et de désolation ainsi que l’emprise des mensonges d’État et des distorsions médiatiques. Des pages particulièrement pertinentes sont consacrées aux dérives auxquelles on assiste sur les plateaux de télévision, les réseaux sociaux ou certains espaces publics : entre complotismes et fondamentalismes, banalisations des mensonges et détournements des propos.
La critique face à elle-même
Pour l’autrice, cependant, il ne suffit pas de dénoncer la crise de la critique ; il faut encore la soumettre elle-même à un examen critique. Que peuvent encore la méthode de la critique et l’attitude héritée des Lumières ? De quoi la critique est-elle encore capable ?
L’ouvrage interroge la responsabilité de la critique dans les dérèglements du monde contemporain. « La critique ne s’est-elle pas rendue complice des dérèglements survenus dans le monde depuis longtemps, et en particulier récemment ? » L’autrice évoque ainsi les dérives historiques de la critique, notamment sous la Terreur révolutionnaire et les totalitarismes du XXe siècle. Elle distingue alors la volonté de comprendre le monde de la prétention à le remodeler selon une raison totalisante, rejoignant ici les thèses de l’École de Francfort.
Mais la critique ne saurait se cantonner à une perspective occidentale. Lederlin explore les apports d’autres traditions de pensée, longtemps marginalisées : les visions critiques issues de l’Orient, des Tropiques ou encore celles portées par les figures de l’utopiste, de l’uchroniste, du vaincu ou de l’exilé. Elle met en évidence les tensions entre la prétention de la critique européenne à l’universel et la reconnaissance de la diversité des expériences et des formes de pensée. Cela la conduit à un problème : comment sortir de l’impérialisme culturel tout en assumant l’héritage de la raison critique ? Peut-on articuler un universel sans surplomb, qui ne reproduise pas les exclusions du passé, avec une acceptation du particulier, de l’exception, du bizarre ou du queer ?
Vers un nouveau rapport au monde
Avec sa méthodologie propre et son analyse ancrée dans la notion de critique, Lederlin propose une réflexion sur notre rapport au monde en tant qu’Occidentaux, héritiers des Lumières. Il ne suffit plus d’affirmer que l’on a raison parce qu’on se réclame de la raison. Il est nécessaire, aujourd’hui, de croiser les perspectives sur la raison et de redonner sens à l’émancipation dans un monde que l’on cherche à partager plutôt qu’à occuper.
Pour brosser ces perspectives, l’autrice s’inscrit dans un dialogue fécond avec des penseurs contemporains tels que Bruno Latour, Agnès Varda, Michel de Certeau, Tristan Garcia ou encore Donna Haraway.
Au total, l’ouvrage ne consiste pas en un constat d’impuissance mais en une invitation à repenser l’acte critique pour qu’il retrouve sa capacité à transformer le monde.