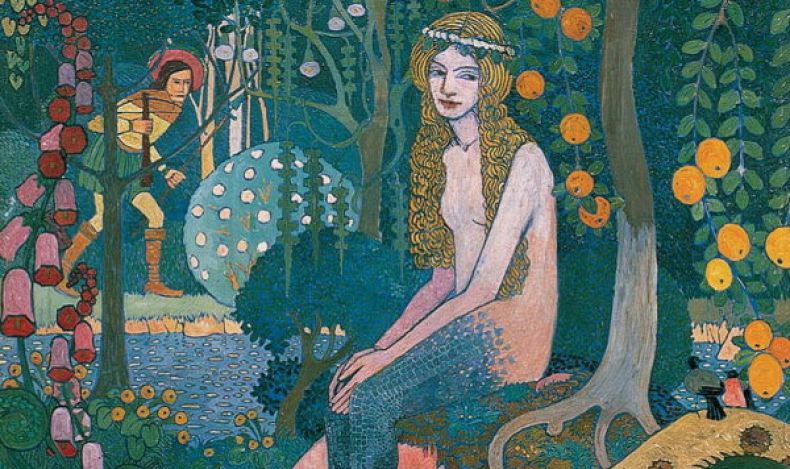Une somme impressionnante de savoir et d’aisance spéculative, qui nous invite à observer l’évolution des pratiques et des discours attachés aux menstrues, d’Aristote et Hippocrate à nos jours.
Les règles constituent un des derniers tabous dont les mouvements féministes veulent libérer les femmes. Depuis le début du XXIe siècle, le sang menstruel a commencé à devenir public : il est décrit dans les interviews des athlètes et donné à voir dans les publicités comme une manifestation corporelle dont il ne faudrait plus avoir honte.
À partir de ce constat d’actualité qui pourrait presque paraître relever de l’évidence, Marie de Gandt, maîtresse de conférences en littérature comparée à l’université de Bordeaux (et, pour l’anecdote, ancienne plume de Nicolas Sarkozy), développe une réflexion sur l’objet menstruel impressionnante d’érudition et d’aisance spéculative.
Une Antiquité pas aussi misogyne qu’on ne le croit ?
S’il est impossible de rendre justice à la richesse de ces quelque six-cents pages en une poignée de paragraphes, on peut facilement en dégager quelques-unes des hypothèses structurantes. Parcourant un immense corpus qui va d’Aristote et Hippocrate à Paul B. Preciado en passant (entre tant d’autres) par Pline l’Ancien, Jean d’Arras, Paracelse, Diderot, Michelet, Freud, Simone de Beauvoir, Judith Butler et Luce Irigaray, l’auteure Marie de Gandt affirme en effet quelques idées fortes.
Ainsi, le postulat selon lequel la vision misogyne des règles existait déjà dans l’Antiquité grecque est, d’après elle, une erreur fondée sur des interprétations (et des traductions) erronées, abusives ou maladroites des textes antiques – et en particulier des traités hippocratiques. Elle conteste de la sorte la thèse selon laquelle « la médecine grecque attribuait aux femmes une impureté bestiale ». Au contraire, répond-elle, « les textes grecs antiques soulignent le caractère sain de la menstruation ». De fait, « les seuls passages qui décrivent des règles impures renvoient à un état maladif ». Insistant beaucoup sur ce point, Marie de Gandt dialogue notamment avec les travaux de l’historienne de la médecine grecque Helen King, selon qui, chez les Grecs, « le surplus menstruel [serait] toujours lié au déséquilibre féminin ». Pour Marie de Gandt, cependant, « deux réserves peuvent être formulées » face à une telle lecture. À ses yeux, les règles, pour Hippocrate, ne seraient pas « la marque d’une différence de nature, mais de quantité, avec le corps masculin » : par suite, il y aurait « communauté de mesure » entre les sexes. En outre, « il ne faut pas toujours considérer un surplus de liquide comme un défaut ». « On néglige trop le fait que l’équilibre hippocratique du corps, qu’il soit féminin ou masculin, n’implique pas l’assèchement, mais le maintien d’une humidité mesurée ».
Si misogynie il y a, c’est plutôt au moment du tournant plinien qu’elle prend forme. « À ma connaissance », écrit Marie de Gandt avec la prudence et la modestie qui la caractérise tout au long de l’ouvrage, « le caractère maléfique des règles se trouve mentionné pour la première fois par Pline l’Ancien. » Dans son Histoire naturelle, de fait, ce dernier note :
On trouverait difficilement plus monstrueux que le flux d’une femme. À son arrivée les moûts tournent, les céréales qu’elle touche sont stériles, les greffons meurent, les graines des jardins sont brûlées, les fruits des arbres […] tombent, l’éclat des miroirs est terni à sa vue, la pointe du fer s’émousse, le brillant de l’ivoire s’assombrit, les ruches des abeilles meurent, même le bronze et le fer sont corrodés par la rouille et le bronze contracte une odeur terrible, à son goût les chiens deviennent enragés et leur morsure inocule un mal incurable.
C’est sur cette base, notamment, que se développera au Moyen-Âge l’association des règles avec la figure de la sorcière, Marie de Gandt signalant (et prouvant) l’importance de « l’intertexte plinien dans les textes médiévaux et renaissants ». Elle précise ainsi que l’« inflexion [plinienne] de la représentation menstruelle repose sur une théorie de la matière qui déploie tous les éléments que l’on retrouvera dans les récits de sorcellerie ».
Les règles, un impensé du féminisme au XXe siècle ?
À l’autre extrémité (ou presque) du spectre temporel et historique, Marie de Gandt décèle une sorte de paradoxe : les féministes du XXe siècle ont contribué involontairement, et sans qu’il s’agisse de le leur reprocher, à ce qu’on pourrait appeler le dénigrement voire l’effacement des règles.
Plus largement, elle remarque que les « héroïnes de la littérature [féminine du XXe siècle] sont généralement très pudiques avec leur lectorat, ou très mal réglées ». Virginia Woolf, ainsi, passe les règles sous silence – et c’est plutôt chez Joyce qu’il faut chercher, avec la Molly Bloom de Ulysses, la « première figure littéraire évoquant elle-même ses règles ».
Mais c’est surtout chez les féministes des années 1970 que l’occultation des règles surprend :
Un des objectifs du féminisme de la seconde moitié du XXe siècle visait à permettre aux femmes de se réapproprier leur corps. Apparence physique, jouissance, maternité sont autant de faits corporels dont les femmes ont progressivement conquis la maîtrise. Mais la menstruation est restée à l’écart de cette libération corporelle, dans les pratiques et dans les discours – y compris dans les textes centraux du féminisme des années 1970.
Il y avait eu pourtant, en 1949, la parution du Deuxième sexe. « Pour la première fois », écrit Marie de Gandt à propos du maître-ouvrage de Simone de Beauvoir, « la menstruation figurait dans un livre qui n’était ni un ouvrage médical ni un traité théorique ». « De nombreuses lectrices », ajoute-t-elle, « ont pu mettre des mots sur leur expérience corporelle, et psychique, grâce à Simone de Beauvoir ». Quoique « libératrice », l’étude de Beauvoir, cependant, ne se déprenait pas encore de l’imaginaire des « règles » comme « fléau ».
« Le thème menstruel », en tout cas, sera « absent des études de genre » aussi bien que de la « pensée queer » – même si celle-ci « reprend[ra] l’image fluidique qui imprégnait l’écriture féministe ». Marie de Gandt décrit ainsi une « reprise d’héritage par-dessus les gender studies », qui aboutit à une queerisation des menstrues. Commentant le Testo Junkie de Paul B. Preciado, elle note :
Dans ce livre, les flux figurent parmi les éléments d’une liquidité détournée de sa naturalisation pour entrer dans une circulation générale, qui métamorphose les catégories des sexes autant que celles des organes et des fonctions, et qui défait la distinction entre naturel, corporel, chimique et technologique.
Les règles, du sang au temps
Reste que le livre de Marie de Gand s’intitule L’Autre Temps des femmes. Pourquoi donc ? Parce que, selon l’auteure, si les représentations des règles comme sang, fluide, écoulement, résidu méritent d’être commentées, discutées, contestées, les discours sur les liens entre menstruation et temporalité (féminine) doivent également faire l’objet d’une lecture critique minutieuse. En effet, les discours sur ou autour des règles sont eux-mêmes travaillés en creux par un autre « impensé » de première importance :
Derrière les mythes modernes du cycle nourrissant l’imaginaire actuel sous la fausse patine des croyances ancestrales ou des faits éternels, derrière la variabilité culturelle que ces mythes recèlent, jusqu’à leur remise en question aujourd’hui par une pensée antimoderne visant à libérer le corps de sa normalisation, un élément constitutif du temps menstruel est passé inaperçu de la fascination collective (mais pas de la thérapeutique, ni du diagnostic) : la régularité des règles.
Marie de Gandt s’attache donc à penser cet impensé, dans une longue et passionnante série de sous-chapitres aux titres aussi frappants que pertinents : « Les Travaux et les Jours, les règles et les mois ? », « La femme-automate : mesure et autonomie », « Les règles, modèle ou fin de l’histoire ? », « Calendrier masculin des jours féminins », « Michelet, secrétaire corporel », « Le chiffre et les lettres du cycle selon Freud », etc. On n’en dira pas plus, pour laisser au lecteur le plaisir de découvrir ce qui se cache sous ces intitulés intrigants.
On imagine que certaines propositions pourraient fournir la matière de débats passionnés. Mais c’est précisément là l’une des grandes vertus de ce livre, qui vaut aussi bien par ses idées que par le brio de ses formules, et où en outre l’auteure ose affirmer une pensée personnelle qui se manifeste, entre autres, dans la belle conclusion, intitulée « Dé/mesure des femmes » :
Aux frontières entre savoir et mythologies, le corps menstruant est à la fois personnel et collectif, queer et genré, spatial et temporel, fluidique et conceptuel, mesurable et incommensurable. Il nous invite à une conception relationnelle et toujours temporaire des corps, de leurs liens et des communautés provisoires qu’ils construisent.