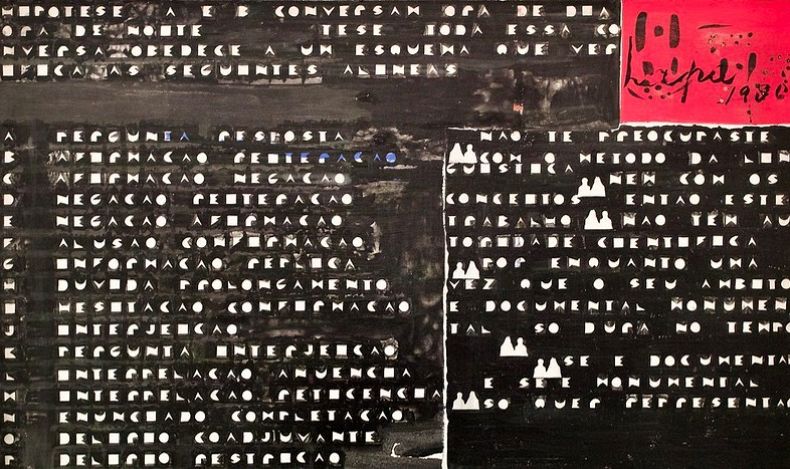Qu'est ce qui fait qu'un livre est politique ? À quoi reconnait-on une littérature qui le revendique ? Le retour au réel peut-il en tenir lieu ?
Justine Huppe, chercheuse en études littéraires à l'Université de Liège, interroge dans cet ouvrage, tiré de sa thèse, la notion de repolitisation que l'on prête à la littérature récente. Pour saisir cette évolution, elle esquisse une « proposition théorique » à laquelle elle donne le nom de « littérature embarquée ». Elle a aimablement accepté de répondre à des questions pour présenter son livre à nos lecteurs.
Nonfiction : S’agissant de production littéraire, on lie fréquemment ces derniers temps « retour au réel » et (re)politisation. Or vous montrez que la chose n’est peut-être pas aussi simple qu’on veut bien le croire. Pourriez-vous expliquer ce qui pose problème dans cette manière de voir ?
Justine Huppe : Effectivement, la manière la plus courante de raconter l’histoire littéraire récente consiste à lui imprimer cette inflexion : depuis les années 1980, grosso modo, la littérature française aurait amorcé un mouvement de retour au réel. On se serait remis à écrire des romans qui parlent de l’histoire, qui documentent des faits sociaux, qui retracent des expériences subjectives, etc. là où les expérimentations formelles des années 1960 et 1970 avaient été propices à asphyxier le désir de « représenter ». La littérature contemporaine se différencierait donc de ces décennies d’expérimentation formelle, sans pour autant les liquider, mais en renouant avec un désir de dire le monde.
Il y a un autre pôle par opposition auquel elle se distinguerait également : c’est celui de la littérature engagée. De fait, beaucoup d’écrivains contemporains expriment leurs scrupules à utiliser le vocabulaire sartrien de l’engagement, qui leur évoque une foi un peu anachronique dans la fonction sociale et dans la responsabilité de l’écrivain.
Par opposition à ces deux bornes, on n’en conclut toutefois pas que la littérature contemporaine serait moins politique, mais qu’elle le serait autrement. Elle ne craindrait pas (ou plus) de thématiser les grandes causes sociales et le ferait avec un souci et une humilité nouvelle.
Si je ne remets pas en doute les grandes lignes de ces observations, je crois que mon livre arrive à un moment où cette historiographie est devenue pour beaucoup un lieu commun, transformée en un outil explicatif qu’on a besoin de compliquer… au risque de s’énerver un peu - j’aime bien citer Olivier Cadiot à ce propos, ironisant : « Pendant mille ans on s’est tapé l’irréel, maintenant c’est parti pour le réel. Voilà la nouvelle rumeur […] on n’a plus qu’à recopier pour s’engager ».
A cette rumeur, il y a beaucoup de choses à objecter : d’un point de vue philosophique, est-ce qu’on est bien sûrs de savoir ce que c’est, le « réel » ? Ne risque-t-on pas d’en revenir à une simple politisation « thématique » des textes (où il suffirait de parler de domination pour faire un livre social ou politique) ? Est-on prêts à croire que la fonction de la littérature est de faire entrer des réalités occultées dans une sorte de grand parlement imaginaire, sur lequel elle ouvrirait les yeux des lecteur·rices ? N’a-t-on pas d’autres ressources et d’autres modèles pour penser l’efficacité politique des textes ? L’un des objectifs de cet essai consiste en tout cas à déplier quelques réserves à l’endroit de l’équation consensuelle « retour du réel = fin des formalismes et dogmatismes = repolitisation par le référent ».
Lorsqu’on s’interroge à propos d’une possible efficacité de la littérature contemporaine sur le monde, on ne peut pas faire abstraction des conditions matérielles et symboliques. Il faut donc s’intéresser au néolibéralisme, aux contraintes qu’il représente et à la manière dont des écrivains peuvent essayer sinon de s’en exonérer au moins de s’en accommoder…
Dans son essai intitulé polémiquement Contre le théâtre politique, Olivier Neveux dit une chose qui me semble très juste et tout à fait applicable à la littérature : pour sortir de la valorisation du théâtre politique ou social (certains osent dire « sociétal »), il invite à faire de la politique moins une évidence qu’une opération, prise dans l’inconfort d’une pratique, au coup par coup.
Il me semble crucial de se tenir à distance des catégories et labels trop évidents pour penser des opérations de politisation, qu’on ne peut saisir qu’en fonction des conditions matérielles et symboliques dans lesquelles elles ont lieu. Un livre politique ? D’accord. Mais comment fonctionne-t-il ? De quoi et surtout comment parle-t-il ? L’institution littéraire est-elle encore le lieu où s’inscrivent les débats qui agitent la « nation » (pour utiliser un grand mot) ?
Pour tenter de sortir de la générosité du mantra selon lequel tout est politique (et la littérature avec), je crois que les littéraires ont intérêt à s’appuyer sur d’autres savoirs (économie, sociologie, science politique, etc.) et à assumer des opérations de contrefaçon ou de braconnage terminologique. C’est ce que j’essaie de faire avec le néolibéralisme, sorte de « mot en caoutchouc » qu’on utilise souvent à tort et à travers. On a parfois l’impression que la littérature attaquerait le néolibéralisme dès lors qu’elle rend compte des conditions de travail en milieu managérial, qu’elle déplore les effets de la consommation à outrance ou qu’elle souligne les inégalités sociales grandissantes. Or tout un mouvement intellectuel est en cours pour justement préciser la définition du néolibéralisme et ses articulations à l’économie capitaliste : je pense au beau livre de Grégoire Chamayou (La Société ingouvernable), mais évidemment aussi à Wendy Brown, à Pierre Dardot, Christian Laval, Haud Guéguen et Pierre Sauvêtre, à Maurizio Lazzarato, à Bruno Amable, à Barbara Stiegler, etc. Ces travaux contribuent à montrer qu’il ne s’agit pas simplement du nouveau mot qu’on utilise pour parler du capitalisme, mais d’une configuration plus précise. Armé de ces lectures, on voit d’autres choses dans les textes littéraires. On saisit mieux, par exemple, l’articulation entre fragmentation des mobilisations, autoritarisme d’Etat et sentiment d’impuissance des intellectuel·le·s que j’étudie par exemple dans Tomates de Nathalie Quintane ou dans La Conquête des cœurs et des esprits d’Hugues Jallon.
Vous montrez que ce sont également les conditions d’existence des auteur-trices qu’il faut prendre en compte. Cela impose de les considérer comme des travailleurs comme les autres, expliquez-vous, si l’on ne veut pas s’illusionner sur les capacités de la littérature à transformer le monde. Mais vers quelles formes d’actions ou d’opérations est-ce susceptible de conduire ?
Le passage de questions « politiques » à celle de la condition des auteurs et autrices n’a a priori rien d’intuitif. Mais force est de constater qu’on est souvent ébahi·e·s par l’écart qu’il peut y avoir entre un discours thématique porté par les œuvres sur des questions sociales et la réflexivité de leurs auteur·rices quant à leur inscription dans les rapports de production. Un peu mesquinement, on pourrait appeler ça le « syndrome Slimani » - romancière capable de rappeler toute la brutalité de l’économie du care dans laquelle sont reléguées et maintenues bon nombre de femmes racisées (Chanson douce, 2016), mais commettant quelques années plus tard un « Journal du confinement » qui n’a pas mesuré l’obscénité bourgeoise de son geste de grande esthète. Au-delà de ce cas particulier, c’est toute l’illusio scolastique des écrivains (qui est aussi celle des universitaires, je le reconnais volontiers !) qui est en jeu. Dans les mouvements au long cours autour de la réforme des retraites en France, un petit tract placardé aux alentours des écoles d’art titrait « artistes2merde, politisez-vous », regrettant la difficulté des artistes à faire front et à se mobiliser auprès des travailleurs et travailleuses, ou à ne penser cette solidarité que de manière thématique.
Doit-on en conclure qu’une littérature politique ne pourrait être produite que par des auteur·rices syndiqué·es ? Bien sûr que non. Il s’agit plutôt pour moi de souligner la force de frappe de livres qui prennent acte de l’inscription réelle de la littérature dans l’économie. Cela peut être une enquête poétique comme celle menée par Christophe Hanna dans Argent (2018), un récit qui questionne à sa manière la difficulté de penser la poésie comme métier (Poétique de l’emploi, 2018, Noémi Lefebvre) mais aussi des textes qui viennent travailler la complicité ambivalente de l’écriture avec ses récupérations économiques, plutôt que de réactiver la croyance dans la nature foncièrement non marchande de l’art (à ce titre, j’aurais pu aussi citer le Portrait de l’écrivain en animal domestique de Lydie Salvayre).
Pourriez-vous dire un mot de la méthode que vous employez dans ce livre, où vous convoquez des auteurs (en relativement petit nombre), sans recourir à un corpus prédéfini, à quelques théoriciens (F. Jameson, W. Benjamin….) et à de nombreuses références à l’art plastique ?
Ce livre, je l’ai pensé comme un essai réécrit à partir de la matière de ma thèse, en mettant de côté les précautions méthodologiques de celle-ci (qui peut d’ailleurs être lue en ligne) et en assumant un net métissage de références qu’on peut juger déroutant. Derrière cette apparente licence méthodologique, il y a en réalité deux partis pris que j’assume fermement.
Le premier, c’est que cette notion de littérature n’est pas un label ou une catégorie dans laquelle on pourrait faire entrer un corpus ou une période en particulier. La littérature « embarquée », ce n’est ni un genre ni une catégorie historiographique : il ne s’agit pas de dire que la littérature serait « embarquée » après avoir été « impliquée » et « engagée ». Mon niveau d’analyse n’est pas du tout celui-là. Ce n’est ni mon ambition ni ma force de frappe, et assumer une forme essayistique était une manière aussi de signaler cette différence avec certains travaux d’histoire littéraire (avec lesquels je n’entends donc pas du tout rivaliser). Il y a un entretien de Hal Foster, critique d’art, qui évoque la maxime de Frederic Jameson (« Always historicize ») en disant qu’elle s’applique difficilement au domaine de l’art contemporain, qui gagne davantage à être théorisé plutôt qu’historicisé, faute de recul. C’est à cette exigence-là que j’ai essayé d’être fidèle, en produisant davantage une proposition théorique qu’une description scientifique et historique.
Mon second parti pris, c’est de penser les textes littéraires non seulement comme des objets mais aussi comme des embrayeurs, des outils. J’essaie de réfléchir avec Emmanuelle Pireyre comme avec Pierre Bourdieu, avec Éric Vuillard comme avec Siegfried Kracauer – tout simplement parce que c’est l’expérience que j’en fais, et que le partage entre « littérature primaire » et « littérature secondaire » ou « corpus » et « outils théoriques » me semble souvent fragile. Autrement dit, j’essaie d’être sensible à une politique de la littérature en littérature, et à une sociologie de la littérature par la littérature (même si pas seulement).
Vous proposez, pour aborder la politisation (ou la politique de la littérature contemporaine), le concept de littérature « embarquée », et vous en faites, initialement, un usage surtout déflationniste, même si vous en venez ensuite à un volet plus directement propositionnel. Ne croyez-vous pas que l’on pourrait faire ici un parallèle avec la manière dont les sciences humaines et sociales et la sociologie en particulier se débat avec la notion de neutralité axiologique, c’est-à-dire à la fois avec la difficulté à s’y tenir et la nécessité de produire malgré tout des résultats ayant une valeur tant scientifique que critique ?
Les distinctions entre approches descriptives ou normatives, neutralité et axiologie se questionnent (heureusement !) dans toute discipline, mais avec quelques singularités, je crois, dans le domaine des études littéraires. D’abord parce que la définition de notre objet est elle-même inféodée à des gestes évaluatifs : on peut retourner la question dans tous les sens, on n’arrive pas à se doter d’une définition de la littérature qui soit dénuée de valeurs – raison pour laquelle certains travaux d’historien·ne·s parlent à raison « du littéraire » plutôt que de « la littérature » (cf. le GRIHL), afin d’historiciser ces opérations de qualification. À partir de là, on peut évidemment tenter de distinguer deux modèles contradictoires : celui des approches qui s’attachent à une description aussi fine que précise des faits littéraires (sans volonté d’adhérer à leurs qualités esthétiques ou idéologiques), et celui d’approches qui étudient au contraire la littérature pour promouvoir et repenser certaines réalités en fonction de valeurs (proposer un contre-canon, valoriser les puissances esthétiques ou éthiques d’une œuvre, etc.).
Cette distinction entre projets « descriptivistes » et « normativistes » (que je paraphrase à partir de Jean-Marie Schaeffer) est cruciale et j’aimerais croire qu’elle une mesure d’hygiène efficace dans nos champs : il suffirait de se positionner, d’annoncer clairement la couleur, pour ne pas tromper les lecteur·rices sur la portée des propos tenus.
Mais plus je la mobilise et plus il me semble évident que les choses sont beaucoup plus compliquées que cela. Il y a toujours de la norme – ne serait-ce que dans le corpus : j’ai par exemple travaillé sur des textes déjà passés par les filtres évaluatifs de la critique universitaire. Par ailleurs, certain·e·s s’agrippent précisément à la défense d’une approche scientifique et neutre et réinjectent ce capital symbolique dans la défense virulente de valeurs qui ne disent pas leur nom – en ce sens, publier dans la « Bibliothèque des sciences humaines » de chez Gallimard et faire les plateaux de CNews, c’est sans le dire jouer sur les deux tableaux. Plus encore, je mesure combien nos théories sont dotées d’effets : décrire en littérature un « tournant », une « inflexion », une « nouvelle ère » ou un paradigme, c’est nécessairement, sous l’apparence de la plus grande objectivité, dessiner une ligne de partage, avec des conséquences idéologiques et politiques pourtant importantes – c’est ce que j’essaie de montrer à propos des descriptions du contemporain, dont certaines passent, en toute neutralité, la production littéraire à la moulinette « esthético-éthique ». Sans renoncer à l’importance de lire, de s’appuyer sur d’autres travaux et d’outiller nos approches à partir d’autres sciences, je crois qu’il est aussi important de reconnaître que la théorie littéraire n’est pas qu’un point de vue sur ses objets, mais qu’elle a aussi une responsabilité à leur égard. La littérature est embarquée ? La théorie aussi.