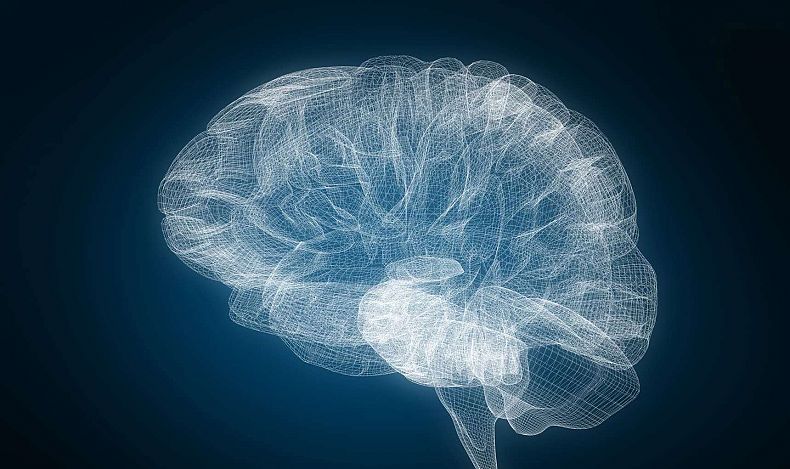Denis Forest analyse en philosophe les sciences du cerveau, leurs promesses et leurs limites.
Denis Forest, ancien élève de l’ENS, est actuellement Professeur de philosophie et d’histoire des sciences à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Directeur de l’École doctorale de philosophie de cette Université, et membre de l’IHPST (CNRS, UMR 8590). Auparavant, il a travaillé à l’Université Fudan (Shanghai, Chine), à l’Université Lyon 3 Jean Moulin et à l’Université Paris Nanterre. Ses travaux sur les neurosciences et les sciences connexes recoupent plusieurs domaines : la philosophie et l’histoire des sciences, la philosophie de la médecine et la psychiatrie, ainsi que la philosophie de l’esprit. Il est l’auteur de trois livres (dont Neuropromesses, publié en 2022 chez Ithaque), de nombreuses études mais aussi l’éditeur de plusieurs collectifs, notamment : Defining mental disorder. Jerome Wakefield and his Critics, en co-direction avec Luc Faucher, publié chez MIT Press. Il est actuellement responsable avec Nicolas Heck et Héloïse Athéa du programme Neurophile consacré aux modèles animaux des états émotionnels.
Nonfiction : Vous avez signé un livre intitulé Neuroscepticisme : Les sciences du cerveau sous le scalpel de l’épistémologue paru il y a 8 ans de cela et vous venez tout juste d'en publier un autre, Neuropromesses : une enquête philosophique sur les frontières des neurosciences . Pourquoi s’en prendre aux neurosciences ?
Denis Forest : Je ne m’en prends jamais aux neurosciences, et je suis impliqué actuellement dans un projet de recherche avec des neurobiologistes (Neurophile.fr). Dans Neuroscepticisme, j’examinais les raisons qu’on peut avoir de douter de la validité des résultats auxquels on parvient en neurosciences, ou de douter de leur intérêt. Le scepticisme était un point de départ, une attitude (répandue) que j’examinais, non une posture que j’adopte moi-même dans tous les cas. Dans Neuropromesses, je ne dis pas que les promesses des neurosciences sont réductibles à de fausses promesses intéressées, ou que leurs ambitions ne sont en fait que des chimères. J’enquête sur des recherches en cours présentées comme « prometteuses », et de ce fait, je m’interroge aussi sur ce que c’est qu’être « prometteur » dans un domaine de la connaissance. Dans tout cela, aucune polémique, aucun nihilisme. Seulement de la vigilance et de l’exigence.
Votre approche est en effet assez cartésienne. Vous définissez le neuroscepticisme comme « toute attitude de l’esprit qui interroge et met en doute la solidité, la portée, ou l’innocuité de la connaissance que produisent les neurosciences » . Alors que peut-on dire à l’heure actuelle au sujet des neurosciences et de leur capacité, sans se tromper ou extrapoler ?
Espérer dire quelque chose de satisfaisant des neurosciences, cela suppose d’abord de sortir des généralités, de prendre en compte les détails, de viser une forme d’adéquation descriptive. Ce n’est d’ailleurs pas aisé : il y a tant de laboratoires, tant d’articles publiés, tant de directions différentes de l’enquête ! Ensuite, il y a plusieurs types de métadiscours sur les neurosciences, la philosophie n’est qu’un de ceux-ci, qui se distingue de la sociologie et de l’anthropologie par son intérêt pour la science, non pas seulement telle qu’elle est, mais telle qu’elle doit être si elle veut atteindre ses buts.
Dans Neuroscepticisme, j’abordais les neurosciences d’aujourd’hui, avec des questions assez classiques du type : tel type d’assertion est-il bien justifié ? A-t-on cherché les facteurs explicatifs au bon endroit ? Dans Neuropromesses, à la suite d’auteurs comme Thomas Kuhn et Larry Laudan, je développe l'idée que notre conception de la bonne et de la mauvaise science n’est pas seulement liée à la justification des énoncés, à la qualité des preuves dont on dispose ; elle est liée à notre anticipation sur l’avenir, au fait qu’on est (ou pas) en position de progresser, qu’on possède (ou pas) de bonnes raisons de persévérer dans telle direction. C’est dans cette perspective que j’ai voulu faire une philosophie de la recherche, en me demandant ce qui est fécond, c’est-à-dire riche en potentialités dans un domaine donné, et quels sont les débats à ce sujet. La recherche est faite de choix qui engagent l’avenir (animaux modèles, méthodes expérimentales, etc.). Aussi, chercher à comprendre la recherche, c’est chercher à comprendre ces choix.
Vous avancez que « Le neuroscepticisme naît du vertige que suscite la spéculation » . Mais n’est-ce pas le propre de la science que d’être une narration spéculative, jusqu’à ce que la théorie s’affine avec des connaissances plus pertinentes en la matière ? On se plaît souvent à dire que notre connaissance des capacités et du fonctionnement du cerveau humain est extrêmement lacunaire et limitée. Ne faudrait-il donc pas accepter que le trait définitoire des neurosciences est précisément ce caractère spéculatif, qui les fait avancer sur le chemin de la connaissance ?
On peut dire en effet des sciences en général qu’elles font des hypothèses et donc qu'elles spéculent. Cependant, toute science de la nature cherche ensuite à aller au-delà de la seule spéculation, par les prédictions, la modélisation, la mesure. En neurosciences, on a maintenant beaucoup de données, et dans bien des cas, des schémas de mécanisme, plus ou moins complets. Mais on a aussi des visionnaires, comme Henry Markram, qui ont une certaine idée des conditions du progrès et de la direction que doit prendre leur discipline.
Pour avancer un peu dans ce contexte, il faut distinguer deux choses. D’une part, les buts à long terme qu’on se propose, qui jouent un rôle régulateur, pour reprendre le lexique de Kant : par exemple, l’idée d’une connaissance exhaustive. On ne peut sans doute pas atteindre l’exhaustivité, mais elle a motivé la description par Sydney Brenner et ses collaborateurs des 302 neurones de C. Elegans et de leurs connexions, dont je parle dans Neuropromesses ; toute l’entreprise désormais florissante de la connectomique en découle. On ne peut donc pas se plaindre des ambitions non-réalisées, si quelque chose se passe ! Et d’autre part, les attentes qui ne semblent pas raisonnables parce qu’elles prêtent aux neurosciences des pouvoirs qui ne sont pas les leurs : nous dire ce que nous sommes, par exemple. Les neurosciences, et la perception qu’on en a, oscillent entre les deux.
Le dernier chapitre de votre ouvrage précédent sur les neurosciences, Neuroscepticisme, passe le cerveau social au crible de votre rigueur philosophique. De quelle manière les neurosciences sociales pourraient-elles trouver grâce à vos yeux ?
C’est bien passionnant, les neurosciences sociales, mais de quel « social » est-il question dans ce domaine de recherche ? Dans les neurosciences sociales standards, il y a en particulier un héritage de l’intelligence machiavélienne (c’est-à-dire, de l’idée d’aptitudes développées pour résoudre les problèmes de la coopération et la compétition dans notre passé évolutif, comme la capacité à lire l’esprit des gens). Il me semble que ce n’est pas le style explicatif qui pose spécialement problème en neurosciences sociales, car les mêmes problèmes de passage de la simple corrélation à la causalité s’y posent ; c’est plutôt la restriction des phénomènes à expliquer à une sous-classe : les relations interpersonelles (je comprends ton intention, je sens que tu souffres, je détecte ton agressivité). C’est une vision très appauvrie du « social ». On aimerait plus de neurosciences du sentiment d’obligation, ou des projets à plusieurs, qui prennent davantage en compte nos manières caractéristiques de faire société. Peut-être la rencontre entre neurosciences et psychologie morale, ou sociologie cognitive commencent-elles à répondre à ce besoin.
Quel est votre sentiment au sujet des neuro-humanités ? Y voyez-vous, à l’instar de Catherine Malabou, la promesse d’un énorme potentiel à exploiter ?
Il faut bien sûr laisser les chercheurs chercher, en général, et juger sur pièce les résultats. Mais dès qu’on me parle de dialogue disciplinaire, qu’il soit neuro-quelque chose ou autre, je formule deux demandes très simples, pour éviter de monter des usines à gaz en pure perte. La première est que dans le dialogue, on additionne au lieu de soustraire ; que le chercheur en sciences humaines ne se retrouve pas à la fin avec des pseudo-certitudes sur ce que le cerveau est ou fait qui sont déjà invalidées au moment où il les utilise – ou le chercheur en neurosciences, symétriquement, avec une vision simplifiée du domaine qui n’est pas le sien. La seconde, c’est que tout le monde y trouve un réel profit. Le philosophe John Sutton a par exemple étudié des formes de coopération où des individus se souviennent mieux ensemble que séparément. À toute recherche neuro-x, il faut de même demander : qu’est-ce que la collaboration permet d’obtenir, qu’on n’aurait pas obtenu par les moyens traditionnels de chaque discipline séparément ?
À lire votre récent ouvrage, Neuropromesses, on a le sentiment que vous partez en croisade contre les neurosciences. Vous prenez comme point de départ l'analyse des sociologues qui ont parlé des promesses neuroscientifiques de la même manière que le feraient les plus fervents détracteurs de la voyance, avec une litanie de reproches qui s’appliqueraient aussi bien à l’un qu’à l’autre : « inflation des promesses », « part d’illusion », « spéculation débridée », « prophétie auto-réalisatrice », etc. Qui plus est, ils n’ont pas été très tendre avec le Human brain project . Partagez-vous leurs analyses ?
Je ne suis pas un croisé, je suis juste un compagnon de route. Comme je l’explique au début de ce livre, ce sont en effet les sociologues des sciences (ou certain d’entre eux, du moins), qui, après nous avoir parlé du rôle normal des promesses dans l’économie de la science sur projet, se sont mis à parler de « bulle spéculative » et ont pointé ce qu’ils estiment être des excès. Mon analyse du Human brain project est en fait beaucoup plus charitable (le problème pour moi est plutôt l’opacité du processus qui a fait ce projet lauréat du concours qu’il a remporté). D’une part, je me demande si les objectifs de ce projet ont été bien compris (il s’agissait avant tout d’encourager des synergies, de créer les conditions du progrès en « alignant » des ressources, comme diraient Sabina Leonelli et Rachel Ankeny). D’autre part, sommes-nous bien en possession des critères qui permettent de distinguer de manière consensuelle ce qui vaut et ce qui ne vaut pas la peine d’être poursuivi ? Savons-nous d’une connaissance certaine où passe la frontière entre un argent bien et mal employé dans le domaine de la recherche ? C’est à ce double effort, descriptif (relativement à ce qui est fait dans un cadre comme celui du Human brain project) et réflexif (en matière de critères pour l’évaluer), que j’ai voulu inviter. Ce que je propose n’est qu’un début ; on ne sera jamais trop nombreux pour réfléchir à tout cela.
Pourriez-vous concevoir que votre perspective critique sur l’essor des neurosciences soit entachée de neurophobie ou de neuropessimisme ? Pourquoi fustiger une rhétorique de l’espoir ?
Je peux comprendre que certains passages paraissent assez pessimistes : je souligne par exemple que l’amélioration radicale de nos facultés cognitives par des interventions sur le cerveau ne semble pas pour demain – sur la base des méta-analyses des travaux publiés. Mais le principal n’est pas là. D’abord, il y a dans le livre la part importante de l’enquête sur des découvertes et des avancées que je trouve fascinantes : on en sait de plus en plus long sur les animaux (métazoaires) avec et sans neurones, par exemple, et cela fait avancer la réflexion sur les rôles du système nerveux et les raisons de son émergence au cours de l’évolution. Comment ne pas saluer aussi la manière dont, en quelques années à peine, l’optogénétique est passée de la stimulation de neurones en culture à un outil de restauration de la fonction visuelle chez l’homme, même si on n’en est qu’au début ? Je ne passe donc pas mon temps à dire que la recherche en ces domaines est vaine et stérile.
Mais venons-en au point crucial : il y a l’horizon indéfini des découvertes possibles, souvent imprévisibles dans un champ, et il y a ce qui n’appartient tout simplement pas au périmètre de ce champ, ni aujourd’hui, ni semble-t-il demain. En forçant le trait : il y a sûrement des progrès illimités de l’enquête en physique, mais on peine à voir comment ils permettraient en eux-mêmes de réduire les inégalités de revenu les plus choquantes ; autre est la connaissance de la matière, autre est la justice distributive. De même, on trouvera beaucoup de choses en neurosciences, mais je ne vois pas de bonnes raisons pour que cela nous donne une réponse neuroscientifique à la question de ce qu’est une personne, ou un sujet, qui soit de nature à supplanter toutes les autres. Les chercheurs en neurosciences n’ont rien à gagner à jouer des rôles qui ne sont pas les leurs.
Enfin, que des « espérances surhumaines », c’est-à-dire déraisonnables, comme disait Berthelot au XIXe siècle, puissent motiver un chercheur à chercher, il faut juste en prendre acte ; si croire en des choses qu’on ne trouvera pas aide à en chercher d’autres qu’on peut parfaitement trouver, alors le monde n’est pas si mal fait : on peut être un pessimiste heureux.
Après les neurosciences en deux volets, quel sera le sujet de votre prochaine enquête épistémique ?
D’abord, il y a les prolongements de ce travail, comme la réflexion sur les valeurs scientifiques : la précision, la cohérence, la portée, la fécondité. Contrairement à ce qu’on pourrait croire, nous n’en avons pas fini avec elles. J’ai aussi un projet avec le petit groupe Neurophile qui concerne ce qu’on appelle les états internes du cerveau, une nouvelle « frontière » de l’enquête en neurosciences.
Enfin, j’aimerais m’intéresser aux plantes. Aujourd’hui, à l’époque du roman de Richard Powers L’arbre-monde, il convient de leur prêter tous les pouvoirs, toutes les vertus : elles perçoivent, elles sont intelligentes, elles communiquent entre elles et avec leur environnement, elles sont douées d’une forme de sagesse. Pour le philosophe, la question n’est pas tant je crois de choisir son camp (partager ou pas l’euphorie panpsychiste ambiante), que de se demander quels sont les enjeux, et ce qu’est un usage correct des concepts. Si on affirme qu’une plante est capable d’apprendre, ou qu’elle est consciente, qu’arrive-t-il aux concepts d’apprentissage ou de conscience, est-ce leur référence ou bien aussi leur sens qui changent, et qu’est-ce qui fait qu’on a raison ou tort d’affirmer ceci plutôt que cela, sur ces sujets ? C’est un des types de questions qui vont m’intéresser.