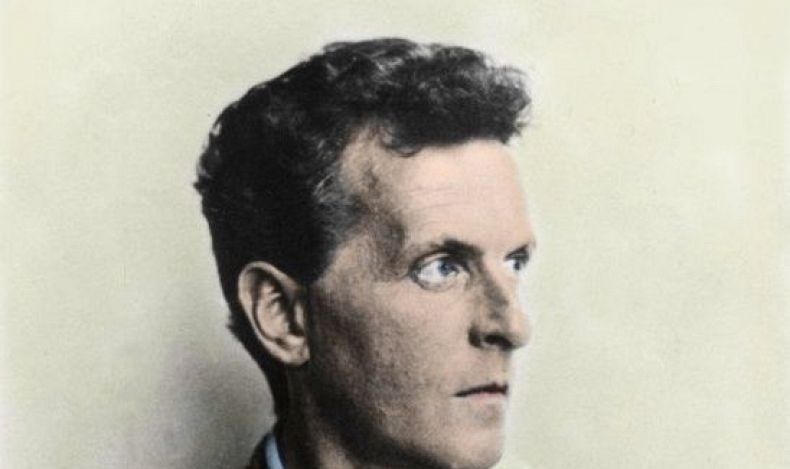Cette nouvelle édition du Tractatus logico-philosophicus, nécessaire et prometteuse, tâche de mettre la pensée de Wittgenstein « à portée de main » des lecteurs de bonne volonté.
Le Tractatus de Wittgenstein est l’un des ouvrages mythiques de la philosophie du XXe siècle. Seul livre publié (en 1921) du vivant de l’auteur, il a exercé une influence considérable, qui perdure aujourd’hui encore. Toutefois, qu’il ait fasciné, intrigué ou laissé indifférent, le jugement des philosophes à son égard n’a rien d’unanime. Par ce bref traité, dense et parfois énigmatique, Wittgenstein est, avec quelques autres, à l’origine de la philosophie analytique ou linguistique. En raison de sa prédominance dans les pays anglo-saxons, celle-ci est régulièrement encore opposée à une philosophie dite « continentale », qui l’a longtemps rejetée ou simplement ignorée. Mais c’est oublier que les précurseurs ou les initiateurs de la philosophie analytique, que ce soit Gottlob Frege ou les membres du Cercle de Vienne, allemands ou autrichiens, étaient, pour la plupart, germanophones.
Quel est donc l’objet du Tractatus ? De quoi nous entretient-il, de logique ou de philosophie ? Des deux à la fois, faut-il dire, car la logique est, pour Wittgenstein, la voie privilégiée d’accès à la philosophie. Si cet ouvrage contribue par certains points à la logique, le Tractatus n’est pas pour autant un traité technique relevant de cette branche traditionnelle de la philosophie. Wittgenstein y expose une conception de la logique qui se distingue de manière critique de celle de ses deux maîtres en la matière, Gottlob Frege et Bertrand Russell, et qui le conduit à formuler une idée radicalement nouvelle de la philosophie, de sa nature et de ses tâches. La philosophie, c’est au fond, pour lui, la logique correctement comprise. Celle-ci fait donc figure de philosophie générale, dont Wittgenstein tire les conséquences pour tous les autres domaines. C’est pourquoi il est aussi question, même succinctement, d’ontologie, de théorie de la connaissance, d’éthique, d’esthétique, et même de théologie.
La philosophie au point de vue logique
Le jeune Wittgenstein entendait apporter, par le moyen d’une réflexion sur la logique, des réponses définitives à certaines questions philosophiques. La logique est, rappelons-le, une discipline formelle qui porte sur les normes de l’argumentation : quelles règles doit-on suivre pour raisonner correctement ? Demeurée presque en l’état depuis l’Organon d’Aristote, cette discipline a été profondément renouvelée à la fin du XIXe siècle et au début du XXe, successivement par Frege et Russell. Elle procède désormais par une axiomatisation et une formalisation systématique. En créant un langage formel sui generis, elle devient logique symbolique et prend la forme d’un calcul. Cela a pris, chez Frege, la forme d’une idéographie, véritable écriture conceptuelle. La nouvelle logique a également refondu l’ensemble du vocabulaire conceptuel hérité d'Aristote. Ainsi, les propositions ne sont plus conçues en termes de sujet et de prédicat reliés par une copule, mais, sur le modèle arithmétique, en termes de fonction et d’argument, celui-ci désignant la valeur prise par la variable d’une fonction.
Wittgenstein s’inscrit dans le sillage de cette révolution logique. Il se réfère explicitement à Frege ainsi qu’à Russell dont il était l’élève et l’ami et qui, par ailleurs, devait l’aider à éditer le Tractatus. Il ne reprend pas, toutefois, leurs conceptions telles quelles. Il les critique parfois même vivement et propose, de cette logique, une conception originale. Frege pensait, dans une perspective platonicienne, qu’il existait un monde d’entités logiques dont le philosophe devait rerchercher la connaissance objective. Russell considérait, pour sa part, que la logique énonçait les vérités les plus générales. Wittgenstein rejette ces deux conceptions. Selon lui, les propositions de la logique sont vides : « elles ne tiennent lieu de rien », ce sont de pures tautologies. Leur nécessité est donc tout interne : elle tient aux contraintes et aux conséquences qui découlent de la position, d’abord arbitraire, de premiers signes et de premières règles. Wittgenstein accorde ainsi un rôle décisif aux conventions, de sorte que sa thèse est habituellement qualifiée de « conventionnaliste » et régulièrement critiquée à ce titre. Pourtant, Wittgenstein se prononce aussi, à la fin du Tractatus, en faveur d’une inversion de la position solipsiste sur laquelle il campait jusque-là, à laquelle il substitue un « réalisme pur ».
La conception wittgensteinienne de la logique présente une certaine affinité avec l’idée de critique, caractéristique de la philosophie kantienne. On sait que Kant prétendait avoir opéré une véritable révolution copernicienne en philosophie en se tournant vers le sujet de la connaissance plutôt que vers les choses, pour y trouver les normes de l’usage légitime de la raison. Dans cette perspective, l’objectivité était inscrite dans les conditions a priori de la pensée, dans la structuration de notre esprit préalablement à toute expérience. Dans le Tractatus, Wittgenstein adopte une démarche semblable, avec cette différence cruciale, toutefois, qu’il met le langage à la place de l’esprit. Selon lui, les conditions a priori de la pensée, que les philosophes nomment, depuis Kant, « transcendantales », sont à chercher dans les règles linguistiques. C’est qu’il n’existe pas véritablement de pensée avant qu’elle ne vienne s’articuler dans le langage ; l'image d'une pensée qui, déjà formée intérieurement, ne recourrait au langage qu’à des fins de communication avec autrui, est une illusion. La tâche de la philosophie se trouve ainsi redéfinie, relativement à la critique de la raison kantienne, comme une réflexion sur la signification, prenant la forme d’une critique du langage.
De ce point de vue, la seule activité légitime pour la philosophie réside, selon Wittgenstein, dans l’analyse logique des énoncés linguistiques et, préalablement, dans l’élucidation de la nature des propositions. C’est là une position tout à fait originale, qui comprend une critique radicale du discours philosophique traditionnel. Selon Wittgenstein, en effet, les philosophes font souvent de mauvais usages du langage. Les problèmes qu’ils formulent sont, de ce fait, de pseudo-problèmes, auxquels il est, en réalité, impossible d’apporter des réponses. Il est vain de chercher à les résoudre : il convient plutôt de les dissoudre. Or, l’analyse logique des propositions est la méthode appropriée pour débusquer les faux problèmes de la philosophie. Ainsi, une proposition bien formée doit se laisser complètement décomposer en ses parties élémentaires. Les propositions complexes en particulier, formées de plusieurs propositions élémentaires, doivent, à l’analyse, révéler leur vérifonctionnalité, c’est-à-dire la dépendance de leur valeur de vérité à l’égard des propositions qui entrent en elles. D’une manière générale, les différents éléments susceptibles d’entrer dans une proposition se combinent selon des règles qui, toutes ensemble, forment une syntaxe logique. Passés au crible de cette dernière, les énoncés philosophiques révèlent non pas qu’ils sont illogiques — c’est là, pour Wittgenstein, une impossibilité —, mais que les philosophes comprennent mal le fonctionnement de la logique sous-jacente au langage, ou encore qu’ils ont omis de donner un sens à certains des signes qu’ils utilisent.
Tracer les limites du sens
Les normes de la syntaxe logique délimitent, selon Wittgenstein, le domaine du dicible. Elles tracent les limites du sens. Par suite, toute tentative d’exprimer quoi que ce soit qui n’entre pas dans le cadre de ces normes est dénuée de sens. Il ne suffit donc pas de parler, d’émettre des phonèmes et d’enchaîner des mots, pour dire quelque chose. Il faut encore que ces éléments linguistiques répondent aux conditions constitutives du sens. La tâche de la philosophie en tant qu’analyse logique du langage se situe donc en amont de la distinction de la vérité et de l’erreur. Pour qu’une proposition soit susceptible d’être vraie ou fausse, il faut en effet qu’elle soit préalablement dotée de sens. Il s’agit donc, pour le philosophe, de faire le départ entre sens et non-sens. C'est là l'inverse de la position herméneutique, qui, face à la difficulté à trouver un sens à un texte canonique, en conclut à l’existence d’un sens caché dont la profondeur échappe au lecteur. Pour Wittgenstein, la philosophie n’a, par suite, pas de tâche cognitive. Elle n’est pas susceptible de produire des connaissances vraies qui viendraient s’ajouter à celles des disciplines scientifiques. Son activité est toute de clarification.
Le travail philosophique ne se justifie que de l’autonomie de la syntaxe logique relativement à la réalité. En effet, la logique ne nous parle pas, selon Wittgenstein, du monde empirique et ne dépend donc pas des découvertes scientifiques. Elle se situe sur un autre plan, celui des conditions de possibilité. Comment, alors, la logique peut-elle bien être rapportée au réel et venir lui correspondre ? Wittgenstein ne semble pas voir là un problème, mais il se propose, en revanche, d’expliciter la nature de cette correspondance. Celle-ci n’est possible — telle est sa thèse à cet égard — que parce que le langage et le monde possèdent une structure commune. Ils sont, pourrait-on dire, isomorphes. De ce fait, toute proposition sur le monde peut a priori trouver sa place dans l’espace logique des possibles. Le langage peut ainsi être conçu comme une image de la réalité obtenue par projection, comme un miroir du monde, à condition toutefois de ne pas l’entendre en un sens pictural : ce n’est pas d’une image concrète qu’il s’agit ici, mais d’une image-modèle qui, comme une maquette, représente à une échelle réduite les propriétés structurelles de la réalité.
L’absence de moyen terme chez Wittgenstein entre le sens et le non-sens creuse un abîme entre le dicible et l’ineffable. Tout ce qui ne fait pas sens, qui ne répond pas aux conditions a priori du sens, est rejeté dans l’ineffable, face auquel il convient de rester mutique. Selon la proposition finale du Tractatus, probablement la plus connue, « sur ce dont on ne peut parler, on doit se taire ». Cette dichotomie ouvre aussi la voie à la distinction, centrale dans la pensée de Wittgenstein, entre dire et montrer. Ne peut être dit, c’est-à-dire décrit, que ce qui répond aux conditions logiques du sens, qui en constitue la forme (par contraste avec le contenu). Tout le reste est dénué de sens. Cependant, parmi tout ce que recouvre le vaste domaine du non-sens, il faut distinguer ce qui se montre ou peut être montré, qui ne saurait être décrit ou articulé linguistiquement, mais qui se manifeste malgré tout à travers le langage. Tel est le cas, précisément, des propositions logiques. Il est impossible en réalité, affirme Wittgenstein, d’en parler, car il faudrait, pour ce faire, se situer à l’extérieur de la logique, alors que celle-ci délimite justement les limites du dicible. Les limites du langage ne peuvent être exprimées que de l’intérieur et il n’y a donc pas place pour un quelconque métalangage, en particulier pour une métalogique, qui n’est ni utile, ni possible. Les structures logiques, qui sont à la fois les limites de notre pensée et celles du monde, ne peuvent être l’objet de propositions empiriques susceptibles d’être vraies. Elles ne font que s’exhiber à travers elles. Et c’est là une autre source des erreurs des philosophes : s’acharner à vouloir dire ce qui ne peut être que montré.
Le dicible se confond, dans cette perspective, avec les propositions des sciences de la nature, tandis que l’éthique, l’esthétique ou tout autre domaine de valeur sont rejetées du côté de l’ineffable. Pour Wittgenstein, le monde est la totalité des faits et il n’est rien d’autre que cela : les valeurs en sont radicalement exclues. Pour tout ce qui ne relève pas de la connaissance, Wittgenstein semble ainsi adopter une attitude mystique, voire quiétiste. Cette conception de la philosophie a paru très réductrice à beaucoup. N’annonçait-elle pas, une fois encore la fin de la philosophie ? Ainsi, certains y ont vu une figure de l’antiphilosophie . Et cette pensée semble, en effet, aboutir à l’autodissolution de la philosophie. Une fois les énoncés philosophiques clarifiés, une fois le discours philosophique soumis à la thérapeutique de l’analyse logique, la tâche du philosophe semble devoir s’achever et le silence s’imposer. Il est des passages du Tractatus qui vont indéniablement en ce sens, comme ceux qui font valoir que l’ensemble des propositions du traité ne sont, en réalité, que des pseudo-propositions, qui, une fois remplie leur fonction didactique ou pragmatique, doivent être abandonnées, comme l’échelle que l’on rejette une fois le mur gravi.
De la syntaxe logique à la grammaire philosophique
Wittgenstein aurait donc pu arrêter là sa carrière philosophique. C’est ce qu’il a fait effectivement pendant un temps, se tenant à l’écart du monde académique, engagé volontaire dans la Grande Guerre, puis exerçant le métier d’instituteur ou de jardinier. Cependant, insatisfait de ses discussions avec les philosophes du Cercle de Vienne, lecteurs enthousiastes du Tractatus, d’où ils tirèrent leur propre conception, le positivisme logique, il aurait été incité à renouer avec la philosophie et l’université. Quoi qu’il en soit, Wittgenstein imprime, dans les années 1930, une nouvelle orientation à sa pensée, fondée pour partie sur une autocritique des thèses du Tractatus. Au thème de la syntaxe logique se substitue celui d’une « grammaire philosophique », orientée vers l’analyse de l’irréductible multiplicité des usages du langage ordinaire. Il forge ainsi certains de ses concepts les plus connus, ceux de jeu de langage ou encore de forme vie, qui constituent désormais la toile de fond de son travail philosophique. Plutôt que le mutisme, Wittgenstein choisit donc de relancer sa réflexion philosophique, sous la forme d’une description sans fin de nos usages linguistiques, dont la matière est disséminée dans de nombreux carnets, cours ou conférences, en particulier dans Recherches philosophiques, publiées de manière posthume en 1953 .
Wittgenstein a indéniablement inventé une façon nouvelle de faire de la philosophie. Ce qui importe en elle, comme il le fait valoir lui-même, ce sont moins les résultats que la méthode. Sa manière la plus caractéristique de penser, par succession de questions et de remarques fragmentaires, n’apparaît guère, à vrai dire, dans le Tractatus, dont les thèses sont exprimées de manière dogmatique. Elle est, pourtant, déjà présente dans les notes préparatoires au livre . Cette pensée est, en tout cas, susceptible pour ceux qui veulent bien avoir la patience de le suivre de transformer leur relation au langage, à la pensée, et peut-être même à l’existence.
L’excellente édition préparée par les soins de Christiane Chauviré et de Sabine Plaud, avec une nouvelle traduction, un riche appareil critique et de très utiles notes explicatives qui ne viennent pas étouffer la lecture, se propose, comme l’écrit Sandra Laugier dans son introduction générale, d’offrir au lecteur français une « première édition scientifique des œuvres de Wittgenstein ». Avec le Tractatus, elle lui donne l’opportunité d’en découvrir ou d'en redécouvrir, dans les meilleures conditions, le moment inaugural.