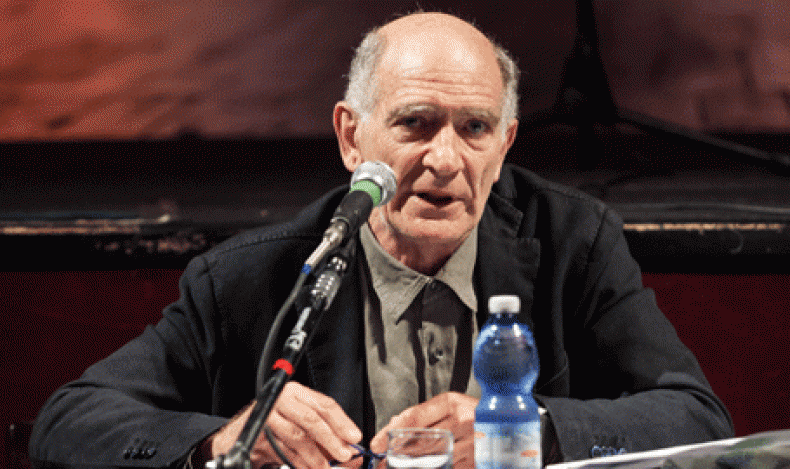L’animal humain, à la fois créditeur et débiteur, précurseur et successeur de ses particularités spécifiques d’espèce, ne coïncide pas avec son essence. Il peut donc la posséder.
Quel lien peut-il y avoir entre un verbe banal en apparence comme l’auxiliaire "avoir" et la nature complexe de l’animal humain ? À la deuxième étape de son parcours d’une anthropologie linguistique, commencé en 2013 avec son Essai sur la négation – qui exprime les fractures intrinsèques au langage – Paolo Virno soutient dans ce nouveau livre, Avoir. Sur la nature de l’animal parlant, que l’homme est l’être vivant qui a – et n’est pas – son essence. Si dans l’essai sur la négation c’était le petit mot "non" qui servait d’outil pour mener l’enquête sur la nature ambivalente et dangereuse de l’animal humain, le viatique, ici, est le verbe "avoir", lié à la négation comme le concave au convexe.
Définir l’animal humain comme celui qui "a" son essence et ses expériences biographiques n’est pas une démarche anodine. Il ne s’agit pas seulement de donner une réponse différente à la traditionnelle question philosophique sur l’essence, mais d’une nouvelle manière de poser la question, qui trace des chemins inédits pour la réflexion anthropologique et permet de repenser une série de notions et d’oppositions qui ont nourri la pensée occidentale : corps/esprit, conscience/autoconscience, ami/ennemi, res cogitans/res extensa, idéal/réel, analytique/synthétique, immanence/transcendance, entre autres.
De ce que l’on a à comment l’a-t-on
Qu’est-ce qui rend donc le verbe "avoir’"aussi puissant qu’il en devient un verre grossissant en mesure de faire le point sur la complexité de la nature humaine ? À la différence du verbe "être", son frère philosophique plus avantagé, le verbe "avoir" établit entre les termes impliqués une relation constitutivement instable, transitive seulement en apparence, qui est toujours une relation de non-identité (et c’est pourquoi "avoir" et "non" sont comme le concave et le convexe). On peut avoir quelque chose, et donc en disposer, uniquement si ce quelque chose est, et demeure, irréductiblement autre par rapport à celui qui le possède. Seul l’animal qui ne coïncide pas avec son essence peut l’avoir. Ainsi le verbe "avoir", inoffensif en apparence, s’avère être un verbe fatal, capable de montrer l’écart qui ne peut se combler séparant l’animal humain de tout ce qui lui est propre.
Détourner l’attention de l’"être" vers l’"avoir", de ce que l’on "est" vers comment l’"a"-t-on, est le geste philosophique qui permet finalement de déplacer l’enquête sur la nature humaine de la recherche obsessionelle de ce trait unique définitoire qui, seul, nous rendrait ce que nous sommes, vers la réflexion sur la relation que le bipède glabre entretient avec lui-même et avec ses multiples prérogatives, qu’elles soient des ressources ou des lacunes. L’enquête sur le verbe "avoir" montre comment cette relation – qu’elle investisse la faculté de langage, qu’elle évoque la néothénie, ou l’infantilisme prolongé de l’animal humain, qu’elle concerne notre station debout, ou le manque d’inhibitions, ou encore les neurones-miroirs (qui sont la base neuro-physiologique de l’empathie), ou quelque autre caractéristique de l’animal humain, y compris son corps et sa propre vie – est toujours une relation extrinsèque : d’autant plus extrinsèque que ce qui est possédé est intime.
Etrangers à nous-mêmes
C’est sur cette relation d’intime étrangeté à soi-même que viennent se greffer la possibilité de l’amitié – entendue au sens d’Aristote comme relation avec un autre soi-même auquel nous lie une communauté non pas d’affects ou d’opinions, mais de style – et l’autoconscience dont l’origine est à rechercher dans les ressources anthropologiques de l’amitié. C’est en effet toujours l’être étranger à soi, l’écart par rapport à sa propre vie et à sa propre essence, qui rend possible à la fois de regarder l’autre (et avant même nous-mêmes), comme un soi-même différent, et d’avoir une expérience de ses propres perceptions, de ses propres pensées, de sa propre vie. Si ce qui rend possible l’amitié c’est cette relation d’étrangeté constitutive, l’ami par antonomase est alors l’étranger et le premier étranger avec lequel l’animal loquace se doitde régler ses comptes est précisément soi-même, pouvant disposer de soi, de son propre corps et de sa propre vie jusqu’à la possibilité extrême du suicide, de lever la main sur soi-même. Ce qui nous rend étrangers à nous-mêmes, qui nous impose cette relation extrinsèque avec notre vie et avec tout ce que nous possédons, c’est une de nos particularités principales : le langage verbal. C’est précisément à notre capacité de parler que l’on doit cet écart dans lequel s’enracine l’'"voir". Le mot n’est jamais la chose qu’il nomme, le sens n’est jamais sa dénotation et ne coïncide pas avec sa force illocutoire. Et toutefois, le langage (tout comme l’animal qui le possède) ne jouit pas d’une position de privilège particulier par rapport au détachement qu’il contribue pourtant à engendrer. En tant qu’élément de notre bagage biologique, le langage est quelque chose que nous avons, et il n’échappe donc pas au destin d’étrangeté qui le distancie de celui qui le possède. Ce n’est pas un hasard si cette relation particulière d’extériorité intime émerge dans toute sa puissance dans la célèbre définition de l’homme comme zoon logon echon (« animal ayant le langage ») à laquelle Virno consacre des pages d’une extraordinaire densité. Si, pour une fois, on met l’accent non pas sur le zoon ou le logon, mais sur ce participe présent insignifiant du verbe avoir (echon) qui relie les deux substantifs, on pourra finalement considérer le langage non comme un instinct spécialisé, mais comme une possession toujours instable, toujours précaire. Les phénomènes spéculaires de l’enfance (où le langage n’est pas encore présent) ou de l’aphasie (où le langage n’est plus), montrent comment l’animal parlant doit se réapproprier toujours et encore cette capacité innée qu’est la faculté de langage. Le processus d’appropriation réitérée et nécessaire de ce qui nous est déjà donné et qui toutefois jamais ne nous appartient ne concerne pas seulement le langage, mais bel et bien toutes nos ‘avoirs’ instables et précaires. Une forme particulière de synthèse a priori fait en sorte que le vivant s’approprie ses propres prérogatives sans jamais pouvoir leur correspondre. Pour illustrer ce processus, Paolo Virno a recours à la catégorie platonicienne de la participation (metexis, composé à partir du verbe echein [avoir]) relu d’un point de vue matérialiste comme une forme de la pratique. La metexis devient ainsi une "saisie aux fins d’usage", soit l’ensemble des actions qui permettent à l’animal humain non seulement de prendre part à, mais aussi de faire usage de ses prérogative phylogénétiques. Une saisie qui n’est jamais simple ni apaisante. Les prérogatives que l’animal parlant a et auxquels il participe étant indépendantes de celui qui les possède et risquant toujours de les perdre (ou de se retourner contre) doivent être constamment tenues sous contrôle, contenues et retenues. Apparaît alors, aux côtés de echein (avoir) et de metechein (participer), un troisième verbe, katechein (contenir), qui complète les déclinaisons possibles de la relation que l’animal humain entretient avec sa nature spécifique.
Toujours hors de soi
Mais quel animal est donc celui qui doit nécessairement avoir, prendre part à et contenir/retenir son essence et sa propre vie? C’est un animal constitutivement excentrique, destiné à rester toujours hors de soi. Il ne connaît pas l’équilibre, mais est toujours à la fois, créditeur et débiteur, précurseur et successeur de ses caractéristiques essentielles. Un animal qui peut seulement dire qu’il ‘a ce qu’il n’est pas encore’ et qu’il ‘est ce qu’il risque de ne plus avoir’. C’est l’animal paradoxal par nature qui aspire, sans jamais y parvenir complétement, à réaliser l’invitation de Paul de Tarse à avoir comme n’ayant pas et pour autant tout avoir.
* Cet article a déjà été publié en italien dans le quotidien Il Manifesto à la sortie du livre en Italie.