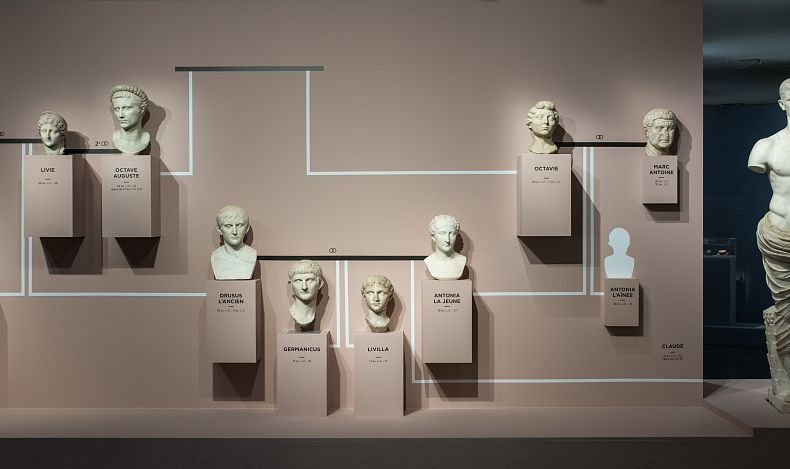La narratrice, confinée dans une maison bretonne avec son frère jumeau, s’attache à l’histoire d’un oncle inadapté : le style de l’autrice, née à Zurich en 1991, s’y adapte très bien.
L’oncle bancal apparaît dès le titre, dont la syntaxe bizarre retient déjà l’attention, mais moins que la première phrase cependant : « Une nuit, je me suis réveillée avec la certitude que l’oncle s’était enfui par le trou des toilettes […]. » Il pèse « un bon quintal » et n’est pas adapté au monde : à cinquante ans, il n’a pas vraiment quitté l’enfance ; sa chambre est remplie de détritus et d’objets inutiles auxquels il trouve une âme ; ses manies sont bizarres, son hygiène douteuse. Il est incontinent et le chapitre liminaire fait éprouver au lecteur cet art de déplaire dont semble hériter la narratrice, sa nièce, dans ce roman où la filiation aussi est bancale.
Traduire des notices de nourriture et jouets pour animaux
Tel est le métier, biscornu lui aussi, exercé par la narratrice et son frère jumeau, comme s’il fallait redoubler la bizarrerie du bilinguisme par la porosité entre les espèces. La mère des jumeaux les perçoit comme des étrangers, à cause de leur accent suisse. Pour sa part, elle est née en France et y a reçu une éducation qui ne la préparait pas à tant d’incongruités. Est-ce dans ce bilinguisme, propre à de grands auteurs de l’absurde, comme Ionesco ou Beckett, ou même Kafka, que l’autrice, qui écrit en allemand et en français, puise cette vitalité littéraire, cet art de la dissonance, cette façon de faire danser les monstres avec une fantaisie qui ne laisse pas d’inquiéter ? L’oncle n’est jamais nommé, mais on pense au Gregor Samsa de La Métamorphose et à toutes les familles biscornues de la littérature.
Une écriture singulière et entomologiste où la gravité ne pèse pas
Dans ce roman loufoque, qu’on lit d’une traite, en se demandant toujours jusqu’où on va être entraîné dans le rebut et la déglingue, l’écriture est inventive même quand elle semble piétiner. Les trois collègues jardiniers de l’oncle s’appellent tous Erwan : « nous avons pensé la même chose, ma mère, mon frère et moi, nous avons pensé que trois Erwan ce n’était pas banal tout de même, et nous les saluâmes comme s’ils étaient des bêtes curieuses, et eux s’abstinrent de toute présentation, car sans doute en avaient-ils assez de ce petit numéro. » La notion de norme semble être étrangère à cet univers plein d’humour et de « sacrés zozos ». Même les douleurs les plus intenses semblent prises dans une fantaisie créatrice dont on ne sait jamais où elle va s’arrêter, quand les images d’Épinal virent au cauchemar : « À l’âge de vingt ans, ma mère a quitté la France pour aller vivre en Suisse, où nous sommes nés mon frère et moi, où nous avons grandi dans une vieille maison à flanc de montagne, et c’est dans cette maison que notre père nous a offert deux lapins que nous gardions dans un clapier, et c’est dans cette maison qu’un jour d’été, suivant une odeur innommable, je suis tombée sur trois cadavres, et ma mère nous a longtemps assuré que les lapins avaient été dévorés par un renard, ce dont nous n’étions pas dupes, et je ne m’explique toujours pas pourquoi mon père a cru bon de sacrifier les lapins avant de s’occuper de son propre cas. »
Rebecca Gisler est aussi traductrice. Elle a l’art, en tout cas, de traduire, dans une syntaxe et une langue qui semblent toujours un peu « bougées », comme sur une photographie, les dérèglements de la vie dans leurs aspects les plus inaperçus.