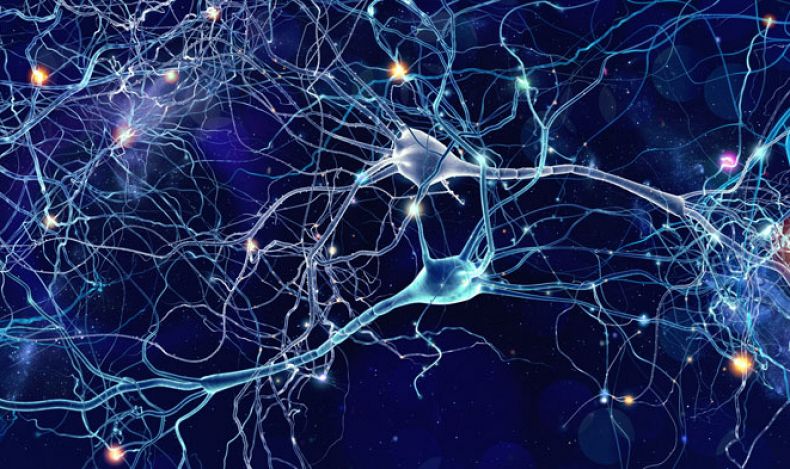Peter Hacker met en scène des théoriciens des neurosciences et des philosophes partisans de « l'analyse linguistique » qui échangent sur la nature de l'esprit et de la conscience.
Quelle est la nature de l’esprit ? Comment concevoir sa relation au corps ? Moi qui pense, que suis-je ? La pensée n’est-elle que l’activité du cerveau ? Comment la conscience peut-elle surgir de la matière ? Ces questions lancinantes et profondes appartiennent, avec bien d’autres, au domaine traditionnel de la philosophie. Mais l’avènement des sciences cognitives et des neurosciences, au cours de la seconde moitié du XXe siècle, semble avoir ouvert une nouvelle voie d’investigation.
Appuyées sur des techniques d’observation inédites comme l’IRM, ces sciences nouvelles ont développé des théories subtiles du fonctionnement cérébral et ont d’ores et déjà bouleversé notre compréhension des mécanismes neurophysiologiques fondamentaux de la perception, de la mémoire ou du langage. L’application de la méthode expérimentale aux problèmes classiques liés à la nature de l’esprit porte ainsi avec elle la promesse d’un savoir empiriquement fondé, dépassant les incertitudes liées aux méthodes spéculatives. Fascinés par cette promesse, nombreux sont les philosophes contemporains à s’être rangés sous la bannière du naturalisme, concevant leur propre travail comme un prolongement ou une aide à la construction de la connaissance empirique. En parallèle, nombreux sont les neuroscientifiques ou les spécialistes de la cognition qui n’hésitent plus à prendre position dans les débats philosophiques pour affirmer par exemple, comme Antonio Damasio, que « Spinoza avait raison ».
Revient-il désormais à la science d’éclaircir la nature de l’esprit, de la pensée, de la conscience ? La philosophie est-elle vouée à en devenir un simple auxiliaire ? Ce n’est pas l’avis du grand philosophe britannique Peter Hacker, qui dans ces Dialogues sur la pensée, l’esprit, le corps et la conscience, parus aux éditions Agone, s’empare d’un vénérable genre littéraire pour entreprendre, sur un mode plaisant mais argumentativement dense, un travail de démystification radicale.
La philosophie, une activité d’élucidation
Peter Hacker n’en est pas à son coup d’essai. Né en 1939, membre du St John’s College à l’université d’Oxford, il est internationalement reconnu pour avoir écrit, seul ou en collaboration avec Gordon Baker, de nombreux ouvrages de référence sur le sens et la portée de la philosophie de Wittgenstein . Mais il a également signé en 2003, avec le neuroscientifique australien Maxwell Bennett, un ouvrage intitulé Philosophical Foundations of Neuroscience (dont une version élargie est prévue pour la fin de l’année 2021), visant à dénoncer les confusions conceptuelles qui grèvent les travaux des neurosciences . Entre 2006 et 2021, il a travaillé à une ambitieuse anthropologie philosophique, organisée en une tétralogie visant à proposer un vaste panorama des cadres conceptuels nécessaires à l’appréhension de la nature humaine . À bien des égards, le volume publié par les éditions Agone se situe à la convergence de ces travaux et offre une introduction synthétique aux principales positions de son auteur, destinée explicitement à un public plus large que celui des publications académiques.
Traduit d’un livre récemment publié par Anthem Press, sous le titre Intellectual Entertainments. Eight dialogues on Mind, Consciousness and Thought (2021), le volume en reprend cinq dialogues, qui ont cependant été remaniés et enrichis par l’auteur à la demande de l’éditeur : deux sur l’esprit (sa nature, son rapport avec le corps), deux autres sur la pensée, un dernier sur « le mystère de la conscience ». Ont été laissés de côté des textes concernant le caractère objectif ou subjectif des qualités sensibles, ou encore la douleur. L’ensemble est complété par un avant-propos, une introduction de l’auteur ainsi qu’un appareil de notes des traducteurs aidant à identifier les nombreuses allusions aux textes classiques ou aux débats contemporains. Situés dans une sorte de paradis pour philosophes, entre banquet antique et senior common room oxonienne, les dialogues mettent en scène des auteurs de la tradition (Aristote, Descartes, Locke) et des personnages incarnant les théoriciens des neurosciences, aux prises avec des philosophes contemporains (Peter Strawson, Alan White) et avec d’autres personnages se faisant les hérauts des positions de l’auteur, inspirées des travaux de Ludwig Wittgenstein.
La critique dont ces derniers se font l’écho est dévastatrice : sur les questions relatives à l’esprit, les discours scientifiques contemporains comme les élaborations philosophiques qui s’appuient sur eux sont grevés de confusions conceptuelles profondes. Certaines questions (et par conséquent les tentatives pour y répondre directement) sont tout simplement des non-sens, des absurdités résultant de la fascination qu’exercent sur nous les formes de représentation déposées dans notre langage. Le remède proposé consiste en une « analyse linguistique », la description minutieuse du fonctionnement de nos concepts, qui doit nous permettre de déjouer cette fascination. Telle est en effet la spécificité de la philosophie : elle consiste en cette activité d’élucidation de notre appareil conceptuel à partir d’un examen du fonctionnement de notre langage (car, comme l’écrivait Wittgenstein, « maîtriser un concept, c’est maîtriser la technique d’utilisation d’un mot » .
Il ne s’agit donc pas, notons-le bien, de critiquer la science en tant que telle (son projet d’explication du monde ou sa valeur), ni de disqualifier les sciences cognitives ou les neurosciences. Mais Peter Hacker veut attirer l’attention sur le fait qu’il y a des difficultés qui ne relèvent pas du champ de la science et appellent par conséquent un traitement particulier qui conditionne par ailleurs l'orientation et l’interprétation correctes des recherches scientifiques et de leurs résultats. S’il entend proposer un divertissement à ses lecteurs, Peter Hacker ne cache pas l’intention pédagogique et critique qui le sous-tend : il s’agit de les « faire réfléchir » sur les questions examinées, mais plus encore de les encourager à mettre en question les questions elles-mêmes et de se défier du conformisme académique en la matière.
Ne pouvant examiner dans le parcours qui suit le détail de ces dialogues foisonnants, nous nous contenterons de présenter certains points saillants concernant le traitement des thèmes centraux.
L’esprit n’est pas le cerveau
Les deux premiers dialogues examinent des questions relatives à l’esprit. Quelle est sa nature ? Sommes-nous avant toute chose des esprits ? Et comment rendre compte de la relation entre l’esprit et le corps ? Les réponses combinent recours à l’histoire de la philosophie, argumentation et considérations méthodologiques visant à indiquer comment procéder pour s’extraire des difficultés.
Au cours de la première discussion, Descartes intervient pour rappeler sa position, conquise au terme de l’aventure du doute méthodique : puisque je suis certain d’exister tout en pouvant mettre en doute le fait d’avoir un corps, je suis avant tout une chose pensante, donc un esprit, une entité immatérielle qui peut exister indépendamment de tout corps physique. Mais comment dès lors rendre compte de sa relation à ce corps qui est le mien ? La position cartésienne se heurte d’une part au problème de la causalité mentale (comment une substance pensante peut-elle agir sur une substance matérielle ?), d’autre part à l’absence de critère d’identité (comment distinguer un esprit d’un autre ayant la même pensée ?).
L’idée d’esprit immatériel étant disqualifiée, les participants se tournent alors vers la position matérialiste selon laquelle l’esprit, c’est le cerveau. L’erreur de Descartes serait d’avoir manqué cette identité. Mais ils rencontrent ici une objection grammaticale plus profonde : cela n’a pas de sens de dire que le cerveau pense, perçoit, raisonne... . C'est en effet de l’être humain que l’on peut dire qu’il pense, qu’il perçoit, etc. Or, penser, percevoir, sont des termes renvoyant à des capacités. L’argument consiste à examiner les critères d’après lesquels on peut attribuer de manière sensée un pouvoir ou une capacité à quelque chose :
« On ne peut, de manière sensée, attribuer la vision qu’à des créatures dotées d’yeux avec lesquels elles voient, et qui déploient ou manifestent leurs capacités visuelles dans leur comportement, ou qui le feraient si elles n’en étaient pas empêchées ou temporairement hors d’état de le faire. Et si tel était le cas, nous saurions quel comportement compterait comme manifestation de capacités visuelles. Un tel comportement fait partie du répertoire comportemental d’un animal normal. Mais un cerveau n’a pas de répertoire comportemental. ».
Dire « le cerveau pense », c’est donc au mieux une métonymie, un énoncé synonyme de « je pense ». Mais la prendre au sérieux en oubliant qu’il s’agit d’une image, c’est commettre ce qu’Anthony Kenny appelait un sophisme méréologique (confondre une désignation de la partie avec la désignation du tout) et aboutir à un non-sens. Cette critique, insiste Hacker, n’est pas une marque de mépris envers la science. Elle concerne les conditions de signification de nos discours : « nous avons ici affaire à une question de logique et non à une question de fait » . Il y a non-sens lorsque l’usage des mots contrevient aux conventions qui leur donnent sens. Or « les conventions ne sont pas arbitraires » : leur autorité ne dépend pas de notre seul libre-arbitre.
La réflexion sur les pouvoirs ou capacités et leurs critères d’attribution met sur la voie d’une résolution des difficultés. L’erreur est en définitive de considérer « l’esprit » comme le nom d’une chose, là où il faut plutôt le définir comme le nom d’un ensemble de pouvoirs, de potentialités, ainsi que le suggérait déjà Aristote dans son analyse de la psychè . La question de savoir comment l’esprit (ou la psychè) peut mouvoir le corps, sur laquelle butait Descartes, ne se pose donc pas. En outre, les êtres humains peuvent faire des choses « avec leur esprit » (ils ont par exemple des capacités rationnelles), mais plutôt dans le sens où l’on peut faire quelque chose « grâce à ses talents », plutôt que « avec ses jambes » : « avec » ne sert pas toujours à indiquer l’instrument d’une action. Ce genre de technique de paraphrase et d’analogie permet de mettre en évidence ce que Ryle appelait les différences de catégorie, c’est-à-dire les différences de régime de fonctionnement des concepts.
La réflexion méthodologique se poursuit au cours du deuxième dialogue, à l’occasion de l’examen de l’expression « avoir un corps », qui peut être source de perplexité : j’ai un corps, mais moi qui ai un corps, que suis-je ? Les embarras philosophiques tiennent au fait qu’il y a « toute une mythologie couchée dans notre langage » : nos formes d’expression véhiculent certaines images, des « formes de représentation » qui nous abusent sur la logique réelle de ces expressions. Ici, l’on a tendance à comprendre le fonctionnement du verbe « avoir » sur le modèle de l’un de ses usages, celui où il renvoie à la possession d’un objet que je pourrais donner ou échanger. Mais je n’ai pas une relation de possession à mon propre corps (que pourrait signifier le fait de l’échanger ?). Il est néanmoins significatif que je puisse parler du corps que j’ai. Ce faisant, souligne Hacker, je renvoie aux caractéristiques corporelles qui sont les miennes, qui appartiennent à la personne que je suis ; je ne renvoie pas à un objet distinct de moi. Or ce qui est vrai de moi n’est pas toujours vrai du corps que j’ai : il peut être vrai de dire de moi que je suis têtu ou rêveur, mais on ne peut pas le dire de mon corps. C’est pourquoi « nous sommes enclins à penser que c’est quelque chose d’autre que le corps et distinct de lui qui doit être leur sujet, à savoir l’esprit. Mais c’est l’être humain qui est le sujet de toutes ces choses […]. » .
L’élucidation philosophique ne consiste donc pas à partir de ses « intuitions » sur telle ou telle question. Les intuitions ne sont au mieux que des convictions, des pressentiments ou des conjectures ; elles relèvent de l’opinion, là où il faut au contraire décrire la logique interne du langage. L’analyse linguistique, en démêlant les fils de notre emploi des mots, nous aide à comprendre la source de l’illusion qui est à l’origine des difficultés.
La pensée n’est pas une activité interne
Les troisième et quatrième dialogues se penchent sur la nature de la pensée et sur la question de savoir si elle requiert un medium, que ce soient les mots du langage ou bien des idées (au sens de Locke et Descartes, c’est-à-dire des représentations internes).
On est tenté de voir dans la pensée une activité intérieure, que l’on serait le seul à percevoir directement par le biais du « sens interne ». Mais va-t-il de soi que la pensée est une sorte d’activité ? D’un côté, semble-t-il, penser prend du temps, peut être accompli plus ou moins lentement. Mais d’un autre côté, il est tout à fait possible de réfléchir à la solution d’un problème sans que quoi que ce soit de précis ne nous passe par la tête, que ce soient des mots ou des images. En outre, nous ne décrivons pas le contenu de ce que nous pensons sur la base de ce qui nous passe par la tête, comme lorsque l’on décrit effectivement une activité en train de se dérouler sous nos yeux, par exemple l’activité du jardinier qui bêche, qui bine, qui arrose... S’il est vrai que raisonner prend du temps, cela ne signifie pas qu’exposer mon raisonnement consisterait à décrire ce qu’il se passe dans ma tête pendant que je raisonne. Le rapport de la pensée au temps est donc différent de celui d’une activité. L’image de l’activité intérieure nous fourvoie quand nous voulons comprendre ce que signifie « penser ».
Aussi « savoir ce que l’on pense » ne peut-il consister en une sorte de perception interne, selon l’image classique du regard intérieur que l’on trouve chez Locke ou Leibniz. Ici, « savoir » n’est pas le contraire d’« ignorer », comme lorsque j’ignore ce qu’un autre pense tant qu’il ne me l’a pas dit ; mais le verbe dans cet emploi signifie « pouvoir dire ». Avec cette remarque tombe la métaphore de « l’accès privilégié » à ses propres pensées : être capable de penser et de dire ce que l’on pense, ce n’est pas avoir accès à quelque chose.
Comme y insiste Hacker à plusieurs reprises, il n’y a de sens à dire que l’on a une certaine pensée que si l’on est capable de l’exprimer, donc si l’on dispose d’un répertoire comportemental suffisamment complexe. Or parler fait partie de notre répertoire comportemental. Cela signifie-t-il que l’aptitude à penser présuppose la maîtrise du langage ? Ou bien la pensée précède-t-elle la parole ? Il est tentant de dire que la pensée précède la parole et que les mots ne sont que les noms des idées (comme le dirait Locke) ou des concepts dans l’esprit. Mais un concept n’est pas un objet qu’il s’agit de dénommer : « Vous oubliez l’un et l’autre que la signification d’un mot peut être définie par sa place dans la grammaire du langage. Par conséquent, savoir ce qu’un mot donné veut dire revient à savoir ce que sont ses pouvoirs logiques. Saisir un concept, c’est saisir ses implications logiques, ses compatibilités, ses incompatibilités, etc. » . Pour posséder un concept, il faut dès lors être capable de mobiliser des règles d’inférence qui en sont constitutives.
Que dire dans ces conditions de la pensée animale ? Si les animaux ne parlent pas, ne faut-il pourtant pas admettre qu’ils pensent ? Certains éthologues contemporains n’hésitent pas à faire l’hypothèse que les animaux disposent d’une « théorie de l’esprit », qui leur permet de reconnaître les croyances de leurs congénères et de chercher à les tromper. La réponse mise en avant par le dialogue est complexe. D’un côté, on peut tout à fait admettre que les animaux pensent ou prennent de décisions, car « ce qu’on peut intelligiblement être dit penser est ce qu’on pourrait en principe exprimer en paroles ou en actes si les circonstances ne nous en empêchent pas […] ce qu’on pense est ce qu’on exprimerait si on exprimait sincèrement sa pensée » .
Le comportement complexe de certains animaux est justement le critère sur la base duquel on peut leur attribuer certaines pensées – et ainsi dire par exemple du chien qui guette l’arbre où il a vu grimper le chat qu’il croit que le chat est dans l’arbre. Mais d’un autre côté, il semble douteux, explique Hacker, que l’on puisse dire que les animaux ont des croyances, dans la mesure où l’on n’observe pas de comportement consistant à se représenter comme sont les choses, puis à les soupeser comme raisons d’agir valables ou non . Certaines pensées ne peuvent être exprimées qu’au moyen du langage. Ce sont d’ailleurs les capacités, pouvoirs et dispositions auxquels il nous ouvre qui font de nous des agents moraux, susceptibles de raisonnement, de responsabilité envers leurs actes et de sentiments tels que la culpabilité ou le remords.
Le « mystère de la conscience » : une mystification
Aux yeux de bien des neuroscientifiques et des philosophes de l’esprit, le plus grand mystère est celui de la conscience, dont il est question dans le dernier dialogue. Beaucoup sont d’accord pour dire que la conscience est une propriété émergente du cerveau, mais désespèrent de trouver la façon on pourrait faire le lien entre d’une part les états du cerveau tels que les décrivent les neuroscientifiques et d’autre part les états d’esprit tels que nous les décrivons ordinairement. Il semble y avoir un fossé infranchissable entre deux ordres de phénomènes : le spectre du dualisme cartésien rôde toujours.
Or cette image d’un fossé est un trompe-l’œil. L’enquête scientifique nous apprend par exemple quelle chaîne d’événements nerveux et neuronaux se trouve impliquée dans la vision d’une pomme rouge par un sujet d’expérience. On se demande alors comment quelque chose de mental, l’expérience visuelle en question, peut résulter de quelque chose de physique – comme si « voir une pomme rouge » désignait ici un événement qui pourrait lui-même faire partie de la chaîne causale . Or cette expression appartient à un niveau de description différent, qui relève d’un usage et de buts indépendants. La résolution de la difficulté dont s’occupe ici le dialogue repose sur une distinction logique cruciale : le système visuel est le véhicule de cette capacité qu’est le sens de la vue, véhicule dont le fonctionnement normal est requis pour l’exercice de nos pouvoirs visuels. Cette distinction entre capacité, véhicule et exercice que Peter Hacker reprend à Anthony Kenny (et sur laquelle il passe sans doute un peu vite) permet d’articuler logiquement les rapports entre ce dont s’occupe l’enquête scientifique et notre expérience ordinaire, sans tomber dans la fiction d’un cerveau-agent regroupant des informations pour fabriquer une image mentale dont on ne sait, au bout du compte, par qui elle est vue.
Une autre énigme concerne l’avantage évolutionnaire de la conscience : à quoi sert-elle au juste ? Ne pourrait-on imager des créatures fonctionnellement équivalentes mais dépourvues de conscience, qui se comporteraient de manière toute aussi efficace ? La question de la possibilité logique de tels « zombies » est assez vite écartée : des créatures qui seraient en tout point semblables à nous seraient comme nous ! Mais élucider le problème lié à l’avantage évolutionnaire suppose d’aller plus loin dans l’analyse positive de la conscience et des formes qu’elle prend. Au bout du compte, « la question de savoir à quoi sert la conscience se ramène à la question de savoir quel est l’avantage évolutionnaire d’être éveillé. Et la question de savoir à quoi sert la conscience perceptuelle de quelque chose se réduit à la question de savoir à quoi sert la capacité d’acquérir des connaissances par la perception périphérique » .
Reste l’énigme du caractère spécial de l’expérience consciente, sur lequel a mis l’accent Thomas Nagel dans un célèbre article : n’y a-t-il pas quelque chose que cela fait, d’être conscient ? Une qualité d’expérience particulière qui s’attache au point de vue d’un sujet ? Ainsi, souligne Nagel, nous n’avons aucun moyen de savoir ce que cela fait d’être une chauve-souris : ce point échappera toujours à la science. Mais, demande Hacker, pouvons-nous seulement répondre à la question « qu’est-ce que cela fait, d’être humain ? » ? Le problème est qu’une telle question suppose une classe de contrastes : « être humain » par rapport à être… quoi ? Puisqu’un être humain ne peut être autre chose qu’un être humain, la question de savoir ce que cela fait d’en être un est tout bonnement dépourvue de sens. Mais elle nous fascine, parce que c’est une question qui peut légitimement s’appliquer à certaines de nos expériences par ailleurs, puisque le propre des êtres sensibles est de pouvoir avoir de telles expériences.
Pour une forme de sobriété intellectuelle
Ces dialogues de Peter Hacker ne manqueront pas d’intéresser les lecteurs perplexes face aux questions fondamentales de philosophie de l’esprit. Toujours vifs, souvent denses, ils donnent un bon aperçu des méthodes philosophiques et des positions de leur auteur. On ne peut que se réjouir de cette parution, qui attire l’attention sur un immense philosophe britannique. Saluons également au passage le travail des traducteurs, dont les choix élégants donnent beaucoup de fluidité et de précision à l’ensemble.
Il n’est pas certain toutefois que ces dialogues suffisent à convaincre des lecteurs ayant une tournure d’esprit naturaliste. L’argumentation est parfois elliptique (ainsi de la distinction cruciale entre capacité, véhicule et exercice). Des questions ou objections qui peuvent naître à la lecture ne sont pas examinées. Par exemple : on peut comprendre pourquoi dire que « le cerveau rassemble des informations », au sens courant de ce dernier terme, pose problème aux yeux de l’auteur ; mais quand on parle de « traitement de l’information », on faire référence au concept construit par la théorie probabiliste de Shannon, que le dialogue ne mentionne pas. Par ailleurs, le fait que certains personnages représentant les neuroscientifiques capitulent ou « se rendent » complètement aux arguments exposés au cours du dialogue n’est pas réaliste. Bien entendu, le réalisme n’est pas un trait attendu du genre ; et sans doute y a-t-il un peu d’humour ou d’ironie dans cette mise en scène (dans la réalité du discours académique, les échanges ne prennent pas la même voie !).
On peut supposer qu’il s’agit avant pour Peter Hacker d’exprimer une attente : que les arguments qu’il développe avec d’autres soient davantage pris au sérieux – et en tout cas mieux compris, loin de l’image de l’armchair philosophy si souvent décriée (qui serait plutôt à trouver chez Quine, lequel n’hésitait pas en effet à faire de la psychologie a priori) . Sans doute s’agit-il également d’inspirer une attitude : aussi légitime que soit l’élan qui porte nos questions, elles peuvent receler des non-sens, et l’abandon à l’ivresse des mythologies qui nous fascinent gâte les résultats de l’investigation scientifique. Contre cette ivresse, Peter Hacker se fait le chantre d’une forme de sobriété intellectuelle, qui se marie très bien avec le vin et l’amitié.