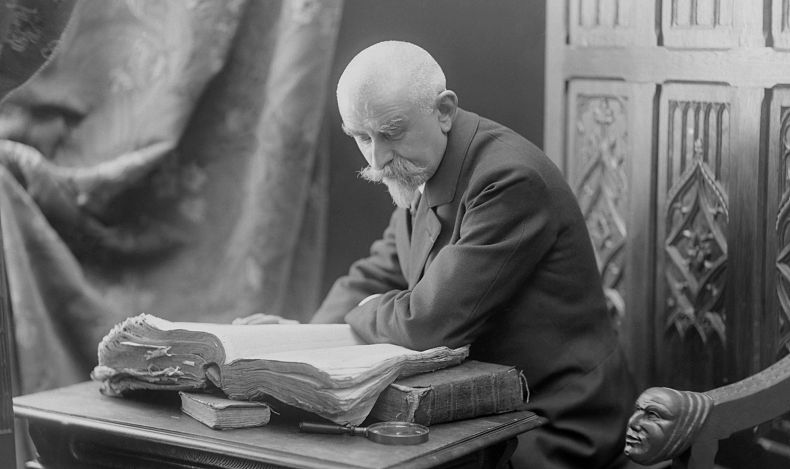A travers les figures de Huysmans, Bloy ou Claudel, Richard Griffiths examine le Renouveau catholique dans les Lettres françaises et son rayonnement international.
Richard Griffiths, spécialiste du Renouveau catholique, propose, dans un recueil d’articles importants, de montrer comment la littérature qu’on a constituée sous le nom de « renouveau catholique », réagit et œuvre en rupture avec les courants de son époque. Par l’importance de sa réflexion sur le mal et la rédemption, comme par l’usage de termes tirés de la liturgie, elle influe, directement ou non, sur une large production littéraire.
Huysmans, de la modernité naturaliste à la mystique chrétienne
C’est d’abord par des études portant sur deux hérauts de ce qu’on nommera par la suite le renouveau catholique que Griffiths fait débuter son ouvrage : Huysmans et Bloy.
Il montre d’abord que c’est seulement dans la préface de 1903 d’A Rebours, paru en 1884, que Huysmans défend l’idée que ce texte est une réaction contre Zola et l’école naturaliste, avec lesquels il décide de rompre. L’examen de sa correspondance, avec Zola ou d’autres, montre que ce roman s’inscrivait – ou du moins pouvait s’inscrire – dans le cadre du roman naturaliste. En effet, le naturalisme avait la prétention de rendre compte de tous les types d’existence : l’étude d’une névrose, celle du personnage principal d’A Rebours, Jean des Esseintes, pouvait donc se justifier dans le cadre du naturalisme. Par ailleurs, en bon naturaliste, Huysmans s’est servi de deux ouvrages étudiant les névroses, au point que, comme le note l’auteur, « les symptômes de des Esseintes, et les remèdes tentés, suivent pas à pas ces deux ouvrages ».
L’auteur analyse également la question posée par Huysmans dans En route : « Comment énoncer l’inexprimable ? » Car cette question révèle un problème qui touche nombre d’ouvrages catholiques. Les adjectifs et les substantifs qui dénotent l’ineffable y foisonnent : Dieu est « l’incompréhensible », « l’inconcevable époux », « cet esprit, cette Essence, cet être incompréhensible et sans nom ». Pour Huysmans, il faut essayer de trouver une nouvelle langue, purifié des sous-entendus dont sont chargées les langues que nous utilisons. Comme l’écrit Huysmans : « Afin d’en parler proprement, il faudrait oublier l’usage séculaire des expressions souillées. Nous en sommes réduits, pour qualifier ce mystérieux amour, à chercher nos comparaisons dans les actes humains, à infliger au Seigneur la honte de nos mots. (…) Comment énoncer l’inexprimable, comment, dans la bassesse de notre langue, désigner l’ineffable immersion d’une âme en Dieu ? ».
Ainsi, la seule manière dont nous pouvons nous figurer un tel Être, c’est en nous servant d’images anthropomorphiques, qui ne réussissent pas à nous convaincre. Or, il existe des moyens par lesquels on peut donner une impression de la vérité : l’art, la musique, la liturgie, la symbolique. Selon Huysmans, c’est le Moyen âge qui les a inventés, c’est à lui qu’il faut revenir. Grâce à cet usage médiéval des arts, la vérité a pu être « devinée » ou « entraperçue ». En effet, la vérité n’est jamais facilement accessible, même à travers l’art. L’art ne peut que suggérer l’Essence, que ce soit celle de Dieu ou de l’expérience mystique.
Parmi les arts, le plus pur est la musique. Huysmans parle de « ces répétitions de notes sur la même syllabe, sur le même mot, que l’Eglise inventa pour peindre l’excès de cette joie intérieure ou de cette détresse interne que les paroles ne peuvent rendre ». Et les mots dans ces textes ne viennent plus justifier rationnellement un discours ou rendre compte d’une élaboration théologique, mais sont des mots purs, autrement dit « déliés des attaches humaines et intellectuelles et des sous-entendus de la langue ordinaire ». Il en va de même dans les paroles de la liturgie.
Griffiths rend également compte du fait que, de l’avis presque unanime, plus Huysmans devient chrétien, plus son jugement esthétique décline. En effet, une fois devenu chrétien, il abandonne sa critique vraiment moderne de l’art moderne, et part en quête d’un art authentiquement chrétien. Mais il cherche l’art chrétien de son époque avec le regard formaté par l’art chrétien médiéval et reste ainsi aveugle aux nouvelles tendances formelles par lesquelles l’art chrétien se conciliait avec la modernité. Or l’art chrétien ne laissait aucune place à l’individualité de l’artiste : chacun donnait à Dieu ce qu’il faisait sans souci de reconnaissance, alors que Huysmans semble toujours déterminé à faire progresser sa carrière – même devenu chrétien. C’est Léon Blum qui met en évidence cette incompatibilité entre « l’individualisme du médiévalisant Huysmans et les vraies aspirations de l’art chrétien médiéval ».
Bloy et la « théologie de la douleur »
L’auteur se penche également sur Léon Bloy et met au jour le fait qu’on trouve dans Le Désespéré des « formulations chrétiennes de la douleur qui sont tout à fait en accord avec la théologie de la douleur que Bloy avait puisée dans les œuvres de Blanc de Saint-Bonnet et de Bonald ». Or, « ces formulations ne concordent pas, dans le reste du roman, avec la manière dont les souffrances de Marchenoir, et ses attitudes envers ses souffrances sont décrites », alors qu’il n’y aura pas cette disparité dans La Femme pauvre.
Il lit dans ce roman des caractères par lesquels Marchenoir rejoint le héros romantique. D’une part, comme pour un héros romantique, Marchenoir semble destiné à la souffrance ; dans son nom même s’inscrit son destin. Or le destin n’est pas la Providence divine du catholicisme. D’autre part, Marchenoir est « self-indulgent », il s’apitoie sur son sort. Et l’auteur souligne aussi que sa conception de la douleur, classique pour son époque, ne rend pas compte de son désespoir : si la douleur est une expiation, elle est dans l’ordre voulue par Dieu ; il n’y aurait donc aucune raison de désespérer, ce qui serait pécher en doutant de Dieu. On est face à un paradoxe ainsi formulé par l’auteur : la douleur « acceptée volontairement pour servir Dieu et notre prochain, n’a rien à faire avec un désespoir qui doute de Dieu et de ses desseins ».
Même s’il essaie de concilier ce désespoir et la stricte orthodoxie catholique, Bloy échoue. Aussi faut-il comprendre Bloy comme « un « écrivain-mort-de-Dieu », selon, l’appellation de B. Howells, pour qui d’une certaine façon Dieu est absent, ailleurs ou, en tous cas, dont le Règne « jamais n’arrive » selon le Désespéré. Dès lors, l’entremêlement de la foi et du désespoir de son héros ne comprend : l’humanité attend le règne de la justice promis par Dieu, mais comme elle n’arrive pas, sa conception de la puissance de Dieu vacille et Marchenoir vit « de l’espérance avec le plus amer pessimisme ».
Dans une autre étude, Griffiths examine le rôle des ordures dans le dessein de Dieu chez Bloy dont l’écriture fait une belle part au scatologique. Pour Bloy, « les lieux communs, les idées reçues, ont toujours une signification profonde cachée sous leur extérieur banal », dont l’Exégèse des lieux commun est la démonstration la plus évidente. L’auteur analyse Je m’accuse, texte où s’entremêlent deux thèmes : l’attaque contre Zola romancier, et particulièrement de son roman Fécondité, et l’Affaire Dreyfus qui remplit les pages du même journal (L’Aurore) au même moment (entre mai et octobre 1899). L’Affaire Dreyfus devient un mystère et possède une dimension eschatologique : le proscrit est innocent et est jugé coupable.
Bloy n’est ni dreyfusard, ni antidreyfusard, tant il pense que cette Affaire n’est que l’occasion pour des rivalités et des haines de s’exprimer, Dreyfus n’en étant que le prétexte. La croyance bloyenne en un sens caché des événements du monde fait de l’Affaire Dreyfus quelque chose dont il faut chercher le sens eschatologique et pas simplement relater avec des mots dont on trahit la signification authentique pour les besoins d’une polémique qui semble relativement superficielle aux yeux de Bloy. Avec l’Affaire se manifeste l’approche de la venue de Quelqu’un qu’on attend.
Paul Claudel, le théâtre et la liturgie
Dans son article, « Liturgie et jeux scéniques dans le théâtre de Claudel », Griffiths montre l'importance de l’influence de la liturgie sur le théâtre de Claudel. Aussi bien dans la forme du verset de Claudel que dans les allusions aux rites liturgiques, qui peuvent être des paroles ou des gestes qui rappellent ceux du prêtre. Ces allusions à la liturgie peuvent principalement avoir deux rôles : soit souligner la signification d’une pièce, soit produire des effets sur les émotions du spectateur. Ce qui présuppose implicitement que le spectateur a pris l’habitude depuis un certain temps de vivre les moments liturgiques auxquels la pièce fait allusion.
Dans La jeune fille Violaine et Le repos du septième jour, le recours à la liturgie à la fin récapitule la portée chrétienne de la première pièce et fait de l’empereur dans la seconde une figure christique. Dans l’Annonce faite à Marie, on trouve de nombreux éléments qui rappellent la liturgie : des personnages récitent le Regina Coeli (texte usuel pour l’Angélus au temps de Pâques), des citations entières de la liturgie figurent dans le cœur du texte, dans la scène de Miracle, Mara récite les Nocturnes de l’office de Noël, etc. André Vachon note que la seconde naissance est associée à la mort et à la résurrection dans la pièce. Mais jusqu’en 1913, la signification de la liturgie, comme le dit l’auteur, « pour être vraiment appréciée nécessiterait une lecture du texte », tandis qu’ensuite Claudel s’implique davantage dans la réflexion sur la représentation de la pièce et modifie, d’une certaine façon, la présence de la liturgie dans son théâtre. Ainsi, la coupe des moments de prière liturgique dans l’Annonce faite à Marie quand il se décide à la faire jouer, ou quand il réfléchit à la scène de la fraction du pain pour en faire « un effet théâtral de premier ordre ».
Dans les pas de Maurice Barrès
Reconnaissant l’importance de Barrès pour toute cette littérature, l’auteur examine ensuite la religion et Barrès. On dit souvent que Barrès se serait converti au catholicisme pour des raisons politiques, comme Maurras : il aurait vu dans le catholicisme l’incarnation de cet ordre qui devait gouverner l’Etat et y aurait ajouté l’idée du catholicisme comme religion française et religion de la terre et des morts. Pour Barrès, puisque nous sommes en continuité avec nos pères, il faut chercher la vérité non pas dans des théories abstraites, mais dans nos impulsions instinctives. Barrès dit : « Voilà dans quelle maison je veux habiter. Il me suffit qu’elle me vienne de mes ancêtres sans que je sache si elle me vient de Dieu ».
Pour expliquer l‘importance du catholicisme, il utilisait une image de Carlyle : « Dans tous les cordages de la marine britannique court un fil rouge qui y a été placé pour les authentiquer, pour marquer leur origine. Eh bien ce fil rouge, ce fil catholique court dans toutes les œuvres françaises, je veux dire ouvrages et actes ». Il défend également l’idée que le catholicisme était le baume contre ce qu’il appelait « ses douleurs devant la mort ». Le catholicisme était la religion de ses pères, mais cela ne signifiait pas qu’il était vrai. Ce n’était pas là le point crucial, ce qui comptait davantage, c’était qu’il s’y sentait chez lui.
Pour Barrès, comme le dit l’auteur, le sentiment religieux est plus important que la religion et, surtout, que sa prétention à la vérité. Pour lui, les religions sont nécessaires pour l’homme car elles excitent un champ de sensations. Il écrit ainsi : « Ma foi, je n’essaie pas de l’expliquer, je l’admire, je l’aime, elle m’enthousiasme, elle quelque chose que désignerait un mot où il y aurait sorcière et sainte, et enchanteresse. Bref le génie poétique l’animait. »
Ernest Psichari, soldat et saint
Griffiths examine aussi le cas de Psichari qu’accompagnent trois légendes : celle du soldat chrétien avant la Première guerre mondiale, puis, après sa mort sur le champ de bataille, celle du chrétien qui meurt en victime expiatoire, expiant les péchés de la France, et, plus particulièrement, ceux de son grand-père, Renan ; enfin, après la publication posthume de son roman, Le Voyage du centurion, la légende du soldat français en Afrique du nord, converti au christianisme sous l’influence de l’Islam.
Ces légendes contiennent une part de vérité, mais ont induit – la dernière surtout – des historiens en erreur quant à l’influence de l’Islam dans le renouveau catholique français. Psichari, comme Maritain, est le représentant de cette génération d’avant-guerre catholique et réactionnaire qui avait renversé l’attitude de ses pères républicains. Et Psichari représente même pour la droite catholique l’alliance de l’Armée et de l’Église nouant entre elles les figures du saint et du soldat. Et Psichari, accusant la République d’avoir détruit les valeurs, souscrit à cette version dans ses lettres. Ces mêmes catholiques voyaient la guerre avec l’Allemagne comme une sorte de croisade et la mort de Psichari a participé à la réhabilitation du catholicisme, hostile à la République, comme partie intégrale de la nation. On a même pu utiliser la doctrine si importante dans le renouveau catholique de la souffrance expiatoire pour faire de la mort de Psichari une expiation des fautes que la République, par l’intermédiaire de son grand-père, avait commises.
Or, de cette expiation des fautes familiales, nulle trace solide ne vient étayer l’affirmation. De plus, dans le roman posthume de Psichari, la conversion au catholicisme du personnage principal a été lue comme un élément autobiographique, de telle sorte que pour beaucoup d’historiens du renouveau catholique, l’Islam a été le « catalyseur » de la conversion de Psichari. Or, comme le montre l’auteur, l’admiration d’un chrétien pour la piété musulmane, piété qui fortifie la foi chrétienne, est un topos littéraire et une attitude répandue dans l’armée française sous la troisième République (comme l’atteste l’exemple d’Henry de Castries étudié par l’auteur, ou Foucauld). Or, si dans son roman Psichari développe ce thème, ses lettres témoignent de son éloignement de cette tradition militaire et chrétienne.
Un rayonnement international
Griffiths montre dans la dernière partie de l’ouvrage les directions dans lesquelles les influences du Renouveau catholique se sont exercées. Il donne d’abord les raisons pour lesquelles les romans catholiques de Huysmans eurent un grand succès en Angleterre, contrairement à ses romans décadents et critiques de la bourgeoisie. Pour Griffith, cela tient au contexte : « depuis des années, l’Angleterre était en plein renouveau catholique ; les conversions de l’église anglicane au catholicisme se multipliaient ; même si le catholicisme demeurait la religion minoritaire, il parvenait à une nouvelle respectabilité et à une réception plus favorable dans la population en général. Ce renouveau avait donné naissance à une littérature considérable ».
Il étudie la réception des romans de Huysmans d’une part chez John Gray, un ancien membre du cercle d’Oscar Wild et Wilfrid Ward. D’après l’auteur, ce qui plaît autant dans les romans catholiques de Huysmans, c’est leur message théologique : une conception de la rédemption selon laquelle tout pécheur peut se repentir, et « être accepté et absous de ses péchés ». D’autre part, il analyse l’influence de ces romans sur les livres de R. H. Benson et montre que ce dernier trouve en Huysmans un thème catholique, central à l’époque, « la peur du Mal, du Mal vu comme un esprit maléfique doué d’une existence concrète ». Corrélativement, Benson reprend à Huysmans sa conception du rôle mystique de la souffrance.
Dans un autre texte, l’auteur montre qu’Ernst Jünger lit beaucoup Bloy, en particulier son Journal, pendant la seconde guerre mondiale et cette lecture modifie sa compréhension des événements qui l’entourent. Il est fasciné par la « force d’absolu » de Bloy et l’importance qu’il donne à la mort, qui en atteint l’être essentiel de chacun en ce moment crucial, et aux morts. Comme Bloy, il associe l’apocalypse à la Russie, impute à la technologie moderne les catastrophes de la fin des temps. La caractérisation du démoniaque bloyen est reprise par lui pour évoquer le nazisme. Trop d’auteurs, qu’il lisait auparavant avec plaisir, lui semblent, à la fin de la guerre, en quelque sorte dépassés parce qu’ils n’ont pas connu la situation qu’il estime apocalyptique et à laquelle Bloy fournit des mots pour la dire et essayer de la comprendre. Il hérite également de sa lecture de Bloy une compréhension de la vie chrétienne comme consolation.
Enfin, Griffiths étudie l’influence d’un thème de la pensée maistrienne dans des textes de Mauriac et de Graham Greene. Si l’aspect le plus important de l’influence maistrienne est la question de la réversibilité, un autre thème, laissé davantage dans l’ombre, est celui du lien entre ce qui est saint et ce qui est coupable, tous deux sont « sacrés ». Huysmans témoigne de l’importance de ce thème, puis Claudel, mais surtout Péguy, pour qui il y a une « élection du péché ». Pour Péguy, quelqu’un qui n’est pas chrétien ne pourrait pas pécher, et le pécheur, pourrait-on dire, est un chrétien en raison de son acte même. « Le saint et le pécheur, écrit l’auteur, se tiennent par la main, et l’un tire l’autre au salut ».
Cette parenté entre le saint et le pécheur est « pour les représentants d’une religion minoritaire (comme le catholicisme britannique, et comme le catholicisme français sous la Troisième République), un thème qui a un attrait spécial, parce qu’il accentue les différences entre la foi et le monde du dehors. Pour le monde du dehors, la justice humaine est toute simple, et il n’y en a pas d’autre ; mais pour le chrétien, la justice de Dieu diffère complètement de la justice humaine, et le concept divin de justice insaisissable en termes purement humains. Dans l’œuvre de Greene, par exemple, le concept catholique du ‘’bien’’ et du ‘’mal’’ est mis en opposition avec les opinions du monde sur le ‘’bien’’ et le ‘’mal’’. Heureusement pour Greene, la langue anglais permet de faire une opposition nette entre les deux concepts puisque ‘’bien et mal’’ deviennent, du côté théologique, ‘’good and evil’’ et, du côté du monde, ‘’right and wrong’’. » Dans les Anges noirs de Mauriac, comme dans Brighton Rock, on trouve une incompréhension entre des personnages croyants qui ont une expérience du surnaturel et le reste du monde qui y est aveugle.
Ainsi, c’est à un vaste panorama du Renouveau catholique et de ses influences que nous convie ce très riche et érudit recueil.