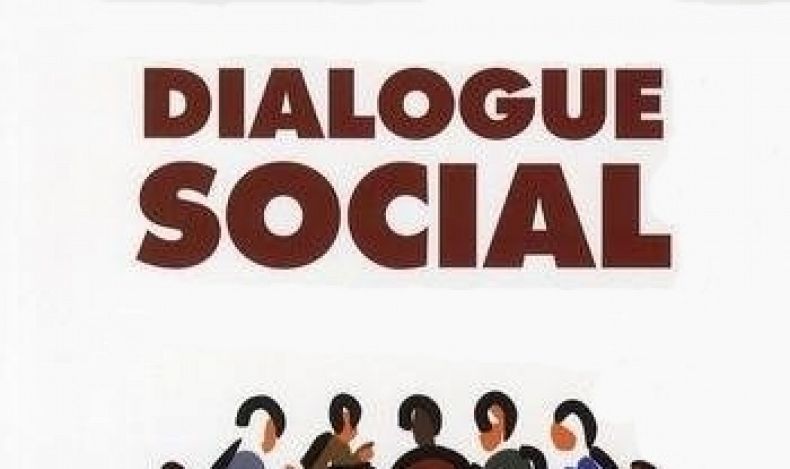Le dialogue social à la française reste marqué par le rôle de l'Etat et une culture de l'affrontement. Derrière ces apparences, quelles mutations se font jour ?
Au-delà des approches classiques sur les grèves ou le syndicalisme, ce livre collectif et interdisciplinaire Le social et le politique (CNRS éditions) appréhende les mutations de la démocratie sociale et de son rapport au politique, concernant aussi bien les nouvelles relations sociales dans l'entreprise que les acteurs qui y agissent en lien avec le politique.
Guy Groux, qui a co-dirigé l'ouvrage (avec Richard Robert et Martial Foucault), revient ici sur l'avènement de cette démocratie sociale et ses enjeux.
Nonfiction : Votre ouvrage se concentre sur la question de la démocratie sociale et de son rapport à la politique. En quoi cette approche renouvelle l’étude des objets traditionnels de ce champ, comme la grève, le syndicalisme ou la négociation collective ?
Guy Groux : L’ouvrage part d’une réalité bien connue, la crise du politique et de la démocratie représentative. Pour compenser les effets de cette crise, on a pu assister dans divers domaines à la recherche de nouvelles formes d’expression démocratique plus ou moins participative comme la récente convention citoyenne pour le climat par exemple. Sur le terrain social, cette recherche de « plus de démocratie » s’est jouée depuis quelques années dans une sorte de « révolution institutionnelle ». Dans un pays très centralisé où l’Etat encadrait fortement les rapports entre les partenaires sociaux, ces derniers sont devenus de plus en plus autonomes face au législateur par le fait notamment de la loi El Khomri ou des ordonnances Macron. Pour beaucoup, il s’agissait là d’une « inversion de la hiérarchie des normes » entre la loi et les règles fixées au niveau de l’entreprise. A l’évidence, le fait que le législateur ait délégué aux partenaires sociaux une part importante de ses prérogatives a pu donner lieu à un élargissement de la démocratie sociale au sein de l’entreprise. Dans ce contexte, l‘étude des syndicats ne peut plus s’en tenir à l’analyse de leurs seules pratiques revendicatives ou protestataires (la grève, la négociation traditionnelle, etc.). Avec les lois récentes, les syndicats s’engagent dans des accords collectifs qui renvoient à des processus de co-construction de règles communes. Mais au-delà des seuls acteurs sociaux, l’ouvrage pose une autre question : en quoi, la démocratie sociale peut-elle pallier les effets dus à la crise de la démocratie représentative ? C’est là un aspect important de l’ouvrage qui déborde la seule étude des syndicats pour aborder des contextes plus généraux comme le rapport de l’entreprise au politique et les jeux d’interactions qui s’établissent entre la loi et le contrat.
L’intervention de l’Etat dans la vie sociale française ne connaît guère d’équivalent ailleurs. La co-existence entre l’interventionnisme étatique et la faiblesse des partenaires sociaux semblent s’entretenir. L’entreprise peut-elle aujourd’hui être en mesure de se substituer, au moins en partie, à l’Etat concernant la production de normes sociales ?
Dans le passé, François Mitterrand ou Lionel Jospin ont pu dire : « L’Etat ne peut pas tout ». De la même façon, on pourrait dire « l’entreprise ne peut pas tout » même si elle s’appuie sur des accords collectifs de plus en plus autonomes face à la loi. Et c’est peut-être encore plus vrai dans le contexte actuel où jouent la pandémie liée à la Covid-19 mais surtout et à plus long terme une double transition, la transition numérique que beaucoup comparent à une nouvelle « révolution industrielle » et la transition écologique. Au sein de l’entreprise, la transition numérique entraîne le bouleversement des savoir-faire, des communications hiérarchiques ou de nouvelles formes d’organisation comme le télétravail par exemple. Dans ce cadre, l’autonomie contractuelle de l’entreprise demeure importante voire se renforce et pour cause : l’impact du numérique implique des situations de travail extrêmement disparates que ne peut réguler de façon efficace « la loi qui s’applique de manière uniforme à tous ». En l’occurrence, les régulations produites par les partenaires sociaux jouent un rôle essentiel. Mais les menaces qui pèsent sur l’environnement ou le climat ne s’arrêtent pas aux frontières de l’entreprise. Le rôle des pouvoirs publics au niveau local, national ou européen reste ici incontournable même si l’entreprise fait face à la situation présente comme le montrent les accords collectifs s’appuyant sur des principes de RSE (responsabilité sociale et environnementale) ou de développement durable. Dans les faits, entre les pouvoirs publics et l’entreprise existent à divers niveaux de nouveaux échanges qui s’étendront beaucoup à l’avenir.
La crise de l’Etat-providence rencontre une crise de la représentation politique, que le Baromètre de la confiance politique du CEVIPOF et le Baromètre du dialogue social mesurent chaque année. Il en résulte de vives tensions sociales en France, observables dans la rue à plusieurs reprises ces dernières années. Quels sont les leviers pour renforcer la légitimité des différents acteurs impliqués dans le dialogue social ?
De la Libération à nos jours en passant par les « lois Auroux » des années 1980, fut privilégiée une institutionnalisation accrue des syndicats pour conforter leur légitimité. Ceci n’a nullement empêché une crise du syndicalisme particulièrement forte et l’existence d’effectifs syndicaux qui se situent au dernier rang comparés à ceux des syndicats des pays de l’UE. En outre, l’institutionnalisation massive du syndicalisme dans l’entreprise implique un effet particulier que soulignent les enquêtes annuelles du CEVIPOF sur le dialogue social : pour beaucoup de salariés, les représentants syndicaux sont de plus en plus éloignés des préoccupations de la « base ». D’où la faible confiance qu’ils accordent aux syndicats en général. Pour palier cet état de fait, on pourrait penser qu’une issue possible réside dans l’élargissement de la démocratie sociale et une implication réelle des salariés et de leurs élus dans les processus de décision économique comme le souhaitent d’ailleurs aujourd’hui près de 70 % des salariés. Certes, de la loi Rebsamen (2015) à nos jours, certaines mesures favorisent une telle implication comme la présence de syndicalistes dans les Conseils d’administration ou l’essor des accords collectifs portant sur la performance économique. Reste qu’en la matière, la France se situe très « à la traîne » au regard de ce qui existe très souvent en Europe. De ce fait, on peut penser que la question de la codétermination dans l’entreprise se posera avec vigueur à court terme et qu’elle contribuera à renforcer la légitimité des syndicats qui au-delà des domaines (purement) sociaux peut s’appuyer sur des domaines liés à la décision voire à la stratégie de l’entreprise.
L’un des mérites de l’ouvrage consiste à replacer la démocratie sociale française dans un cadre comparatif, pointant par exemple les différences avec les Etats-Unis ou l’Europe du Nord, où la social-démocratie s’est enracinée au sein du mouvement syndical, mais aussi mondial avec l’OIT. Quel est l’impact de ces forces sur le champ syndical français, si éloigné de la culture du compromis et du consensus ? Dans quelle mesure est-ce réellement structurant ?
Notons tout d’abord qu’en France, les syndicats ne sont pas tous opposés à la culture contractuelle ou du compromis. Face à un pôle protestataire toujours très actif, la présence d’un pôle réformiste - de l’UNSA à la CFDT en passant par la CFTC voire de nombreux secteurs de FO - est tout aussi indéniable. Quant à l’influence de forces internationales dans le champ syndical français, elle est évidente à bien des égards. On vient de le voir avec les nouvelles aspirations qui se font à propos de la codétermination dans l’entreprise. Mais d’autres exemples existent et pour n’en citer qu’un, on peut se référer à l’influence du contexte syndical et politique européen. Longtemps en France, existait une réelle hostilité syndicale à l’égard du capitalisme d’où une fréquente défiance face à l’économie de marché. Dans le même temps, les syndicats du Nord de l’Europe et plus particulièrement les syndicats allemands se reconnaissaient dans le principe de « l’économie sociale de marché » qui vise à lier le « social et l’économie ». Après les efforts de Jacques Delors en faveur d’une Europe sociale, « l’économie sociale de marché » a pu inspirer des textes essentiels de l’UE. Aujourd’hui en France, ce principe est largement reconnu dans le champ syndical au moins dans les faits sinon toujours dans les mots.
Représentants syndicaux, référendum d’entreprise, participations, élections : la démocratie sociale s’inscrit dans les pas de la démocratie politique, jusque dans son vocabulaire. Sans parler de la Covid-19, la digitalisation affectera-t-elle autant la première que la seconde ?
Comme la démocratie politique, la démocratie sociale se fonde sur le principe de la représentativité et de l’élection. Et comme pour le « politique », la digitalisation et le numérique ont eu des effets concrets sur le dialogue social et le syndicalisme. En témoignent dans le contexte de la Covid-19, la multiplication des accords d’entreprise ou l’étendue de la concertation sociale dues au numérique ou au « distanciel ». En ce sens, on pourrait évoquer une sorte de « déterritorialisation » du dialogue social. Mais en dehors des institutions du dialogue social, une tendance récente s’affirme à savoir la mobilisation des réseaux sociaux. Ceux-ci ont pu influer sur certains conflits comme lors des grèves s’opposant à la réforme des retraites durant l’hiver 2019-2020. Mais surtout, leur impact apparaît de façon beaucoup plus durable et dans des entreprises de plus en plus nombreuses avec la création de forums d’expression permanents qui se créent à l’initiative de salariés pas forcément syndiqués et qui peuvent interagir ou parfois s’opposer au dialogue social institutionnel et à ses représentants dans l’entreprise. Il s’agit là d’une extension extra-institutionnelle de la démocratie sociale facilitée par les nouvelles technologies et à laquelle il faut accorder un réel intérêt et pour cause : sous diverses formes, l’expression des salariés « à la base » ne peut que se développer avec un numérique toujours plus performant.
Pour conclure cet entretien, la dernière partie de votre ouvrage offre trois contributions à visée prospective. Les objectifs du développement durable 2030 de l’ONU font du travail décent l’une de ses 17 priorités. De la même manière, on peut reprendre nos échanges précédents sur la question écologique. En effet, un siècle après sa création, l’OIT a donné à ses objectifs, une dimension environnementale inexistante à l’époque. Dans quelle mesure la démocratie sociale contribuera-t-elle à ces objectifs de transition écologique mais aussi solidaire ?
Votre question porte sur deux points : ce que dit l’ouvrage de la démocratie sociale de demain et ce que peut faire celle-ci face à la transition écologique et aux besoins accrus de solidarité. Sur le premier point, il s’agit d’un choix éditorial. Plutôt qu’une conclusion « plus ou moins fermée », l’ouvrage s’achève sur des ouvertures proposées par trois grands acteurs du dialogue social à propos des défis et des enjeux futurs de la démocratie sociale. Parmi ceux-ci, Jean-Denis Combrexelle - haut-fonctionnaire - insiste sur les exigences nouvelles qui impactent la sphère publique, Marcel Grignard - ancien syndicaliste - évoque la transformation des entreprises, les territoires et l’Europe tandis qu’un autre syndicaliste Sandrino Graceffa se penche sur l’essor dans l’UE de nouvelles formes de mobilisation collective qui se développent en marge des syndicats institutionnels à partir des revendications de travailleurs qui ne s’inscrivent pas ou plus dans l’univers traditionnel du salariat : créatifs, artistes, start-uppers, travailleurs liés à l’économie collaborative des plateformes numériques ou au digital auto-entrepreneurs, précaires, intermittents, « ubérisés »...
Autre point, la contribution de la démocratie sociale à la transition écologique et solidaire, aux principes de l’OIT mais aussi au « Global Deal » initié en 2016 par le gouvernement suédois. Sur ce plan, on peut se référer à un exemple précis : les accords signés par de grands groupes internationaux qui ont eux-mêmes inspiré certaines initiatives prises par les institutions mondiales. En l’occurrence, les entreprises françaises ont joué un rôle moteur, les trois premiers accords de ce type signés entre 1989 et 1995 l’ayant été grâce à BSN, Danone et Accor. Depuis, on en compte plusieurs centaines, conclus avec des organisations syndicales mondiales comme UNI Global Union par exemple. L’une des particularités des « accords traditionnels » signés au niveau local - en France ou ailleurs - est de porter surtout sur des aspects purement matériels ou organisationnels (salaires, conditions de travail …). A l’inverse et pour diverses raisons, les accords cadres internationaux (ACI) privilégient ce qui relève de questions sociétales ou éthiques. Il en est ainsi de thèmes comme la RSE, la protection des plus fragiles notamment face à l’exploitation dans certains pays des femmes et des enfants, les discriminations, le harcèlement sexuel, les droits du consommateur et bien sûr la question des libertés syndicales et des garanties accordées à la négociation collective souvent niées par beaucoup d’Etats dans le monde. Se dessine ainsi une démocratie sociale à « l’International » qui contribue aux objectifs écologiques ou solidaires définis par les grandes organisations mondiales quand elle ne les inspire pas - répétons-le - directement. Certes, on assiste aujourd’hui à l’essor de régimes « illibéraux », à la montée de mouvements radicalement opposés à l’économie de marché ou à la dégradation des conditions de travail et d’emploi au niveau mondial soit autant de faits qui entravent la concrétisation des ACI dans de nombreux pays. Mais précisément, ce sont ces bouleversements qui justifient aujourd’hui plus qu’hier, une démocratie sociale à « l’International » toujours plus affirmée. Et tout à la fois autonome et servant d’appui aux objectifs fixés par les grandes organisations internationales de l’OIT à l’ONU.