Au détour de sa conférence de presse de la Semaine d’art et sur les ondes de France culture, Olivier Py a ré-exprimé les fondamentaux idéologiques d’une politique pour le théâtre public.
L’ambiance a changé, tout le monde le sait. Notre époque est désormais celle d’un « covidocène » qui n’épargne personne (Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés). Elle se présente comme un messager qui répète une annonce bien connue, mais cette fois explicite : l’annonce de toutes les misères que nous prépare un anthropocène calamiteux.
Du ronron d’autrefois
Dans cette ambiance délétère (Les Tourterelles se fuyaient : / Plus d’amour, partant plus de joie), les interventions médiatiques du directeur du festival d’Avignon ont quitté le registre de ronron idéologique où elles se déployaient jadis.
On regretterait presque ce ronron qui nous berçait chaque année. Le festival d’Avignon « passait » dans les médias au même titre que celui de Cannes. Dans le même registre, on était informé chaque année des 24 heures du Mans, du salon de l’auto, de celui de l’agriculture, de ces grands rendez-vous que tout le monde connaît, auxquels, en proportion, peu de gens (des passionnés, des connaisseurs, des professionnels et des curieux) se rendent et auxquels paraissent, aux côtés des édiles, les ministres de la République.
Qu’est-ce qu’un ronron idéologique ? C’est un propos consensuel qui flatte nos consciences et glisse sur le monde. Est-il grave que le directeur du festival d’Avignon se soit livré chaque année à l’exercice d’un propos consensuel et flatteur à l’adresse de nos consciences, largement diffusé dans les médias ? Certes non. Le ronron idéologique est de l’ordre du rituel, du palabre, du discours inaugural… il est neutre. Il ne fait ni bien ni mal. Il est comme l’air de trompette que tous les festivaliers connaissent, qui retentit au début de chaque représentation : il est un signal inaugural. Ni plus ni moins.

Et ce ronron délivrait toujours un contenu sérieux et grave. Il s’agissait des grands problèmes humains et de leurs avatars contemporains (la guerre, le génocide, la migration, l’environnement, la condition féminine, l’amour, la mort…). Le consensus se concrétisait du côté du bon sentiment : dénoncer notre inaction à guérir les maux de la terre, inviter à la compassion pour les souffrants, flatter une posture d’indignation sans être dupe pour autant de notre impuissance, tout cela tournait à peu près rond et, comme de juste, glissait sur le monde sans le toucher.
L’essentiel était que les artistes, sur les plateaux, n’écoutent pas le directeur, ne se laissent pas aller à cultiver le bon sentiment et conservent leur propre manière de s’emparer de ces questions, c’est-à-dire continuent de créer des œuvres d’art. La création et la réception d’une œuvre n’ont rien d’idéologique. Elles sont énigmatiques. Sur fond d’émotion, de sensibilité, de raison, d’esprit, la réception d’une œuvre ne tisse dans le public aucun lien communautaire, aucun lien religieux, pas même un lien politique. L’art exprime une adresse totale et subjective ; il s’adresse à la personne de chacun, il s’adresse à un sujet (un corps sensible et doué d’un cerveau – un sujet incorporé). Il crée les conditions d’un possible effet. Un effet parfois profond qui transforme les personnes sans attenter à leur liberté.
Or, ni l’énigme ni le questionnement ni la nuance ne sont des objets adéquats pour les médias. Restait au ronron idéologique du directeur, à proprement parler, de tenir lieu, dans les formes possibles d’une diffusion médiatique, de manifeste pour l’art et les artistes, et de justification pour une politique publique de la culture. Une fonction dont il s’acquittait très honorablement.
Un réveil brutal
Puis le covid vint et Avignon fut annulé. Après un été passé en silence, l’équipe du festival vient de programmer, le 23 octobre, une « Semaine d’art » présentant sept spectacles rescapés et donnant une occasion à son directeur de revenir vers les médias parler de l’art théâtral, en conférence de presse et sur France Culture, notamment.
Or l’époque est transformée. L’économie du spectacle vivant, du fait du premier et cette fois du deuxième confinement, est par terre. En foi de quoi nous pouvons dire que l’heure est grave : l’art théâtral en France court aujourd’hui le danger de subir une très forte rétractation d’activité ; plus de public, partant plus de création.
Dans cette situation, la fonction idéologique de l’événement théâtral qu’est le festival change de nature. Le Raminagrobis de jadis ne ronronne plus. Olivier Py, le 24 octobre , a pointé ce télescopage étrange entre les représentations abstraites de jadis et les effets concrets de l’histoire. Le thème du festival estival disparu devait être, en effet, Eros et thanatos. A cette approche thématique se substituait donc brutalement « l’entrée fracassante de la mort dans notre quotidien », releva-t-il. « Vous connaissez le mot de Bossuet au trépas de Molière : il a voulu jouer la mort et la mort s’est jouée de lui. Il nous est arrivé la même chose. »

Sans la pandémie, en effet, le consensus se serait fait autour de ce principe : « la mort n’a plus de place dans nos vies ». La mort est niée, elle est cachée, elle n’arrive qu’aux autres, elle n’a pas droit de cité, et même si bien sûr nous la subissons tous, elle n’est pas de bon ton, elle est exilée dans les unités de soins palliatifs où nous disparaîtrons chacun à notre tour. Notre attitude face à la mort interprète de la plus mauvaise manière possible la formule d’Epicure selon laquelle elle n’est rien pour nous. Dans ce temps-là d’avant la pandémie, dans la bouche du directeur et dans nos existences de sujets sociaux, il ne s’agissait que de mots, sans aucune prise sur quelque changement que ce soit de la société et de nos mœurs. Et cela, encore une fois, n’avait aucune importance. Le ronron ne faisait qu’envelopper le festival, il lui servait de prétexte. A charge alors, as usual, pour les artistes, de prendre à bras le corps cette thématique du désir, de la vie et de la mort, non plus dans l’idéologie, ni même dans la politique, mais simplement dans l’ordre de la création artistique, et de nourrir nos âmes.
Lever le rideau
Mais à présent plus de ronron. Le ton a changé : « Il ne faut vraiment pas traiter à la légère cette question du protocole sanitaire, dit Olivier Py, mais il faut en même temps trouver le moyen de lever le rideau, car si on ne lève pas le rideau plus rien n’a de sens », a-t-il dit le 24 octobre, ajoutant qu’il faut « faire la preuve du triomphe de la vie sur la fatalité, du triomphe de la force de l’esprit qui nous réunit quand notre condition de mortel se rappelle à nous de manière irrévocable. (…) L’art n’est pas une consolation. L’art est la formulation de Dieu, de manière laïque. Un point sur lequel nous pouvons tous nous retrouver (…) ». Il déclare souhaiter « que le sens qui s’impose à nous comme une soif retrouve sa place dans une société qui oublie qu’elle est mortelle, et donc qui oublie qu’il faut chercher des éléments de sens, même s’ils sont dérisoires, même s’ils sont précaires, même s’ils semblent parfois incapables d’atteindre aux finalités. Peut-être que nous ne pouvons pas atteindre aux finalités, en tous cas pas de manière discursive, c’est certain, et c’est pour ça que l’art est présent. »
Il convient de souligner, pour une fois, le caractère politique de ces propos. Les finalités qu’on ne peut atteindre, c’est précisément celles que désigne, toujours à bon compte, l’idéologie ambiante. Celle-ci nous sert des discours avec lesquels on ne peut jamais être en désaccord, et pour lesquels il nous faut ramer. Dire qu’il est certain qu’on ne peut pas atteindre ces finalités par ces discours (ni à coups de rame), voilà qui donne enfin un peu d’oxygène.
A ces peintures discursives, Py oppose le concret de la vie d’artiste, qui est de chercher des éléments de sens, avec cette méthode tout à fait particulière aux artistes de théâtre qui est de les chercher, ces éléments, sur l’espace d’une scène aux quatre dimensions (le volume d’un théâtre, la durée d’une soirée en présence). Cette recherche, à quoi se résume au fond la création artistique, manifeste la force de l’esprit, la preuve du triomphe de la vie. Ces expressions grandiloquentes ne peuvent être comprises que si l’on se rend à l’évidence qu’une soirée réussie, au théâtre, compte dans une existence au même titre qu’une nuit d’amour réussie. Les trouvailles d’éléments de sens produisent des éléments d’existence, même dérisoires ou précaires, comme une série de sommets, parfois une ligne de crêtes où l’air est vif.
Quant à formuler Dieu de manière laïque (un point sur lequel nous pouvons tous nous retrouver), pourquoi pas, si l’on tient tant que cela à toujours faire valoir des finalités et des abstractions (connaître Dieu, unir l’humanité, s’affranchir des Eglises). Nous vivons et nous mourons, il faut l’avouer, sous le joug d’une emprise idéologique, quelle qu’elle soit. Mais qu’on n’oublie pas que nos recherches, en réalité, ne sont pas sommatives. Les éléments de sens, au contraire, s’éparpillent en multiplicités qu’on ne joint qu’à grand peine par des lignes (les crêtes), dessins sur le sable qu’efface la marée.
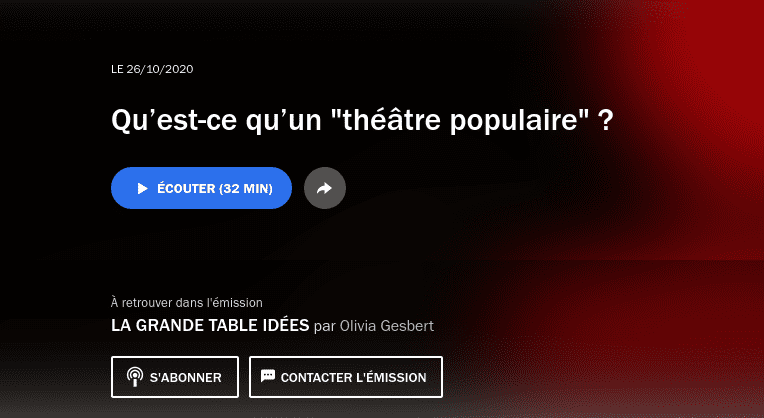
D’où suit un objectif politique clair, qui élève Olivier Py presque au niveau d’un Lénine ou pour le moins d’un Clémenceau : trouver le moyen de lever le rideau. L’heure est grave, finissons les belles paroles, et, comme il le suggère à mots à peine voilés, donnons des leçons de pragmatisme à ces libéraux qui font le désastre du monde. Les moyens sont là, la nouvelle ministre a deux années devant elle et souhaite marquer son passage aux affaires culturelles, des « Etats généraux des festivals » se sont tenus, on parle de nouvelle décentralisation… décidément l’ambiance a changé.
D’une idéologie politique en pleine renaissance
Deux préoccupations politiques d’aujourd’hui semblent faire croire qu’on trouvera le moyen de lever le rideau.
La première : rendre au champ culturel son poids économique dans la société française, parce qu’il la vivifie d’une large activité induite, notamment touristique. « Avec les Etats généraux des festivals, explique Olivier Py au micro de France Culture , nous avons pris conscience que le monde de la culture est créateur de trésors. Et ces trésors peuvent être sonnants et trébuchants. Le libéralisme, s’il est aveugle à cela, se place à l’opposé du pragmatisme. Nous créons de l’économie. À partir de rien, à partir du souffle, du désir, de nos hypothèses, de nos amitiés, nous créons de véritables trésors. Je crois que Roselyne Bachelot l’a très bien compris. »
La seconde : s’occuper de ceux qu’on appelle désormais (trait idéologique s’il en est) « les habitants », c’est-à-dire les individus sociaux répartis sur tout le territoire, qui ne se sentent guère favorisés, qui sont sensibles aux propos populistes, qui se sont engagés pour certains dans le mouvement des gilets jaunes, qui constituent aussi une masse non-négligeable de votants (ou d’abstentionnistes). Sans abandonner la « démocratisation culturelle », qui consiste à faire connaître l’offre culturelle au plus grand nombre, on parle maintenant de développer la « démocratie culturelle », qui consiste à reconnaître et soutenir les pratiques et la créativité artistiques et culturelles déjà présentes et prêtes à se développer chez chacun de ces « habitants ». Le maillage territorial et la souplesse des nombreux festivals en France peut soutenir une telle évolution.
Olivier Py, de vieille école, parle encore de démocratisation : « Or on ne va pas non plus rester là simplement à se légitimer avec des propos qui appartiennent au capitalisme, poursuit-il dans la même émission. On s’en fiche de cette légitimité-là. Ce que nous créons, c’est d’abord du lien social. Et ce n’est pas n’importe quoi. J’entends toujours les gens un peu ricaner lorsqu’on parle de théâtre populaire, mais diable c’est qu’ils ne sont jamais venus dans les salles de théâtre. Ils n’ont jamais compris ce que c’est que le service public de la culture. Ils en sont beaucoup trop éloignés pour voir à quel point sa définition est très simple et vécue par les hommes et les femmes qui le font, et ceux qui l’apprécient. Cette définition, c’est : des trésors spirituels mais financièrement à la portée de tous. »
À quoi Jean Bellorini, metteur en scène et nouveau directeur du TNP de Villeurbanne, invité de la même émission de France Culture, ajoute, en témoignant par là de cette démocratie culturelle qui s’inscrit dans la continuité et l’approfondissement de la simple démocratisation : « On a besoin de ces lieux où l’on se retrouve sans être de la même communauté, on a besoin de minorités rassemblées pour vivre une même expérience artistique et la comprendre différemment en fonction de l’histoire et de la personnalité de chacun. On a besoin de ces lieux qui amènent à l’expression toutes les formes de vie les plus diverses possibles. Aujourd’hui, il s’agit juste d’aller un peu plus loin, de faire mieux et plus. Une assemblée théâtrale est constituée de solitudes. On s’adresse à chaque solitude. Plus elles vont être différentes et plus l’expérience sera riche et partagée. J’aime qu’on s’assoie à côté de quelque inconnu et qu’on partage deux heures d’une vie en projetant et croisant des imaginaires différents. »
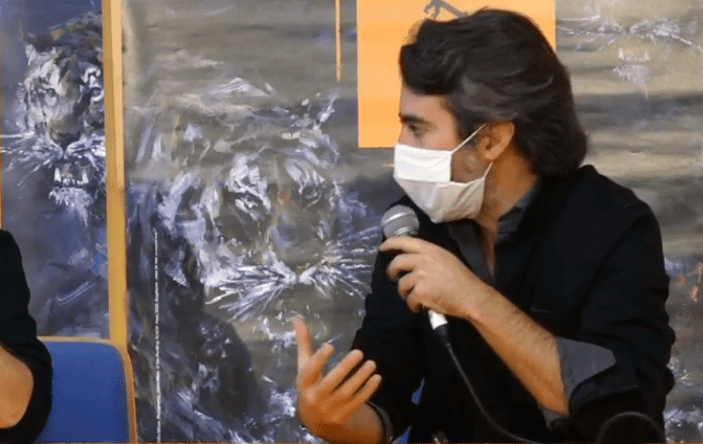
[Jean Bellorini en conférence de presse à la Semaine d'Art, Avignon 2020]
En ce sens, ce pragmatisme et cette démocratie sont destinés, à très court terme, à être les deux messagers idéologiques de la politique culturelle en général et du soutien au théâtre public en particulier. Espérons que ces deux anges donneront la puissance nécessaire aux artistes de lever le rideau et de servir à nouveau, dans les meilleures conditions, la cause de l’art théâtral.

