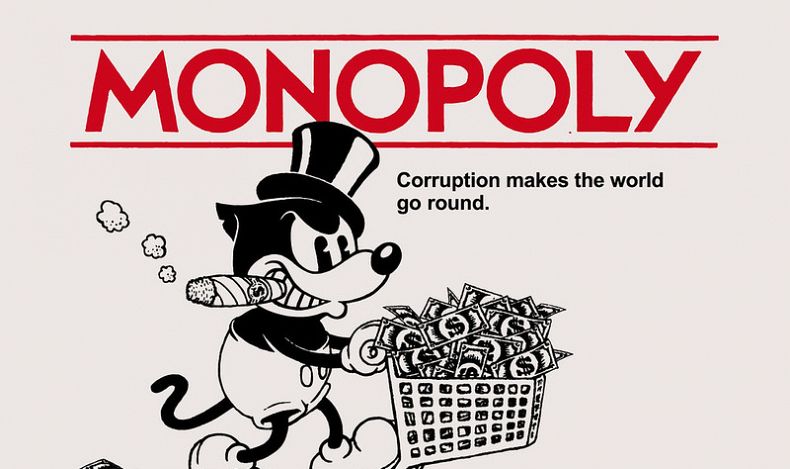Au moyen d'une comparaison entre néolibéralisme et socialisme marxiste, l'économiste Jean-Luc Gréau approfondit sa critique du capitalisme actuel.
Jean-Luc Gréau prolonge dans ce nouvel ouvrage, Le Secret néolibéral (Gallimard, 2020), la critique du capitalisme actuel à laquelle il s'était livré dans ses précédents livres, notamment L'Avenir du capitalisme (Gallimard, 2005) et La Trahison des économistes (Gallimard, 2008). Il reprend dans celui-ci le parallélisme entre néolibéralisme et socialisme qu'il avait inauguré dans un article publié dans la revue Le Débat en 2016, pour lui donner un plus ample développement.
Jean-Luc Gréau a aimablement accepté de présenter son livre pour nos lecteurs en répondant à quelques questions.
Nonfiction : Le néolibéralisme s’est construit contre le marxisme et sa véritable nature s’éclaire lorsqu’on comprend qu’il s’agit d’un « marxisme retourné », expliquez-vous, qui substitue ainsi une prise de pouvoir par une bureaucratie à une autre et une forme d’accumulation sans but à une autre. Pourriez-vous expliciter ce point ? Et préciser peut-être ce qui fonde finalement ces similitudes selon vous ? Et dire en quoi ils se distinguent alors tous les deux par rapport au libéralisme ?
Jean-Luc Gréau : J’ai fait, précisément, une analogie entre le « socialisme historique », d’inspiration marxiste, mais aussi léniniste et stalinienne, et le néolibéralisme. La chose ne va pas de soi, j’en conviens. Comment peut-on en effet placer sur le même plan un système qui tend au tout marché et à la maximisation des profits et un autre qui abolit le marché et les profits ?
Le premier point à retenir est que les bureaucrates néolibéraux s’ingénient à accumuler du capital dans les comptes des banques et des fonds de placement de même que les dirigeants de l’économie soviétique s’évertuaient à accumuler des biens de production. Deux formes d’accumulation sans autre but qu’elle-même. Elles représentent l’une et l’autre un axiome qui, comme tout axiome, ne se discute pas.
Le deuxième point est que l’accumulation néolibérale s’effectue sous le contrôle vigilant d’une bureaucratie financière incarnée par les dizaines de milliers de cadres des banques et des fonds de placement à la surface de la planète. Une bureaucratie qui a pris le pouvoir à la faveur de la crise de l’économie keynésienne devenue manifeste dans les années soixante-dix. Elle a pu imposer ses exigences aux Etats qui, accablés par les déficits, sont devenus tributaires de son crédit, et aux entreprises cotées qu’elles ont pressurées comme jamais auparavant. Les bourses sont devenues un instrument de prédation. J’insiste sur l’anomalie que constituent les rachats d’actions qui décapitalisent les entreprises à seule fin d’engraisser les grands actionnaires. Accumulation sans autre objet qu’elle-même, faut-il le répéter ?
Le troisième point est le caractère unilatéral du pouvoir exercé tant par le Gosplan en régime socialiste que par la bureaucratie financière en régime néolibéral. La sphère productive a des comptes à rendre à la bureaucratie mais la bureaucratie n’a pas de comptes à lui rendre. Le maître a-t-il des comptes à rendre à ses valets ?
Le libre-échange joue un rôle essentiel dans le néolibéralisme. Comment s’articule-t-il aux deux dimensions précédentes, soit la prise de pouvoir par une bureaucratie financière et l’accumulation comptable ? Que doit-on penser de ses effets ? Là encore, en quoi le néolibéralisme se distingue-t-il sur ce point du libéralisme tout court ?
Le libre-échange, certes, mais le libre-échange mondial qui n’a plus rien à voir avec le marché commun européen de l’après-guerre, ni avec les accords bilatéraux entre Etats qui permettaient de maîtriser les échanges.
La bureaucratie financière a joué le rôle crucial pour ce basculement qui n’a pas de précédent dans l’Histoire. Elle a imposé la recherche du plus bas coût du travail quelles qu’en soient les conséquences. On le voit bien à l’occasion de l’épidémie en cours qui a révélé que 80 % des principes actifs des médicaments français avaient été externalisés vers l’Inde ou la Chine. Mais les politiques, pris à revers par les évènements, parlent maintenant, toute honte bue, de « souveraineté ».
Au-delà de l’épreuve sanitaire et de ses effets immédiats, nous devons garder à l’esprit que nous sommes tombés dans la trappe de la désindustrialisation. Des économistes de renom ont justifié la désindustrialisation au nom d’une spécialisation du travail. A nous les tâches de conception, aux ilotes du Tiers Monde les tâches d’exécution. Ce schéma puéril et faux a été imposé aux politiques. Comme si les Chinois, les Indiens, voire les Indonésiens et les Brésiliens étaient incapables de concevoir des produits modernes et innovants !
Le plus étrange, et le plus scandaleux, est que le libre-échange a été imposé alors que les entreprises bénéficiaient de la liberté des investissements directs qui leur permet d’accéder aux grands marchés, comme le Marché Unique européen, en s’installant sur les territoires concernés pour y réaliser leurs productions. Dès lors, le protectionnisme ne ferme pas les marchés, il protège les sites de production. Le libre-échange inconditionnel est le mensonge central de l’expérience néolibérale, l’alibi vertueux de la prédation.
Faute d’un encadrement du libre-échange, nos capacités économiques et notre capacité d’action publique sont érodées par la déflation salariale, qui réduit les revenus disponibles et les ressources fiscales des Etats, tandis que la consommation finale a été soutenue, tant bien que mal, par le surendettement des ménages et des entreprises, un surendettement qui s’est encore aggravé durant la décennie des années 2010.
A l’époque du libéralisme classique, les entreprises restaient fidèles au site de production national. Ricardo le soulignait avec force. Cette fidélité a permis aux syndicats d’obtenir des progressions régulières des salaires et des conditions de travail. Avec l’arme ultime de la grève. Le travail était protégé par le caractère national du capital. Mais comment faire grève en régime de libre-échange planétaire ? Avez-vous vu le secteur privé se mettre en grève lors de l’épisode de la réforme des retraites ?
Cette prise de pouvoir par la bureaucratie financière, la financiarisation et la globalisation ont pris des formes distinctes aux Etats-Unis et en Europe, avec des conséquences différentes au plan politique. Pourriez-vous là encore en dire un mot ?
Deux choses contradictoires. Premièrement, l’Europe a pris le sillage du néolibéralisme anglo-américain à partir du moment où les fonds de placement d’outre-Atlantique ont investi les bourses européennes. Même l’Allemagne a dû concéder aux exigences de la création de valeur pour l’actionnaire. Deuxièmement, elle a surenchéri sur l’Amérique. C’est Jacques Delors, président de la Commission européenne, qui a imposé la libre-circulation des capitaux du monde au sein de l’Europe. C’est la doctrine de la concurrence européenne, élaborée sous sa responsabilité, qui interdit aux pays européens de soutenir de grands projets d’avenir tels qu’Airbus !
On dépeint souvent l’emprise du néolibéralisme comme désormais irréversible, une idée qu’entretient du reste la gravité croissance des crises auxquelles celui-ci est confronté qui nécessitent des mesures d’urgence mobilisant des capitaux de plus en plus énormes. Que répondriez-vous à cela ?
Tout vient du refus du bilan. La propagande incessante qui tombe du ciel des grands médias persuade les masses du bien-fondé de la mondialisation tandis que les managers qui « superforment » le marché, en termes de profits, sont encensés, quels que soient les moyens qu’ils ont utilisés pour ce faire. C’est là un point troublant d’analogie avec le socialisme historique dont le parcours était émaillé par les bilans « globalement positifs ».
A titre d’illustrations européennes, avez-vous vu tirer le bilan de l’agenda de Lisbonne, voté en 2000, au terme duquel l’Europe serait le continent « high tech » du monde en 2010 ? Avez-vous vu tirer le bilan de la monnaie unique entrée en crise en 2010 ?
Nous allons donc de crise en crise. Mais non pas en mobilisant des capitaux, mais la capacité de crédit bancaire. Nous ajoutons le surendettement au surendettement. Jusqu’à l’implosion finale ?