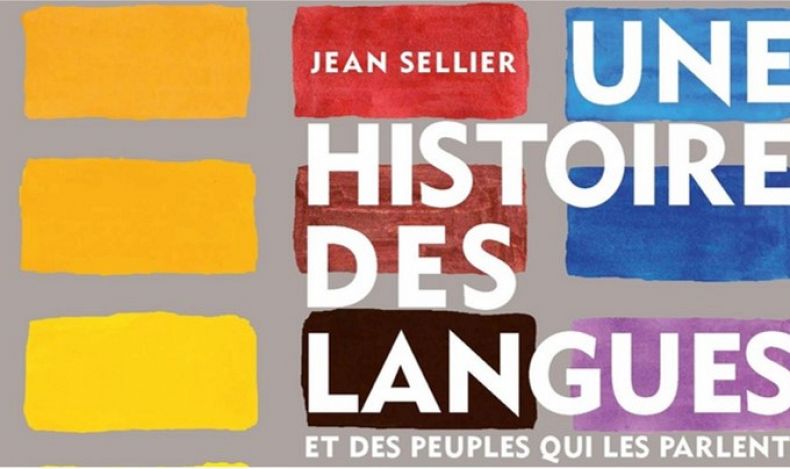Un ouvrage érudit et ambitieux fait la synthèse des liens entre langues, peuples et histoire : une mise au point bienvenue à l’âge des pensées identitaires.
Trop souvent, lorsqu’on cherche des renseignements sur une langue et qu’on ne souhaite pas se contenter de caractéristiques phonétiques, les encyclopédies, les guides linguistiques et les dictionnaires se contentent de nous proposer des informations sur le sens des termes et leur prononciation. En dehors d’une visée d’usage immédiat, cela ne suffit en rien. Afin de bien saisir une langue, il faut amplifier largement la démarche. Il faut s’intéresser à son rapport aux autres langues locales, à son rapport à d’autres langues parfois lointaines par linguistique comparée interposée, à une histoire qui la relie à des branches linguistiques et prouve des parentés parfois inattendues entre langues et peuples, à un contexte culturel et à des difficultés politiques : enseignement de cette langue, écrasement des langues dominantes, stigmatisation de certaines d’entre elles en « patois », relations entre langue-pouvoir et religion… A cet égard, l’ouvrage de Jean Sellier permet de découvrir les rapports complexes de l’empire Sassanide au zoroastrisme, par exemple, mais aussi la question des langues dans l’empire Ottoman, dont l’élite se perçoit comme située à la tête du monde musulman. Ces exemples peuvent encore être confrontés à la manière dont le colonisateur peut apprendre la langue locale et la formaliser pour la première fois, comme il en va du quechua du Pérou. Mais les questions ouvertes sont infinies : elles interrogent encore la manière dont une langue, une écriture et une rhétorique sont valorisées ou imposées, comme c’est le cas en France depuis la Révolution.
Afin de saisir ces dimensions avec toutes leurs conséquences, il convient d’entrecroiser des recherches purement linguistiques (structure des langues, morphologie, syntaxe, vocabulaire), des travaux d’histoire et de sociologie des langues (la langue conçue comme fait social), des enquêtes portant sur la politique des langues, etc. En somme, il faut réunir des compétences multiples.
Aussi ne s’attend-on pas à trouver sous une seule plume un travail aussi large que celui que porte cette histoire des langues et des peuples qui les parlent. C’est pourtant le défi relevé par Jean Sellier – et bien relevé. Ce dernier est historien et géographe, auteur, par ailleurs, d’une série d’Atlas des peuples qu’il est bon de consulter aussi si l’on veut comprendre quelque chose au monde contemporain.
La démarche
La démarche de Sellier est tout à fait claire. Elle consiste à retracer le cheminement des langues dont on peut raconter l’histoire (sur environ 6 000 langues actuellement documentées), en répartissant le commentaire en modules : régions et époques, afin d’examiner des liens, des échanges, des enfermements aussi. Géographiquement, le lecteur peut alors organiser son parcours comme il l’entend, voyageant ainsi des langues européennes aux langues mésopotamiennes, de celles-ci au javanais, persan, swahili, et du bactrien au tagalog, selon une évocation choisie pour solliciter l’esprit des futurs lecteurs. Des cartes et des illustrations retracent l’essentiel des concentrations et passages entre langues : familles de langues, repérages de « dialectes », échanges de systèmes d’écriture, etc. Une bibliographie sélective et des index viennent compléter cette recherche. Évidemment, on peut entrer dans l’ouvrage par des biais différents : une langue connue, une région à explorer, une généalogie à reconstituer, l’histoire d’un peuple à dessiner et à connaître, etc. Antiquité, Europe médiévale, mondes arabe et turco-iranien, Europe centrale et orientale, mondes chinois, japonais et coréen, Afrique au sud du Sahara, etc.
Avec plus de recul, on doit surtout signaler que cet ouvrage est publié au cœur de polémiques idéologiques qu’il met à mal. Chacun a entendu autour de lui se réveiller le lourd héritage, qui n’est pas sans conséquences politiques, de revendications d’une pureté de la langue « nationale », d’identification entre une langue « nationale » et un « caractère national », etc. Ce système de causalité, dont l’histoire est reconstituée dans ce volume, dès lors qu’il est fermé et mécanique, est tout à fait absurde, de même que l’idée d’une langue uniforme et homogène (et que dire de la pluralité des langues berbères, des langues corses, etc. ?). De tels discours justifient pourtant des politiques de la langue qui sont aussi des politiques de l’identité, lesquelles font souffrir bon nombre d’ethnies ou de langues alors dominées (et reléguées au rang de « patois ») par une langue officielle, quand ce ne sont pas les migrants qui s’y trouvent soumis. N’y échappent finalement, pour partie, que les pays plurilingues, dont c’est le génie de conserver, parfois non sans mal, cette richesse linguistique et culturelle. Ou les langues/cultures qui ont réussi à s’imposer au colonisateur : comment expliquer autrement le « gréco-latin » des élites romaines devenues bilingues à partir du IIIe siècle avant notre ère ?
L’examen par l’auteur des notions de « francophonie » ou de « dialecte », entre autres, apportent à cet examen des éléments incontournables, puisque, par exemple dans la francophonie, il convient d’entendre un projet récent (1880, Élisée Reclus), qui demeure traversé par toute la question coloniale. Autant dire que l’ouvrage donne à la notion d’histoire des langues toute sa pertinence et ses dimensions, d’autant qu’elle est rapportée à des peuples qui migrent, font l’objet de transferts, sont soumis à des puissances coloniales et impériales, qui s’en libèrent, dépendent de politiques linguistiques... Et qui connaît bien cette politique du côté des dynasties Parthes ou Sassanides (Perse) ? C’est l’occasion de l’apprendre. Ou qui connaît bien ces empires qui administrent leurs « possessions » en une langue mais ne font pas disparaître pour autant les langues locales (par exemple Alexandre et les Séleucides) ?
Langue et culture
D’une manière ou d’une autre, l’ouvrage – presque une encyclopédie historique – oblige constamment à assouplir ce qu’on dit trop rapidement des rapports entre culture et langue. Si on répertorie brièvement les possibilités, on trouve soit des discours prétendant qu’il n’existe aucun rapport entre langue et culture, soit des propos qui ont de leurs rapports une conception mécanique consistant à affirmer que la langue exerce une action directe sur la culture. A l’inverse, on entend encore, et simultanément, que l’une serait l’origine de l’autre, en conséquence de quoi on pourrait réduire l’une à l’autre, par exemple en affirmant que la langue est un « dépôt » ou un « trésor » ou que la culture incarne la langue d’un peuple.
Les évocations les plus problématiques sont bien sûr celles qui croient pouvoir imposer l’idée de liens substantiels entre langue et culture, figeant, de surcroît, chacune en substance. Or, pas plus que l’auteur ne croit en une homogénéité entre peuple, langue et culture, pas plus il ne patrimonialise une langue ou une culture, en décidant que la langue seule permettrait à un peuple de se souvenir de sa culture, puisqu’elle serait sédimentée dans la langue. Quoi qu’il en soit, la langue est moins « héritage » et « dette » qu’elle n’est une activité vivante grâce à laquelle s’étendent les échanges entre cultures et s’inventent des histoires possibles entre des peuples qui se traduisent les uns les autres.
Très loin de toute vocation à l’identité, la lecture de l’ouvrage aurait donc plutôt tendance à inciter le lecteur à penser la traductibilité des langues, leur interpénétration. Si chaque langue porte en elle la mémoire d’un peuple, alors les langues ne sont pas interchangeables. Elles sont le véhicule d’une tradition qui serait le « bien » d’un peuple et ne pourrait être livré à un autre. La traduction devient ici une menace. Il faudrait donc protéger les langues de cette menace (la langue « maternelle » devrait être protégée de toute souillure, etc.) !
C’est sans doute au linguiste Roman Jakobson que peut revenir le fin mot de l’affaire : « Le langage et la culture s’impliquent réciproquement, le langage doit être conçu comme une partie intégrante de la vie sociale… Quand nous déterminons ce que c’est que le langage, nous devons le comparer aux autres systèmes symboliques. Le système des gestes par exemple… Ce système des gestes offre avec le langage des ressemblances instructives et aussi des différences non moins remarquables » .
Comparaison
Puisqu’on en célèbre les écrits ces temps-ci en Allemagne, on pourrait oser une comparaison entre ce travail de Sellier et celui de Wilhelm von Humboldt (1767-1835) en son temps. Ce dernier partait de la pratique des langues pour passer à l’étude philosophique de la question des langues, puis à la fondation d’une linguistique. Sa volonté de répondre à la question : « Qu’est-ce que l’homme ? » n’est pas exactement celle de Sellier. Encore tous les deux font-ils de la langue la réalité humaine même, à partir de laquelle se construit une histoire qui est celle des communautés linguistiques. Humboldt affirme que : « Les éléments du langage scandent notre représentation qui sans eux serait entraînée dans une confusion sans fin. Ils sont les signes sensibles qui conditionnent le découpage des objets en différentes sphères et au moyen desquels nous concentrons certains domaines de notre pensée en groupes unifiés qui se prêtent à d’autres combinaisons et opérations ». Le trait commun avec Sellier : langue et culture ne sont pas figées, elles impulsent des trajectoires en se constituant en dynamiques de peuples qui se confrontent, se jugent les uns les autres, ou s’inventent des noms pour mieux se mesurer (comme c’est le cas de l’expression « anglo-saxon », due au roi Alfred le Grand, au IXe siècle).
Tous deux reviennent sur ce rapport culture-langue en montrant que la langue n’est pas un simple instrument (la langue n’est pas une masse de signes indifférents dans laquelle on puise pour rien), et que la culture n’est pas « le caractère d’une nation ». Thèse qu’ils peuvent soutenir parce qu’ils ont étudié de près des situations spécifiques : comment la famille de langue tibéto-birmane coexiste avec la langue des Khmers, des Chams, des Thaïs ? Mais aussi les poésies rencontrées, les écrits littéraires et les institutions culturelles à travers lesquelles la réduction de la langue à un instrument de communication est impossible, sinon disposerions-nous de l’Iliade et de l’Odyssée, de la poésie lyrique de Lesbos, du théâtre attique en dialecte d’Athènes et des écrits d’Hérodote en ionien. La culture forme la langue autant qu’elle est formée par elle.
La négligence de la traduction
On remarque en effet que les discours identitaires portant sur la langue ou la culture négligent totalement la question des passages et de la traduction, de sa possibilité et de son efficacité dans les rapports entre les peuples. Poser le problème de la traduction, c’est lutter contre une conception instrumentale de la langue. Si la langue est un instrument neutre, un simple outil, alors il y a indifférence des langues pour l’expression de la pensée. Mais comment expliquer alors qu’une langue comporte des variétés : l’araméen notamment (composé du palmyrénien et du nabatéen), l’allemand (Haut-allemand et Bas-allemand), le Valaque, le Wallon, etc. Les langues peuvent toutes se substituer les unes aux autres. Sans perte. Et perdre une langue devient indifférent. Or, ce que montre Sellier, c’est justement que ce n’est pas indifférent. Et qu’il importe de refuser cette option. Ou qu’il importerait à une langue nationale d’être capable de laisser vivre des langues diversifiées : l’italien dans son rapport au florentin et au milanais, par exemple.
Et effectivement, si la traduction est possible, c’est qu’un travail de conversion peut être entrepris. De toute façon, une traduction ne saurait être une simple transposition. L’effort de traduire n’est pas simple transfert. Il faut donc s’occuper de la forme générale de la langue plutôt que des mots un à un, sur fond d’entente éventuelle entre plusieurs peuples.
Enfin, on ne peut négliger la manière dont la politique, revenons-y, se manifeste dans et par les langues parlées. Les populations principales de tel ou tel pays se présentent aussi par leurs langues. À Djibouti, Somalis et Afars, mais aussi Issas, présents aussi en Éthiopie et au Somaliland, alors que les langues officielles demeurent le français et l’arabe. Mais souvent le pouvoir vise à muer la langue en instrument à son service. Un encadré nous rappelle ce qu’il en fut de la LTI (Lingua Tertii Imperii), la langue du IIIe Reich si bien étudiée par Victor Klemperer (en 1947). Mais on pourrait aussi analyser, grâce aux concepts proposés par cet ouvrage, la langue de la consommation de masse, la langue réduite des SMS et des échanges électroniques.