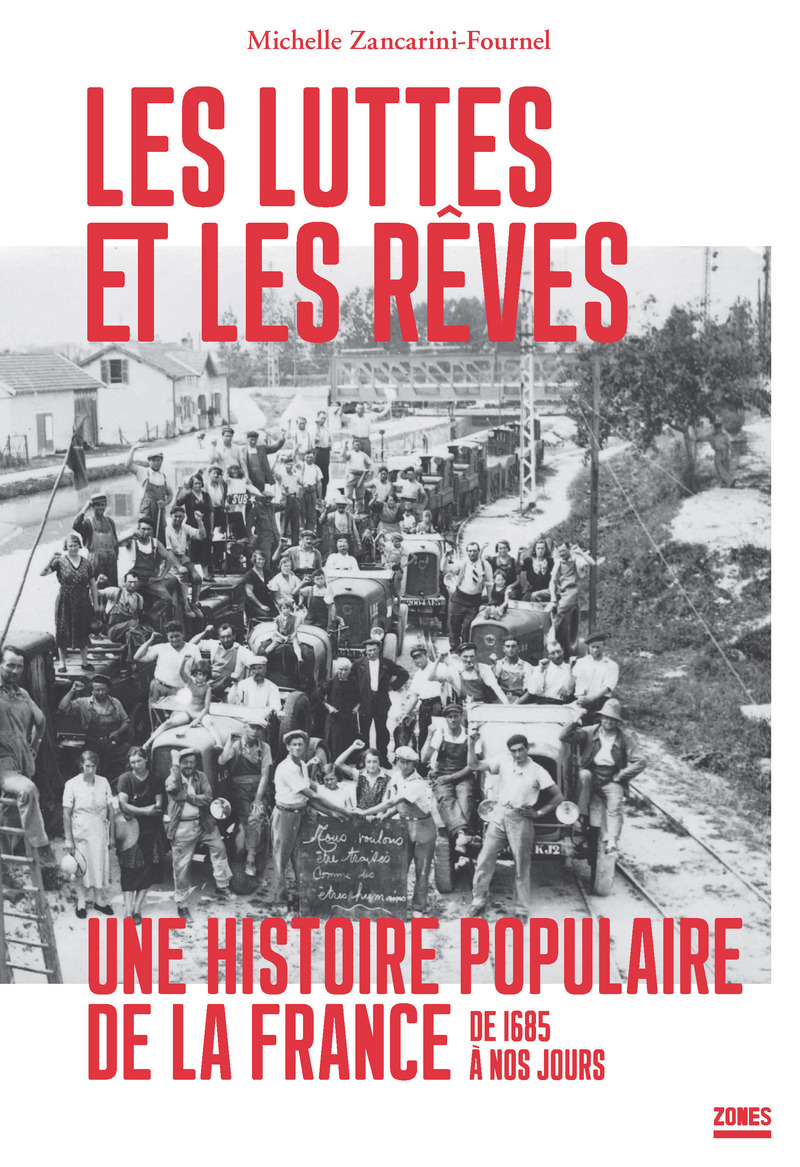Michelle Zancarini-Fournel est professeure émérite à l’Université Lyon-1. Spécialiste d’histoire sociale, notamment de celle des femmes et du genre , et de Mai 68 , elle a publié fin 2016 une magistrale et passionnante « histoire populaire de la France » intitulée Les luttes et les rêves . Elle a accepté de répondre aux questions de Nonfiction et de revenir sur l’originalité et les forces de ce livre marquant.
Nonfiction : L’originalité de votre livre repose d’abord sur ses bornes chronologiques, de 1685 à 2005. Pouvez-vous revenir sur ce choix ?
Michelle Zancarini-Fournel : 1685 est une date significative au mitan du règne de Louis XIV symbole de la monarchie absolue : trois édits royaux concernent à la fois la définition juridique « à la française » de l’esclavage, appelée Code noir qui est aussi une police religieuse ; le deuxième édit interdit aux protestants de pratiquer leur religion et les poursuit violemment ; le troisième enferme les mendiants et les vagabonds et les envoie aux galères en cas de récidive.
2005 est une année- tournant qui pèse sur notre présent immédiat : entre le manifeste des indigènes de la République en janvier, la loi de février qui demande aux professeurs d’enseigner les bienfaits de la colonisation (article 4), les pétitions des historiens refusant cette implication du politique dans les programmes scolaires, et les épisodes des rébellions urbaines en novembre auxquelles le gouvernement oppose l’état d’urgence (loi de 1955 pour l’Algérie) les questions du postcolonial s’imposent ; par ailleurs si le non majoritaire au referendum sur l’Europe l’emporte, le président de la République n’en tient aucun compte, ce qui contribue à délégitimer l’action des politiques.
En introduction, vous citez l’historien britannique E. P. Thompson et votre souhait d’écrire une histoire « par le bas », pari largement tenu. Quelles difficultés jonchaient une telle entreprise ?
Pour ne pas écrire un récit en surplomb, la principale difficulté d’une « histoire par le bas » - du quotidien et des actions de résistance aux contraintes des dominants - est de (re)trouver la voix des subalternes. Dans l’Ancien régime et jusqu’au XIXe siècle, les esclaves, les paysans, les femmes ou les ouvriers s’ils s’expriment oralement par des paroles, des cris, des slogans, de la musique et des chansons et aussi par le corps et la danse ont laissé très peu de traces. On trouve cependant des écrits de protestants qui apprenaient à lire et à écrire grâce à l’étude de la Bible. J’ai traqué les quelques « journaux de raison » et livres de compte de paysans et d’artisans qui permettent de saisir leurs voix et aussi les textes qui concernent ces subalternes (rapports de police, procédures judiciaires en se gardant bien sûr des biais de ces discours officiels). Pour le second XIXe siècle et le XXe siècle, on trouve nombre d’écrits venant des organisations, des motions de congrès et de la presse militante et il était nécessaire de trouver les formes individuelles d’expression.
Les grandes forces de votre livre reposent notamment dans votre traitement de l’histoire des femmes, des colonies ou des DOM-TOM, et de leurs actions de contestations, autrement dit vous vous concentrez sur les objets des « studies » (« gender », « subaltern », « postcolonial »). Avez-vous été explicitement inspirée par ces champs d’étude ?
Je suis spécialiste d’histoire sociale et particulièrement d’histoire des femmes et du genre : j’ai contribué, avec d’autres, au sein de la revue CLIO Femmes Genre Histoire (née en 1995) à faire connaître ce champ de recherches. J’ai défriché également la question postcoloniale en cherchant par la généalogie des rebellions urbaines dans la région lyonnaise (plus précoces qu’on ne l’écrit habituellement) les traces de la Guerre d’Algérie dans la société française. J’ai également travaillé sur l’histoire des Antilles par le biais d’une commission ministérielle. Par ailleurs, en étudiant la diffusion des thèses de Thompson, j’ai abordé les productions des historiens subalternes en Inde à partir de 1981-1982. Enfin, l’approfondissement des thèses de Gramsci dans Les Cahiers de prison, m’a permis de comprendre la notion de « subalternes » soumis à une domination à la fois politique et sociale. La publication d’un certain nombre d’articles jalonne cette quête à la fois historiographique et épistémologique et peuvent rendre compte de la manière dont ma réflexion s’est forgée.

Vous proposez, à l’échelle de la France et des territoires qu’elle a colonisés, une histoire des dominés et de leurs luttes. Vous faites également le choix de ne pas revenir sur la narration de certains événements connus ; n’y-a-t-il pas le risque de déformer la perspective historique en voulant la rééquilibrer ? Par exemple, en vous écartant parfois du politique et de l’histoire par « le haut », vous ne revenez pas sur l’obtention du droit de vote des femmes à l’issue de la Seconde Guerre mondiale.
À l’échelle de la masse des récits qui ne parlent que des règnes, des régimes politiques et des hommes célèbres, ma contribution qui entend changer le point de vue est bien modeste. Je ne crois pas m’être écartée du politique, j’ai simplement une autre définition du politique qui ne passe pas seulement par les gouvernements et les élections. J’ai insisté sur les combats menés par les féministes depuis les débuts de la Troisième République pour le droit de vote et d’éligibilité des femmes que ce soit les suffragettes par l’action (faiblement) violente, telle Hubertine Auclert ou Madeleine Pelletier et les suffragistes par les actions classiques de pétitions et de manifestations, comme celles des militantes qui se sont inscrites comme candidates malgré l’illégalité de leur démarche. Ceci permet de nuancer l’affirmation courante selon laquelle « c’est le général de gaulle qui a accordé le droit de vote aux femmes » en 1944, même si je signale rapidement que c’est bien lui qui a signé l’ordonnance sur l’organisation des pouvoirs à la Libération actant ainsi ces droits revendiqués depuis des décennies par les féministes.
Au fil des siècles, on a l’impression d’une baisse de la violence des conflits dans le contexte français, le faible nombre de morts lors de Mai 68 en étant un exemple frappant. Comment l’expliquez-vous ?
La question de la baisse de la violence est complexe, car si l’on prend en compte les deux guerres mondiales et les massacres coloniaux de l’après 1945 (Sétif et Guelma, Dakar, Madagascar, Algérie et Paris en 1961 et 1962, Djibouti, Antilles) on peut difficilement parler de baisse absolue de la violence. Si l’on compare avec les massacres de la Commune, il est sûr que l’intensité de la violence en un temps réduit a baissé ; mais on tire encore après 1945 sur des manifestants parisiens, provinciaux et coloniaux. Les sept morts directs pendant les événements de Mai-Juin 1968 (qui effectivement paraissent peu nombreux en regard de la répression à Mexico la même année) sont le plus souvent occultés pour faire passer l’interprétation d’un mouvement étudiant hédoniste.
Il est vrai cependant que les interventions des différents corps des forces de l’ordre ont été encadrées par les différents gouvernements et que dans le second XXe siècle, sauf exception des colonisés, la violence mortelle a été réduite aux cas dits de « légitime défense » (Montredon-Corbières 1974, Aléria et Bastia 1975 par exemple) ou à l’emploi non maîtrisé par les forces de l’ordre de grenades offensives ou de taser.

Ouvrage d’histoire sociale par excellence, votre livre ne traite qu’à la marge de la culture. Pouvez-vous revenir néanmoins sur son rôle dans l’histoire de ces luttes ?
La culture imprègne le social (et inversement) et tout dépend bien sûr de la définition que l’on donne de la culture. Dans Les luttes et les rêves j’ai essayé de signaler des pratiques culturelles populaires (les fêtes de village au son du violon, les danses et les occupations dans les cafés en Algérie, les chants et les transes des esclaves et de leurs descendants à la Réunion, les chants de grèves ou de manifestations).
À défaut de pouvoir joindre au récit des illustrations, je me suis appuyée sur des descriptions et analyses de tableaux (celui du premier député de couleur – J.B. Bellet - par Girodet en 1797), de photographies ou encore sur le contenu de quelques scènes de cinéma ou d’émissions de télévision. J’ai aussi parfois signalé un roman qui me paraissait indispensable pour comprendre une situation, tel Des Hommes de Mauvignier (2009) sur les traces de la Guerre d’Algérie dans la société française très contemporaine.
Les images, en particulier au XXe siècle, jouent un rôle fondamental dans le façonnement des mémoires historiques (cf. le rôle des photographies dans l’analyse des grèves du Front populaire) et pèsent sur les événements (rôle du reportage dans le JT sur la première usine occupée – Sud Aviation Nantes - le 14 mai 1968).
A la lecture de votre livre, l’on est parfois partagé entre effroi et espoir ; avez-vous éprouvé les mêmes sentiments lors de son écriture ? Comment avez-vous pu conserver une forme de distance par rapport à des combats qui, pour certains (égalité homme-femme, antiracisme ou luttes sociales), se prolongent encore aujourd’hui ?
L’espoir et l’effroi rendent bien compte des sentiments que l’on peut éprouver à la lecture (et à l’écriture !) de ce livre. L’effroi devant les défaites successives et les violences y compris au sein-même des milieux populaires. Mais l’espoir des utopies concrètes et des résistances - ouvertes ou cachées - à n’importe quelle situation de domination, y compris les pires (je pense aux esclaves enchaînés sur les bateaux négriers ou confinés dans les habitations). C’est grâce à la connaissance du passé que l’on peut envisager le champ des possibles pour l’avenir et garder un peu d’espoir (point de vue difficilement audible dans la situation présente)
Michelle Zancarini-Fournel, Les luttes et les rêves. Une histoire populaire de la France de 1685 à nos jours, coll. « Zones », La Découverte, 1008 p., 28 €.