Le nazisme n’est pas seulement une horreur : c’est aussi une pensée (délirante) de la culture allemande dans sa globalité, et une entreprise de retour à l’âge d’or (fantasmé) de la « race » formée par cette culture. Une « révolution culturelle », donc.
Avec La révolution culturelle nazie (Gallimard, 2017), l’historien Johann Chapoutot ponctue le cycle de ses recherches dédiées à la compréhension de cette machinerie intellectuelle dévastatrice, et qui ont déjà donné lieu à deux publications majeures : Le nazisme et l’Antiquité (PUF, 2008), et La Loi du Sang : penser et agir en nazi (2014).
Dans la première partie de cet entretien, il revient sur les usages de la science – histoire, philosophie, biologie, médecine… – convoqués par les penseurs du nazisme à la faveur d’un nouveau système normatif. Dans une seconde partie, il évoquera l’imprégnation de cette idéologie dans la société allemande de l’époque, sa postérité, et les enjeux de son étude de nos jours.
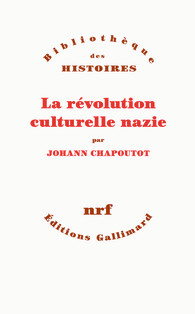

HISTOIRE : LES MYTHOLOGIES HISTORIQUES DU NAZISME
Dans La Révolution culturelle nazie, vous revenez d’abord sur un fait étudié à fond dans Le nazisme et l’Antiquité, qui est que les penseurs du nazisme entretiennent une fascination surprenante, au premier abord, pour la Grèce ancienne : elle est à la fois un idéal, et le lieu d’une origine perdue. Qu’est-ce qui explique précisément la place et la fonction de cette « Grèce antique » dans l’idéologie nazie ?
Le nazisme, c’est une affabulation : c’est la construction d’une fable, d’un récit qui vient récrire l’histoire. Dans ce récit, l’Antiquité méditerranéenne joue effectivement un rôle particulier. En Allemagne, depuis la Renaissance, elle est l’objet à la fois d’une fascination et d’un complexe réactivés au XIXe siècle, qui donne lieu à une volonté de réappropriation. Cet effort concerne surtout le monde grec, puisque l’Antiquité romaine est préemptée par le voisin gallo-romain, chrétien et latin, c’est-à-dire français. Les nazis sont donc les héritiers de cette volonté d’annexer l’Antiquité grecque, qui doit servir à redorer le blason de la « race germanique » nordique – qui sinon a peu de réalisations culturelles à faire valoir, faute d’avoir laissé des traces architecturales nombreuses ou d’autres témoignages. Il faut aussi souligner le rôle personnel d’Hitler dans cette opération, puisqu’il est un admirateur avoué de l’Antiquité grecque, mais aussi romaine.
Dans le discours des idéologues nazis, l’histoire grecque se présente aussi comme une histoire archaïque de la culture germanique : comment définir ce lien de « filiation » que les nazis se reconnaissent avec le monde grec, mais aussi romain ?
La fable nazie sert à produire des normes : dans ce sens, la partie de cette fable qui concerne le monde grec consiste à dire que le peuple grec archaïque est composé de tribus issues du nord de l’Allemagne et du sud de la Scandinavie, qui ont migré vers les cieux plus cléments du sud, où elles ont pu développer leur génie racial. Là, elles ont pu fonder des civilisations prestigieuses : la civilisation grecque, mais aussi la civilisation romaine – puisque les Romains des origines sont également censés être des Germains. Les nazis n’inventent pas cette réécriture absolument fantasmée de l’histoire – et en général, ils inventent beaucoup moins de choses qu’ils n’en recyclent. Cette idée d’une origine nordique ou vaguement septentrionale des civilisations grecque et romaine vient bien du XIXe siècle.
La puissance de ce fantasme de civilisations grecque et romaine « germaniques » réside aussi dans leur crépuscule : à ce sujet, les nazis nourrissent une charge parfois extrêmement virulente contre le rôle joué par le christianisme dans ces effondrements, et contre l’essence même de cette religion. Comment peut-on comprendre la virulence du discours nazi anti-chrétien, qu’on connaît moins que son antisémitisme structurant ?
 Dans cette fable, le christianisme joue le rôle d’une arme dans le complot juif contre la race germanique. L’idée de départ est que dans un temps originel fantasmé, le monde était dominé par une race germanique qui avait organisé ses relations avec les autres peuples sur le mode raciste et hiérarchique : les Germains, dominant le monde, avaient asservi les autres races, réduites à l’état d’auxiliaires ou d’esclaves. Le modèle le plus achevé étant celui de Sparte, où une petite élite raciale et guerrière, celle des « homoioi » toujours menacés par la difficulté à assurer leur prééminence démographique, auraient exercé une domination sur des populations bien plus nombreuses : d’un côté la masse servile des hilotes, de l’autre la masse des périèques sans droits civiques, réduits au rôle de producteurs destinés à nourrir l’élite guerrière. Cette vision du monde est également transposée dans la lecture nazie de l’Antiquité romaine, où la hiérarchisation biologique prend la forme de la domination des patriciens sur les plébéiens et sur le reste des populations de l’Empire. Dans les productions nazies, on apprend que les soulèvements contre l’élite guerrière germanique, qu’ils aient pris la forme de révoltes, de guerres civiles ou de guerres externes – la Perse contre la Grèce, la Carthage « sémitique » contre la Rome « germanique » – se sont toujours soldés par des victoires germaniques, jusqu’à l’invention du complot judéo-chrétien. Dans la vision de l’histoire que fantasment les idéologues nazis, les Juifs, qui haïssent les maîtres germains depuis la plus haute Antiquité, se réfugient finalement dans le demi-jour interlope du complot en créant le christianisme, une doctrine universaliste et égalitariste, qui va à l’encontre de la hiérarchie et du racisme, dans le but de subvertir l’ordre vertical, organisé et organique, des Germains. Le christianisme vient détruire l’Empire romain à la manière des chrétiens de Rome qui creusent leurs catacombes dans le sol de la ville : il mine l’Empire par des trous de taupes qui font s’effondrer la cité romaine et ses structures, ses temples et monuments.
Dans cette fable, le christianisme joue le rôle d’une arme dans le complot juif contre la race germanique. L’idée de départ est que dans un temps originel fantasmé, le monde était dominé par une race germanique qui avait organisé ses relations avec les autres peuples sur le mode raciste et hiérarchique : les Germains, dominant le monde, avaient asservi les autres races, réduites à l’état d’auxiliaires ou d’esclaves. Le modèle le plus achevé étant celui de Sparte, où une petite élite raciale et guerrière, celle des « homoioi » toujours menacés par la difficulté à assurer leur prééminence démographique, auraient exercé une domination sur des populations bien plus nombreuses : d’un côté la masse servile des hilotes, de l’autre la masse des périèques sans droits civiques, réduits au rôle de producteurs destinés à nourrir l’élite guerrière. Cette vision du monde est également transposée dans la lecture nazie de l’Antiquité romaine, où la hiérarchisation biologique prend la forme de la domination des patriciens sur les plébéiens et sur le reste des populations de l’Empire. Dans les productions nazies, on apprend que les soulèvements contre l’élite guerrière germanique, qu’ils aient pris la forme de révoltes, de guerres civiles ou de guerres externes – la Perse contre la Grèce, la Carthage « sémitique » contre la Rome « germanique » – se sont toujours soldés par des victoires germaniques, jusqu’à l’invention du complot judéo-chrétien. Dans la vision de l’histoire que fantasment les idéologues nazis, les Juifs, qui haïssent les maîtres germains depuis la plus haute Antiquité, se réfugient finalement dans le demi-jour interlope du complot en créant le christianisme, une doctrine universaliste et égalitariste, qui va à l’encontre de la hiérarchie et du racisme, dans le but de subvertir l’ordre vertical, organisé et organique, des Germains. Le christianisme vient détruire l’Empire romain à la manière des chrétiens de Rome qui creusent leurs catacombes dans le sol de la ville : il mine l’Empire par des trous de taupes qui font s’effondrer la cité romaine et ses structures, ses temples et monuments.
On voit à quel point le récit nazi est fondamentalement anhistorique : le complot chrétien, c’est-à-dire judéo-chrétien, est qualifié, dans certains manuels scolaires ou dans certains fascicule de formation, de complot « christo-bolchevique ». Ce qui revient à dire que le communisme serait l’équivalent du complot chrétien dans l’Antiquité – puisqu’on y retrouve la doctrine universaliste et égalitariste du christianisme des origines. Pour les nazis, il n’y a donc pas d’histoire : tout est dans tout, et tout se répète. Le Germain éternel fait face au « Juif éternel » – d’où le titre du célèbre film –, lequel utilise les mêmes moyens, sous les oripeaux du christianisme ou ceux du communisme en fonction de l’époque.
Ce caractère anhistorique se manifeste éloquemment dans le discours nazi sur l’Empire romain, qui est à la fois un modèle pour le Reich et la réalisation d’une époque jugée déjà décadente. Comment rendre compte de l’ambiguïté du statut de Rome dans le mythe nazi ?
Le souvenir de l’Empire romain est effectivement un souvenir glorieux, qui permet d’offrir à la fois un modèle d’émulation, un principe d’organisation politique, et une fin historique au Reich qui est en train de se constituer. Par ailleurs, l’Empire romain c’est aussi la pax romana et la liberté de circulation dans tout l’Empire, donc la porte ouverte aux mélanges de populations, c’est-à-dire, en langage nazi, aux « mélanges raciaux ». A la lumière de cet exemple romain, l’enjeu pour les nazis est donc de trouver une forme d’organisation qui ne favorise pas les mélanges biologiques fatals à l’Empire romain. Cela apparaît bien dans les discours sur César – comme du reste sur Alexandre – qui sont présentés comme des Janus à double-face : d’un coté, on exalte leur caractère germanique et conquérant, de l’autre on critique ceux qui ont permis l’homogénéisation de l’œcoumène, c’est-à-dire du monde. Dans la référence à l’Empire romain, il y a donc toujours un versant d’exaltation et d’émulation – il faut par exemple construire des routes comme lors des conquêtes romaines –, mais aussi un rappel du fait qu’il faut veiller à ce que les populations conquises et soumises soient tenues à bonne distance et à l’écart de la population des seigneurs et des conquérants. C’est ce que l’on peut lire dans toute la production culturelle nazie, jusque dans la production normative – décrets, consignes, ordres du jour… Les propos d’Hitler justifient le rapport aux vaincus par cet argument qu’il faut à tout prix éviter d’armer les populations étrangères, de faire des alliances sous la forme de « foedera » – ce système qui permettait aux Romains de faire garder le limes, la frontière, par des populations non-romaines. Le souvenir que l’on garde de l’Empire romain, c’est donc l’impérialité sous la forme de la domination et des signes de la domination – la construction d’une nouvelle capitale baptisée Germania, de monuments prestigieux… – mais aussi les leçons supposées de l’histoire invitant à ne pas reproduire des erreurs commises par les Romains – par négligence, mais aussi par absence des savoirs « biologiques » grâce auxquels les nazis se sentent mieux armés.
PHILOSOPHIE : ENNEMIS ET AMIS
Dans le domaine philosophique également, le nazisme entretient un rapport à la fois fort et ambigu avec Platon – puisqu’on va parfois jusqu’à présenter Hitler comme un « nouveau Platon », mais sans rien dire ou presque du philosophe des incertitudes qui s’exprime dans les dialogues socratiques. Quel est la valeur et l’intérêt de Platon dans le système de pensée nazi ?
En travaillant sur l’utilisation de l’Antiquité par les nazis, j’ai effectivement pu constater que la référence à Platon est chez eux très courante, et que les années 30 donnent lieux à de nombreux travaux sur sa pensée – ce qui du reste n’est pas surprenant, puisque la vitesse acquise des travaux universitaires invitait à poursuivre l’intérêt pour Platon nourri par le XIXe siècle. Mais cet investissement nazi de Platon est aussi ce qui explique la réaction violemment anti-platonicienne d’un Karl Popper, par exemple, qui à partir de 1938 entame la rédaction de La société ouverte et ses ennemis, où il produit un véritable réquisitoire contre Platon. Mais ce Platon vilipendé par Popper, c’est le Platon nazifié des années 30. De fait, il y a un fort intérêt pour Platon parmi les nazis – bien moins pour Nietzsche, qu’on désigne pourtant souvent comme le philosophe phare du IIIe Reich, mais dont l’anti-nationalisme et l’anti-antisémitisme sont tels qu’ils le rendent en fait inutilisable par les nazis.
Pour comprendre cet intérêt, il faut distinguer le Platon de la métaphysique et des idées – qui n’intéresse pas forcément les nazis – du Platon de la République et des Lois : le Platon « nomothète », édificateur de lois et de cités. Celui-là leur apparaît comme le penseur de la distinction des races et de la hiérarchie raciale. C’est une vision fantasmée, mais une lecture foncièrement littérale de la métaphore des « trois races » dans la République – qui distingue la race de bronze, la race d’argent et la race d’or –, ou de celle des « philosophes rois », permet de penser une caste établie par des déterminants biologiques. Cette lecture à la lettre permet donc d’annexer Platon à une vision du monde nazie racialisée. Par ailleurs, en tant qu’admirateur de Sparte et contempteur d’Athènes – de sa démocratie, de l’égalité devant la loi, de l’accès de tous à la liberté de parole – Platon apparaît comme le penseur de la hiérarchie germanique contre la grande confusion démocratique.
Enfin le prestige lié à son nom et à son œuvre participe pleinement de ce projet de ré-instituer la race germanique comme une race productrice de culture. Les Germains ne sont pas seulement des pithécanthropes s’exprimant par borborygmes et vivant au fond des forêts : ils peuvent revendiquer la paternité du grand Platon.
A vous lire, on comprend aussi que ce qui rend Nietzsche inutilisable par les nazis, à rebours de la vulgate communément admise sur le sujet, c’est que le nazisme est à la recherche de tout le contraire de « l’homme nouveau » : qu’est-ce à dire ?
Effectivement on entend souvent dire que le nazisme est une idéologie – pour ma part je préfère « parler de vision du monde » ou de « culture » – qui vise créer un « l’homme nouveau », ce qui serait un point de comparaison avec le fascisme italien ou avec le stalinisme soviétique. Or lorsque l’on se penche plus sérieusement sur les sources nazies – les médecins, les raciologues, les juristes, les historiens, les philosophes ou les idéologues producteurs de cette « vision du monde » au sein du parti et de l’Etat – on se rend compte que le projet est plutôt de recréer l’homme archaïque. L’archétype nazi n’est donc pas une projection vers un avenir, mais plutôt une rétrojection vers l’archaïque. Il s’agit pour eux de retrouver l’homme ancien recouvert et oublié par des siècles d’aliénation culturelle et physique : aliénation culturelle qui a produit de la décadence, et aliénation physique qui a produit de la dégénérescence. L’aliénation culturelle, c’est typiquement l’évangélisation chrétienne, c’est-à-dire judéo-chrétienne, l’introduction de l’idéologie des Lumières, du libéralisme, la Révolution française… La dégénérescence, ce sont les mélanges raciaux qui abîment la qualité du patrimoine génétique germanique. Contre tous ces mouvements de l’histoire, qui peuvent être amendés, il s’agit de retrouver le noyau archaïque de la race germanique grâce à ses éléments les plus sains : grâce à une opération de rééducation, et grâce à une opération de zootechnique pour ce qui est de la récupération du bon patrimoine biologique. Dès lors, le but n’est pas la projection vers la modernité ou la nouveauté, mais de retrouver l’archaïque. D’où ces métaphores constantes de l’« exhumation », de l’« archéologie », de la « source » : face au recouvrement, à l’oubli, il s’agit de retrouver ce qui a été recouvert sous le sédiment des siècles.
Kant est un autre philosophe que l’on regarde souvent comme le formulateur de conceptions par la suite reprises à leur compte par les nazis. Or vous démontrez, là encore, le caractère fondamentalement dévoyé de l’usage qu’ils en font. Quel est le ressort de cette instrumentalisation ?
Kant pose un énorme problème aux nazis, car dans la grande galerie des esprits germaniques, c’est une figure incontournable. Il a son buste au Walhalla – ce temple néoclassique construit à l’image du Parthénon au XIXe siècle sur les bords du Danube. D’ailleurs lorsque des documentaires sont tournés, dans les années 30, sur la germanité de l’Est et sur la Prusse orientale, donc sur la ville de Königsberg, Kant en est évidemment le monument. Mais ce caractère inévitable sur un plan muséal relève véritablement du Bilderbuch, du livre pour enfant. Car lorsqu’on se concentre sur la lecture de ses textes, on comprend vite qu’il est absolument inutilisable pour la doxa nazie. Même si, à bien des égards, il est un homme de son temps (sensible à la raciolgie, à la théorie des climats…), Kant est un universaliste partisan du cosmopolitisme et d’une République universelle, c’est un partisan des droits de l’homme, etc.
Inutilisable, et incontournable : pour résoudre la contradiction, il est utilisé à titre de monument ; mais on reprend aussi certains éléments, non pas de sa pensée, mais de sa formulation. L’un d’entre eux, c’est l’impératif catégorique, qu’Eichmann invoquera lors de son procès. Sous le IIIe Reich, il est utilisé à titre de formule quasiment catéchétique, de la même manière qu’on utilise la forme du Décalogue chrétien – sa sonorité – pour énoncer des commandements allant à rebours des commandements bibliques. Une des formulations de l’impératif catégoriques de Kant est : « Agis toujours de telle sorte que la maxime de ton action puisse être toujours érigée en maxime universelle ». C’est-à-dire que lorsque je me pose la question de faire quelque-chose, je dois toujours vouloir que tout le monde, tout le temps, fasse la même chose : si je peux vouloir cela, alors mon action est morale et je peux la faire. Donc je ne peux pas voler, tuer, etc. car je ne peux pas vouloir que tout le monde le fasse tout le temps, en tout lieu. Chez Kant, il est donc très clair que le ressort de la morale, c’est l’universalisation de la maxime de l’action, corollaire de l’universalité de la raison. Chez les nazis, cela devient cependant quelque-chose de radicalement différent. Une des formulations de l’impératif nazi, c’est : « Agis toujours de telle sorte que, si le Führer avait connaissance de ton action, il l’approuverait ». De l’autonomie de la pensée, on passe à l’hétéronomie – l’action « morale » découle désormais du regard de l’autre – et par ailleurs, le Führer étant le chef de la nation allemande, on passe d’une exigence universaliste à une exigence essentiellement particulariste ; car le Führer ne peut approuver mon action que si elle est bonne pour le peuple allemand. La formule kantienne est ainsi vidée de son contenu, pour lui faire dire le contraire absolu de ce que Kant voulait dire. Ce faisant on fait deux choses : on sert la morale nazie en lui donnant une structure et une formule, et on se sert de la force de l’héritage kantien comme d’un levier pour promouvoir l’idéologie nazie.
Cette subversion de l’impératif kantien, dites-vous dans votre livre, se fait au moyen des possibilités d’interprétation du mot allemand employé par Kant pour désigner le groupe humain : allgemein.
Il y a effectivement une ambiguïté possible sur le terme allgemein, puisque ce que l’on traduit en « loi universelle » (allgemeines Gesetz) renvoie chez Kant à la totalité de l’humanité, des êtres dotés de raison et accessibles à la rationalité mathématique et morale. Or chez les nazis, allgemein est renvoyé à la Gemeinschaft, à la communauté – raciale, organique – du Volk allemand. C’est ce qui permet à certain exégètes nazis d’affirmer, en toute mauvaise foi, que Kant est le penseur non pas de l’universalisme, mais du particularisme racial.
LA « NATURE » ALLEMANDE : ANTHROPOLOGIE & NORMATIVITE
La pensée nazie est d’autant plus difficile à appréhender par un lectorat francophone qu’elle est structurée par des notions – Rasse, Volk, Boden… – intraduisibles. Quels sont alors – puisqu’on pense en langue et en l’occurrence dans un allemand nazi qui n’est plus l’allemand du présent – ces principes directeurs ?
On pourrait faire un lexique des termes qui structurent la « vision du monde » (Weltanschauung) nazie, dans lequel il faudrait déjà placer ce terme même de « vision du monde », qui n’est pas nazi à l’origine, mais qui leur permet de se vanter de voir le monde d’une manière nouvelle par rapport aux Germains des siècles passés. Si les Germains du passé ont été les victimes de l’histoire, c’est parce qu’ils n’avaient pas « vu » d’où venait le mal, comment fonctionnait le monde, etc. Au contraire, les nazis se targuent d’avoir adapté leur vision du monde à la révolution scientifique du XIXe siècle issue des sciences du vivant – médecine, biologie, zoologie, éthologie, etc. De là découle un réinvestissement du sens des mots à la lumière de cette vision du monde : la « race », le « peuple » au sens d’entité organique et biologique (c’est un corps), le « sang », le « sol » qui est la matrice de ce sang, la « communauté » par opposition à la « société » théorisée par Rousseau et la Révolution française. La notion de « performance » est également très importante, puisque chaque membre de la communauté n’a droit à son soutien qu’à proportion de sa performance et de ce qu’il lui apporte. Toutes ces notions cardinales de la pensée nazie, que j’explique terme à terme dans un chapitre de La Révolution culturelle nazie, sont orientées vers la biologie.
La première conséquence de cette Weltanschauung, c’est un refus, dites-vous, du droit international et du droit interne. Qu’est-ce qui est précisément refusé, et pourquoi ?
A ce sujet, les nazis prolongent une tradition qui leur préexiste largement et dont ils sont les héritiers. Olivier Jouanjan a très bien montré que des débats sur le type de droit adéquat à la nation allemande en construction animent le milieu des juristes allemands au XIXe siècle : doit-on adopter un droit germanique, adouber le droit romain latin, ou hybrider les deux ? Dans le point n° 19 du programme en 25 points publié par le parti nazi en 1920, qui exige un retour à un droit germanique, on voit bien que cette position hérite de ces débats. Cette exigence, à laquelle je consacre un chapitre, est formulée un an après le traité de Versailles de 1919, qui instaure un droit international : ce nouveau droit est gagé par l’existence de la Société des nations, que les nazis refusent absolument – et en cela ils ne sont pas les seuls. Ce qu’ils refusent plus généralement, c’est un droit international mais aussi interne d’importation étrangère. En droit interne, c’est un code civil d’inspiration française, venu dans les fourgons des armées de la Révolution et de l’Empire, puis consacré en 1900 par la proclamation du Code civil allemand (bürgerliches Gesetzbuch). De la même manière qu’ils refusent le mélange du point de vue biologique, les nazis refusent le mélange de la culture et donc du droit.
En droit international, ils refusent tout droit qui prétendrait assujettir l’Allemagne à une norme commune à tous les Etats, quelles que soient leurs valeurs culturelles, et donc quelle que soit leur « valeur raciale ». Pour les nazis, il n’est pas question que l’Allemagne obtempère à des normes qui vaudraient aussi bien pour l’Ethiopie, les Etats-Unis, le Costa-Rica et la Russie. Ce refus est donc celui de l’extranéité du droit international : de son caractère étranger et égalitariste.
Au fondement de ce rejet, il y a l’idée que ces droits-là sont la création de races inférieures, qui par l’artefact de l’encre et du paragraphe juridique, ont créé une égalité entre les nations qui n’existe pas dans la nature. Or la seule légalité qui existe, c’est celle de la nature : la « légalité » naturelle contredit « l’égalité », artificielle et néfaste, inventée par les inférieurs pour nier la nature et se hisser au niveau des supérieurs. Ce rejet s’inscrit donc en parfaite continuité avec le rejet de saint Paul – qui proclame l’absence de différence entre les femmes et les hommes, les citoyens et les étrangers… –, de la Renaissance et des Lumières, bref de chaque étape de l’histoire ou la lie raciale de l’humanité a tenté de prouver son égalité par des normes fausses.
Si les nazis rejettent le droit occidental d’inspiration romaine, quel droit alternatif promeuvent-ils, si ce n’est la loi du plus fort ?
A ce sujet, il faut d’abord élargir la focale, et plutôt que de parler seulement de « droit » au sens strict, parler de « normativité » et de « culture normative » : ce qui englobe à la fois le droit et la morale. Pour les nazis, la norme morale et juridique n’est plus universaliste – ce qui serait néfaste à la race supérieure – mais particulariste. Elle trouve sa définition la plus claire dans plusieurs propos du juriste Hans Frank, qui est avocat du parti nazi dans les années 20, puis Führer de la corporation des juristes en 1933, et gouverneur d’une partie de la Pologne occupée en 1939. Lors d’un discours de 1933, il dit : « Le droit (ou « ce qui est juste »), c’est ce qui sert le peuple allemand ». Le droit et la morale sont confondus, et tout acte ou toute pensée qui vise à l’accroissement ou à la préservation du sang allemand est juste. Cette définition recèle un pouvoir de légitimation infini : lorsqu’un membre de la SS doit abattre un enfant sur le bord d’une fosse commune, parce qu’on lui a dit (et qu’il pense) qu’une fois adulte, cet enfant dévastera l’Allemagne. Il n’accomplit plus un acte criminel, mais un acte juste, car il déracine la souche juive qui menace le peuple allemand.
Quelles sont les implications de ce droit à l’intérieur, en matière patrimoniale et matrimoniale notamment ?
Ces débats portent effectivement aussi sur ce qu’est une chose, la disposition d’une chose, la propriété… Depuis le Moyen Age, ou même depuis l’Antiquité, il existe des débats sur la théorie sociale de la propriété : est-ce que ce que je possède m’appartient, et en ai-je le libre usage ? Les juristes diraient : en l’ai-je l’usus, le fructus et l’abusus, de sorte que je peux en faire absolument ce que je veux ? Ou est-ce qu’au contraire, je dois considérer que cette chose appartient également à d’autres personnes (ma famille, la société…) auxquelles elle peut aussi servir ? Les nazis radicalisent ce débat pour instaurer l’idée d’un service à rendre au peuple et à la race. Un juriste comme Roland Freisler – président du tribunal du peuple à partir de 1942 – développe l’exemple de la propriété d’une récolte : d’après le Code civil, un paysan est propriétaire de sa récolte au sens où il peut aller jusqu’à la détruire, si par exemple il trouve que les cours sont trop bas et que les prix de vente ne lui permettent pas de faire un bénéfice suffisant. Or Freisler dit que la récolte n’est pas propriété du paysan qui l’a récoltée, mais de la communauté raciale qu’elle doit nourrir : la libre disposition de la chose possédée est conditionnée par l’existence d’une communauté raciale qui a un usage de la chose possédée. D’un côté, les juristes réinvestissent donc un débat multi-séculaire ; et de l’autre, ils établissent de nouvelles normes dans le contexte de la construction d’une économie autarcique et de guerre, et dans un contexte de racialisation de la communauté allemande fortement traumatisée par les famines du XIXe et du XXe siècle.
Cette refondation du droit s’appuie sur une pratique largement orale : à côté des textes, ce nouveau système normatif laisse une grande marge d’appréciation aux juges et aux juristes pour réinterpréter le droit existant dans un sens favorable à la communauté raciale. Sur un autre plan, on peut prendre l’exemple de la conjugalité, et en l’occurrence de la monogamie, que je développe dans un chapitre de La révolution culturelle nazie. Il s’agit là d’une norme instituée en Occident de manière progressive, mais qui n’est plus questionnée à l’époque moderne et contemporaine. Dans les cercles racistes de la SS, les nazis les plus radicaux l’interprètent comme étant une création juive, imposée aux Germains par l’évangélisation chrétienne, dans le but d’en assécher la matrice reproductive – puisqu’elle conduit à faire moins d’enfants. Là encore, on n’a pas affaire à une invention nazie : cette idée est présente chez les racistes völkisch du XIXe siècle. Sous le IIIe Reich, elle se heurte à la fois à l’opposition de la culture socialement dominante (qui reste de tradition chrétienne), mais aussi à une opposition interne (dans un premier temps, Hitler lui-même n’est pas particulièrement favorable à la polygamie). Cependant à mesure que se déroule la guerre, et que se multiplient les désastres pour l’Allemagne, c’est-à-dire à mesure que s’aggrave l’hémorragie de sang combattant pour le IIIe Reich, l’idée d’instaurer une polygamie fait son chemin au sommet de l’Etat et du parti. Ce qui aboutit, en 1944, à un véritable projet de loi visant à « ré-instaurer » une polygamie « germanique » désormais considérée comme la norme archaïque de la communauté allemande, avant son aliénation par des siècles de christianisme.
Cette normativité articule la morale et le droit à une conception « biologique » du monde qui est indissociablement antisémite : à vous lire, on comprend aussi que l’extermination des Juifs d’Europe, et d’autres « indésirables », se conçoit comme une politique et un droit d’ « hygiène publique ».
Cette question est si vaste… Il faut d’abord revenir à la prétention des nazis à parler au nom de la science, et à affirmer que la science parlait à travers eux. L’un des fondements de leur vision de l’histoire, c’est que pendant des millénaires, les Germains auraient été victimes de leurs ennemis sans pouvoir s’en défendre, parce qu’ils n’en connaissaient pas la nature. Et surtout, parce qu’ils en ignoraient le caractère « naturel », inscrit dans les lois de la nature. Seule la connaissance de la nature permise par la science du XIXe siècle permet alors de savoir qui est qui, et qui représente quel type de danger. Les Slaves ne représentent pas en soi un danger, car ils sont une race inférieure d’esclaves et d’instruments qui peuvent être utilisés indifféremment par les véritables ennemis – les Juifs – ou par les Germains à leurs propres fins. Il n’y a donc pas de guerre d’extermination à mener contre eux – il faut simplement les dominer et réguler leur démographie. Les Noirs non plus ne sont pas dangereux : eux-aussi sont pour les nazis une population de sous-hommes, inoffensive dès lors qu’elle reste sous ses latitudes et qu’elle n’est pas mélangée aux populations d’Europe, comme cela a été le cas en France après la Première guerre mondiale. Bref, à partir de l’anthropologie raciale, les nazis pensent pouvoir discriminer différents degrés de menace parmi les non-allemands.
Parmi ces populations, les Juifs ne ressortissent ni de l’humanité, ni de l’animalité : ils relèvent d’un autre type d’êtres vivants, qui serait de l’ordre du microbe ou du virus. Les nazis appréhendent « la question juive » d’une manière médicale. Là encore, les nazis réutilisent un registre employé par des antisémites radicaux du XIXe siècle, comme Paul de Lagarde, qui exploitent une métaphore dont la puissance autorise les modalités d’action les plus extrêmes. Sauf qu’ils reprennent cette métaphore littéralement. Cela leur permet, d’une part, de dépassionner la question – il ne s’agit pas de haine ou de jalousie, mais de protocole médical, scientifique – et d’autre part, de promouvoir la nécessité de leur action. Face à un danger microbien, il est nécessaire, pour le corps de la race, de combattre et d’éradiquer le microbe. Dans La révolution culturelle nazie, je cite de nombreux auteurs qui accréditent cette idée. Parmi eux, Himmler, au sujet des homosexuels, déclare en substance qu’il n’a rien de plus contre eux que contre les orties qui poussent dans son jardin : ces orties, il les arrache, les entasse et les brûle. Or de même que les orties menacent les bonnes espèces de son jardin, les homosexuels menacent la reproduction de la race. Pour ce qui concerne les Juifs, un antisémite aussi radical que Robert Ley, chef du Front du travail allemand, déclare qu’on ne négocie pas avec un microbe, qu’on ne l’enferme pas. Ce qui justifie une mise à l’écart radicale de ce que les nazis appellent « le danger juif ». Mais cette mise à l’écart doit elle-aussi être historicisée, car elle prend des formes différentes au fil du temps. Elle est d’abord géographique et topographique, sous la forme de l’expulsion et de l’exil forcé – ce qu’exprime le slogan « Juden Raus ! » : c’est le projet Madagascar, ou celui d’un abandon vers les confins orientaux ou septentrionaux de l’URSS, que les nazis pensent encore conquérir rapidement. Puis en 1941, cette mise à l’écart évolue vers une politique d’extermination physique.
A lire également sur Nonfiction :
La seconde partie de cet entretien avec Johann Chapoutot (à venir)
Johann Chapoutot, Le national-socialisme et l'Antiquité, par Anne Pédron
Johann Chapoutot, La loi su sang. Penser et agir en nazi, par Nicolas Patin
Johann Chapoutot, Des soldats noirs face au Reich. Les massacres racistes de 1940, par Anthony Guyon
Nikos Foufas, Marx et la Grèce antique. La lutte des classes dans l'Antiquité, par Jonathan Louli
