Les transformations successives du travail se sont traduites par une dépossession du travailleur de son travail. Les mutations en cours pourraient-elles alors, à certaines conditions, aider le travailleur dépossédé à reprendre la main sur son travail ? C'est tout du moins l'hypothèse que fait Pierre-Yves Gomez dans son nouvel ouvrage, Intelligence du travail (DDB, 2016). A l'occasion de sa sortie, il répond à quelques questions de Nonfiction.fr.
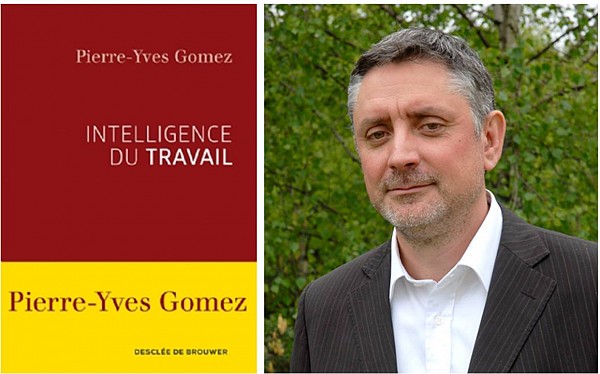
Nonfiction : Vous expliquez que le travailleur a échangé l’intelligence du travail contre les biens que procure la société de consommation. Pourriez-vous expliciter les mécanismes par lesquels cet échange s’est effectué ?
Pierre-Yves Gomez : L’ère industrielle a effacé la proximité, le lien direct entre le travailleur et le fruit de son travail. Proximité longtemps entretenue tant que l’économie n’était qu’une dimension solidaire de la vie sociale. Ainsi en est-il, par exemple, dans la société agricole traditionnelle. Le propre du processus industriel a été d’insérer la technique et les technologies gestionnaires entre le travailleur et le résultat de son travail : on a assisté à une division puis à une parcellisation des tâches. Le rythme et le temps du travail ont été mis sous contrôle « rationnel ». La définition du projet, du sens et finalement de l’intelligence de son travail échappent alors à chaque travailleur parce qu’elle est prise en charge par une infrastructure technologique gestionnaire contrôlée par des experts en organisation et en management. Ainsi l’histoire moderne est celle d’une désincarnation de ce que Marx appelle le « travail vivant ». Histoire de la transformation de l’homme au travail en « ressource humaine » au service d’un système productif efficace à produire des biens et des services en masse, pas chers et toujours renouvelés, offerts à l’appétit insatiable de les consommer. Or le consommateur au bout de cette chaîne n’est autre que le travailleur lui-même. Tel est le mécanisme qui compense la perte de sens et d’intelligence du travail d’un côté par l’abondance des satisfactions et des jouissances de l’autre. Le « besoin » infini du consommateur donne finalement le sens à la production industrialisée dans laquelle le travailleur n’est plus reconnu que comme un moyen de produire parmi d’autres. C’est la consommation globale qui fait sens dans ce que j’appelle la cité du consommateur.
Vous assassinez dans cet ouvrage la « nouvelle critique sociale » pour ne pas s’être intéressée au travail. Pour autant, de nombreux autres auteurs ont continué de se pencher sur le travail, qui n’a pas non plus disparu du débat public. Le problème ne serait-il pas plutôt que, pendant toute une période, le sujet a cessé d’intéresser les directions d’entreprises ?
J’espère que je n’assassine personne car je suis fondamentalement non-violent… Le sujet du travail n’a pas cessé d’intéresser seulement les dirigeants d’entreprise, il a cessé d’intéresser à peu près tout le monde, politiques autant que syndicalistes ou intellectuels. Après une conférence dans une grande centrale syndicale, je me suis entendu dire : « vous avez raison, nous avons abandonné la question du travail en nous mobilisant seulement sur le pouvoir d’achat, ou les conditions de travail, mais pas sur le fond de la question qui est l’appropriation du sens du travail ». C’est vrai, on a pensé le travail dans ses contraintes, ses souffrances, ses transformations ou son coût. Mais plus dans sa dimension émancipatrice. Or le travail nous fait passer de la dépendance à l’interdépendance, de la passivité consommatrice à la définition de normes de métiers, de tours de main ou de travail bien fait qui donne du sens à la vie sociale, à la vie tout court.
Penser une société à partir du travail émancipateur est devenu un signe d’obsolescence idéologique depuis que (je parle des années 1990) le loisir et la légèreté ludique ont été instaurés comme l’horizon indépassable d’une société néolibérale accomplie. Faisaient exception, une poignée de spécialistes, sociologues, économistes du travail, ergonomes, et quelques philosophes. Ceux-là n’ont cessé de rappeler depuis des décennies l’importance de la dimension anthropologique et sociale du travail et ceux-là, non seulement je ne les critique pas, mais ils m’inspirent. Je pense à Gorz, à Ellul, à Ilitch pour ne pas remonter à la grande Simone Weil. En revanche, ce que je pointe du doigt, c’est cette soi-disant critique postmoderne, qui cherche à penser l’émancipation à partir de la déconstruction et « l’entrepreneuriat de soi ». Elle postule l’impermanence et la société liquide comme le dit Bauman, sous estimant l’importance des structures qui permettent ou non l’émancipation à partir du travail. Critique petite-bourgeoise qui occupe le terrain idéologique et ne laisse aucune chance à l’émancipation réelle du travailleur par la réappropriation de son travail. Or j’affirme que cette réappropriation est décisive parce qu’elle définit les contraintes sociales et les structures économiques qui, si elles ne sont pas maîtrisées par ceux qui les créent du fait même de leur travail, deviennent des toiles d’araignées dans lesquelles s’engluent des citoyens-consommateurs faussement libres. Je pointe du doigt la critique postmoderne ultra-individualiste, qui, en considérant que les constructions communautaires sont aliénantes par nature, rend impossible la prise de conscience du fait que c’est dans la maîtrise collective du sens du travail que l’émancipation se jouera. C’est donc cette critique de la « société » et elle seule que je vise.
Vous expliquez l’importance de la forme de gouvernance des plateformes numériques s’agissant de l’intelligence du travail. En même temps, vous ne manquez pas d’indiquer que les effets de réseaux favorisent la concentration. Dans quoi placez-vous alors vos espoirs pour que ce mode de fonctionnement puisse être bousculé ?
Le livre essaie de montrer que rien n’est décidé et que la bataille pour faire naître une société différente à partir des nouvelles technologies est indécise : des forces (essentiellement de grandes entreprises globalisées) tendent à utiliser les plateformes internet pour accroître l’intégration de la production, pour développer le big data, le traçage de nos comportements afin de mieux cibler et augmenter l’offre de consommation. C’est l’œuvre de ceux qui, en s’appropriant les plateformes, tendent à les utiliser comme d’immenses hypermarchés et aussi comme des lieux de production où des internautes besogneux accomplissent une petite quantité de travail inintelligent pour eux puisque seul le grand ordonnateur sait à quoi tend ce travail. On est là du côté de la cité de la consommation. Mais d’autres forces, des associations, de petites entreprises ou des communautés internet cherchent au contraire à utiliser les plateformes pour créer de la proximité, pour mieux connaître le travail de ceux qui produisent et ajuster la consommation à ce travail. Ce sont les réseaux de consommation courts, la production de services libres, etc. – comme nonfiction.fr par exemple. On est plutôt du côté de la cité du travailleur. Or celle-ci peut l’emporter et finalement modifier notre façon de vivre ensemble à au moins deux conditions. D’abord que se maintienne l’action militante pour échapper à la consommation industrialisée et jouer la technologie au bénéfice de la proximité. D’autre part, que la loi rende impossible l’accaparement des plateformes par des entreprises. Nous sommes aujourd’hui dans un vide juridique : alors que les plateformes n’ont de valeur que parce que les internautes qui les utilisent les « fabriquent » par leur travail libre et gratuit, elles peuvent être achetées comme n’importe quel actif d’une entreprise. Or les plateformes internet sont des « communs », c’est-à-dire des propriétés qui appartiennent à ceux qui les font naître et vivre par leur participation, c’est-à-dire le travail qu’ils y réalisent. Mais il n’y a pas encore un droit protégeant les « communs ». D’où l’enjeu politique majeur de constituer un tel droit.
Vous suggérez à la fin du livre un certain nombre d’actions ou tout au moins d’orientations que pourraient adopter les « gouvernants » dont vous dîtes qu’ils s’agiraient également au-delà des responsables politiques de tous ceux qui exercent une responsabilité dans les organisations, dans les entreprises et dans les institutions publiques. En connaissez-vous qui soient prêts à les adopter ou qui auraient déjà inscrit dans leur « programmes » des mesures similaires ?
A l’issue de l’analyse sur l’évolution du travail, sur les forces en présence, et sur les conséquences que pourront avoir la digitalisation, la robotique ou les nouvelles formes d’organisation de la production, je suggère trois marqueurs pour évaluer les programmes économiques ou politiques. Ces marqueurs permettent de distinguer si le « gouvernant » nous propose d’aller plutôt du côté de la cité du consommateur ou plutôt du côté de la cité du travailleur. Il s’agit donc moins de proposer des mesures précises que d’évaluer si celles que tout candidat au gouvernement ne manque pas de proposer sont cohérentes, et dans quelle direction elles vont orienter notre vivre ensemble. Car là encore, c’est l’intelligence du travail qu’il faut retrouver : l’intelligence du travail de ceux qui nous gouvernent ou aspirent à le faire
A lire également sur nonfiction.fr :
Pierre-Yves Gomez, Intelligence du travail, par Jean Bastien
Notre dossier Le travail en débat : au-delà de la loi El Khomri
