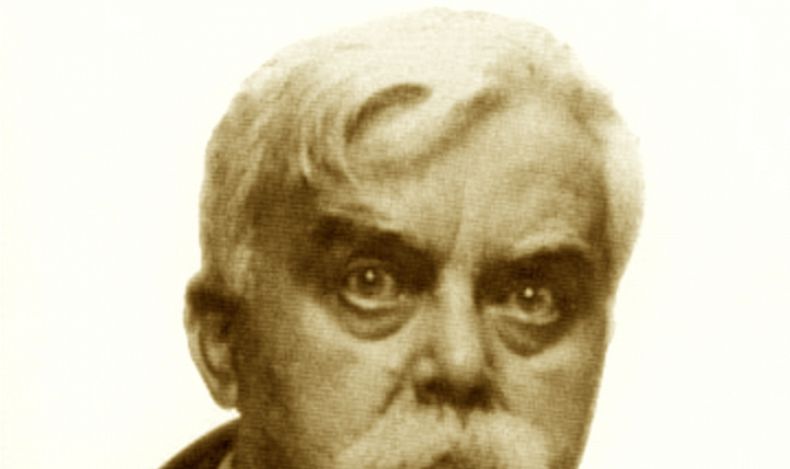Une analyse des œuvres de Léon Bloy qui découvre un style complexe et une idéologie singulière.
Le nouvel ouvrage de Pierre Glaudes sur Léon Bloy met en exergue un inébranlable système de pensée qui sous-tend les romans, contes et nouvelles d’un écrivain en lutte constante avec la modernité. La « puissante unité de [l’]œuvre » se reflète dans une analyse minutieuse et lucide de styles et de thèmes qui, à travers les chapitres, renvoie toute observation à l’idée dominante de Léon Bloy que « Dieu ne parle jamais que de lui-même », que tout événement est symbole du divin, que l’histoire n’est que le Nouveau Testament continué. Mais en plus de faire l’éloge d’un style littéraire original, Pierre Glaudes nous présente une critique sévère d’un monde romanesque qui, alimenté par les idées fixes d’un écrivain se croyant un visionnaire élu, « frise aussi le gouffre du non-sens ».
Pour Léon Bloy, toute affaire humaine fait partie du plan divin, l’histoire n’étant autre que la biographie du Créateur. Au même titre, en raison de sa nature déchue, l’homme peine à comprendre les symboles de Dieu qui l’entourent. Inspiré de l’énoncé de saint Paul que « nous voyons au moyen d’un miroir, d’une manière obscure » (I Cor., XIII, 12), Léon Bloy conçoit la tâche de l’écrivain comme un prophète qui déchiffre l’histoire moderne en tant que Parole de Dieu. Dans son Journal, les événements récents sont autant de drames bibliques transposés. Dans une véritable transformation de l’histoire en fable symbolique, la France surgit comme le Nouvel Israël, Marie-Antoinette comme une « Vierge en pleurs », la Révolution française comme un prolongement des rébellions israélites et protestantes contre l’autorité divine et la perte de la guerre franco-prussienne comme la plus récente des punitions de Yahvé contre son peuple élu.
En plus de souligner le courant francocentriste du Journal, Pierre Glaudes a raison de relever des tendances solipsistes ainsi que l’absurdité de tout ramener à la volonté de Dieu à la base du dolorisme bloyen, y compris les tragédies humaines, lesquelles sont justifiées comme indispensables pour assurer le Bien. Dans l’exemple le plus frappant, Léon Bloy perçoit les immenses souffrances résultant de l’explosion volcanique de 1902 en Martinique comme étant un mal nécessaire, destiné à « contrebalancer la première communion de [sa propre] enfant ». En dernier ressort, comme l’explique Pierre Glaudes, le Journal de Léon Bloy est criblé de « rapprochements inattendus [qui] font basculer l’histoire du côté de la fiction ». Et, à coup sûr, son courant antimoderne de pourfendre les inventions contemporaines telles que le phonographe, le téléphone, la bicyclette et l’automobile, ainsi que le sport et le progrès médical, dresse l’autoportrait non pas d’un écrivain en avance de son temps mais, bien au contraire, d’un réactionnaire solitaire qui passe à côté de l’esprit de son époque.
C’est plutôt du côté de l’analyse des effets de style employés dans la fiction de Léon Bloy que nous pouvons cerner une appréciation de son œuvre. Pierre Glaudes nous fait découvrir un mélange insolite de styles et de genres visant à révéler le divin dans la vie mondaine et à tourner en dérision l’époque moderne, à savoir bourgeoise. Les romans, nouvelles et contes oscillent délibérément entre la parabole et la farce, afin de « semer le trouble dans l’esprit du [lecteur] bourgeois » qui s’attend à un respect des genres et des codes littéraires, ainsi qu’à une défense de ses propres valeurs morales. Par une ironie transcendante, un humour noir et une parodie tranchante, lesquels s’inspirent de l’adage évangélique que « les derniers seront les premiers, et les premiers les derniers » (Matt, XX, 16), les « histoires désobligeantes » de l’écrivain opèrent des séries de renversements qui exaltent les pauvres et rabaissent les riches.
Par des « revirements inattendus », les textes visent, au premier chef, à révéler la face de Dieu là où on s’y attend le moins. À titre d’exemple, dans « La religion de M. Pleur », qui s’annonce d’emblée comme une dénonciation de l’argent par l’élaboration du thème de l’avarice dont le personnage éponyme est visiblement atteint, tout s’avère le contraire de ce qu’il paraissait être. Dans le dénouement, M. Pleur se révèle être le plus fervent des chrétiens qui, en faisant don de ses richesses, profite des effets rédempteurs de l’argent pour se délivrer du mal. Dans une formidable conciliation de contraires qui s’inspire des versets-clés des Livres des Proverbes et des Psaumes, l’argent devient le symbole du Christ Sauveur, du « médiateur qui rachète ses frères humains ». Ainsi, l’argent, cette force omniprésente qui règle toute transaction dans la vie moderne, découvre « la figure de Dieu que les mœurs positives et l’épais matérialisme du siècle ont horriblement travestie ». En somme, l’argent n’est autre qu’un reflet de la divinité, tout diffracté qu’il soit.
Dans la même lignée, Le Désespéré se présente comme une « littérature du blasphème » selon laquelle le narrateur révèle la vie de rebelle que mène le protagoniste comme étant en réalité celle d’une âme déviée, une « prière de l’abandonné », une sorte de « blasphème par l’amour ». Par conséquent, conformément au « paradoxe spirituel » qui anime le texte bloyen, on rencontre Dieu jusque dans le cas des personnages habitant le fond de l’abîme. Comme le constate Pierre Glaudes à propos de la portée spirituelle du roman, « la transcendance s’éprouve au cœur de la déréliction ». Ainsi, le désespoir auquel fait allusion le titre de la nouvelle s’avère une « espérance défigurée » et constitue le paroxysme d’une « ironie spirituelle » propre à Léon Bloy.
À maintes reprises, Pierre Glaudes met en question l’intégrité et la portée d’un projet littéraire qui vire à l’excès. Pour souligner la nature tragique de la Chute, ainsi que la dimension apocalyptique de son époque, Le Désespéré et Histoires désobligeantes font fusionner les contraires, tels le sublime et le grotesque, l’eschatologie et la scatologie. Ces œuvres révèlent « la puissance active du mal » par « l’exaltation des réalités corporelles ». Pourtant, selon l’analyste, l’accumulation de « répulsives images dans le dessein de servir une ambition spirituelle » – les « émulations de saleté », les « assauts de crotte », les « immondices », les « sédiments impurs » – engendre une « confusion irrévérencieuse » dont la gauloiserie risque d’apparaître gratuite. Par le mélange constant et déstabilisateur du haut et du bas, le texte brouille sa propre lisibilité. En conséquence, on ne sait s’il faut appréhender les héros comme un « élu de Dieu [ou un] suppôt de Satan », et si les voix que l’on entend sont « l’auxiliaire de la vengeance divine ou une possédée qui cède à l’appel du malin ». Trop souvent, l’hésitation entre la nature divine ou satanique d’un personnage reste irrésolue. Ce sont ces « procédés de brouillage de sens » que Pierre Glaudes désigne comme « l’un des traits les plus originaux de l’écriture bloyenne ». Et, selon le critique, ils témoignent d’une véritable « littérature de crise » qui ne trouve pas d’issue aux paramètres de sa propre vision du monde. Au cœur de sa critique, Pierre Glaudes révèle dans l’œuvre de Léon Bloy une « diffraction du sens » qui risque de se présenter comme une « immense farce sacrilège ». Le lecteur, confronté à une « herméneutique à haut risque », se trouve piégé dans « des brumes de l’incertitude ». Reste à savoir si, et comment, cet analyste n’est pas lui-même victime de l’écrivain dont la mission est justement de « semer le trouble dans l’esprit du [lecteur] bourgeois » (op. cit.). Une explication développée qui fait la distinction entre une lecture déroutante voulue et une étude qui découvre une véritable crise de sens semble être de mise.
Léon Bloy, la littérature et la Bible permet de découvrir l’étendue de l’œuvre de Léon Bloy, y compris sa propre théologie, les divers procédés littéraires qui participent d’un style original, et une analyse qui sonde les limites d’une écriture de foi qui défie l’orthodoxie. La dernière partie de l’étude, consacrée à une exploration de l’influence exercée sur l’écrivain par d’autres penseurs (Joseph de Maistre, Chateaubriand, Thomas Carlyle et Henry de Groux) dresse le triste portrait d’un homme de lettres « cherchant à être seul contre tous » et méritant le titre peu flatteur de « fol en Christ ». Loin de constituer la réhabilitation d’un écrivain sous-estimé, cet ouvrage justifie son insuccès, ainsi que son statut officieux d’écrivain mineur