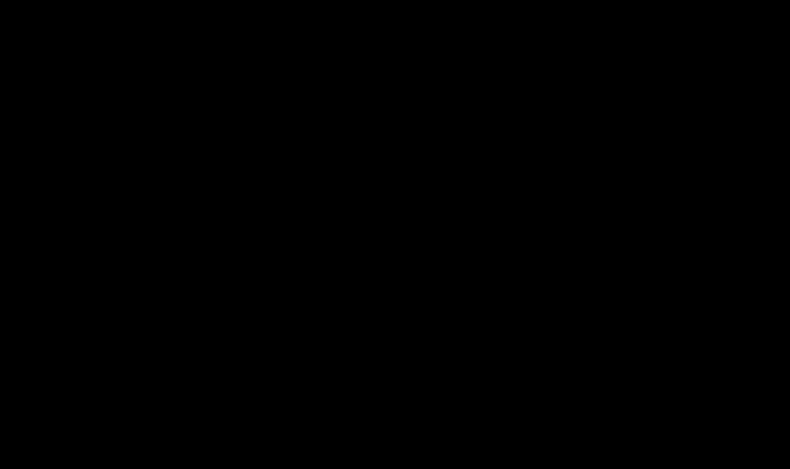Une généalogie philosophique du concept de représentation politique qui fait apparaître son caractère paradoxal.
Dans Le miroir et la scène, Myriam Revault d’Allonnes, philosophe et professeur émérite des universités à l’Ecole Pratique des Hautes Etudes, s’efforce de penser à nouveaux frais la représentation politique. La force de son argumentation est de ne pas réduire la représentation à sa dimension juridico-politique. Plutôt que de se focaliser, comme maints auteurs, sur la crise de la représentation en la posant, d’une part, comme un fait établi et, d’autre part, en l’assignant à un problème reposant, avant tout, aux représentants, elle remet en question l’authenticité d’une « crise de la représentation ». Contre l’évidence acquise de celle-ci, elle étaie, dans un premier temps, que le concept de « crise » n’est pas idoine à la situation. D’où la thèse qu’il faudrait penser, d’abord, la représentation des capacités plutôt que celle des identités. Les propos laconiques ou acerbes de citoyens consistant à déplorer leur mauvaise représentation soulignent leur statut passif. Or il ne suffit pas les représentants nous représentent comme un miroir pour que la représentation politique soit juste et authentique. Plutôt que penser la représentation en termes d’identité, il faudrait faire prévaloir, ce que Spinoza appelle « la puissance d’agir ».
Dans un premier temps, à titre préliminaire, Myriam Revault d’Allonnes établit une généalogie du concept en s’appuyant sur deux sources originelles : la peinture et le théâtre. En philologue, elle souligne l’étymologie du mot qui sous-entend un caractère pathologique du terme. Or, l’idée même d’une coïncidence entre représentants et représentés est un leurre puisque, jamais, sans doute, cette fusion factuelle n’a existé. Elle rappelle, dans un premier temps, qu’à l’origine, la représentation n’était pas politique. Le terme vient, en effet, de mimesis, signifiant « représentation » ou « imitation ». Elle développe, avec grande finesse et beaucoup de clarté, les différences de conceptualisation établies par Platon et Aristote. Pour le premier, il s’agit, avant tout, d’un modèle pictural, de l’imitation d’un modèle idéal dont la copie doit tendre à la perfection. Pour le second, la représentation a, davantage, trait au théâtre et s’apparente, plutôt, à une mise en scène.
Une médiation nécessaire
Dans un second temps, Myriam Revault d’Allonnes développe en quoi la modernité va tracer de nouveaux chemins à la représentation politique. De l’incorporation d’autrefois, le nouvel âge du politique va faire procéder la représentation d’une logique de déliaison. Avant la modernité, en effet, les sociétés politiques n’avaient pas véritablement recours à la représentation. Au Moyen-Age, la métaphore du corps théologico-politique du roi mettait une image à la double structure, à la fois religieuse et politique, du monarque sacré qui symbolisait la chair de la nation. La société était pensée, à cet égard, comme un corps dont l’unité était garantie par un substrat divin. Avec la naissance de la Modernité on change de paradigme. Les conditions qui ont permis son engendrement sont nombreuses : en premier lieu, la révolution scientifique galiléo-copernicienne, les mutations politiques, le primat de l’individu. Elles ont, en commun, d’avoir désagrégé l’ancien ordre du monde. Le philosophe Hobbes va, à la suite de cette fracture historique, s’interroger sur le terme de souveraineté. De là plusieurs questions : qu’est-ce qui fonde l’obéissance ? Comment assurer l’unité du corps social ? Ce qui soutenait, ainsi, l’unité de l’ancien monde s’est défait. La communauté politique ne peut plus coïncider avec elle-même. D’où sourd l’impérieuse nécessité d’une médiation. C’est, ainsi, que nait la représentation. En effet, le peuple n’existe pas en soi. Il peut, dorénavant, se constituer comme tel, à travers cette opération représentative. Le peuple va, alors, autoriser le souverain à le représenter.
Myriam Revault d’Allonnes pense ensuite la métamorphose de la représentation en s’interrogeant sur la possibilité d’un pouvoir sans corps. Ce, car la démocratie moderne est caractérisée par un processus de désincorporation ou de désubstantialisation du pouvoir. D’où la question de cette évolution. S’agit-il, en réalité, d’une évolution procédant d’une rupture. Se référant aux travaux d’Hans Blumenberg, elle va mobiliser son concept clé d’Umbesetzung que l’on peut traduire par « réinvestissement ». Dès lors le passage d’incorporation à la représentation peut s’analyser, non à l’aune d’une rupture ontologique, mais à la lumière d’une logique de continuité fonctionnelle. Le concept du philosophe allemand peut se comprendre par la métaphore de « redistribution ». Reprenant une figure parlante de Jean-Claude Monod dans son livre La querelle de la sécularisation, « au sens où une pièce de théâtre qui fait l’objet d’une reprise connaît une nouvelle distribution, c’est-à-dire de nouveaux acteurs pour les mêmes rôles ». La modernité doit réinventer du sens, en élaborant un nouveau système de théodicées du pouvoir, en se refondant, à la fois dans ses dimensions ontologique, anthropologique et politique. La téléologie antique perdant de puissance de légitimation du pouvoir.
Un quatrième moment de la réflexion aura pour objet la dimension fictive de l’institution politique à l’âge de la modernité. Présentant d’abord la critique rousseauiste de la représentation politique en raison du caractère inaliénable de la souveraineté : « le souverain qui n’est qu’un être collectif ne peut être représenté que par lui-même. Le pouvoir peut bien se transmettre mais non la volonté ». Ajoutant plus loin que « la souveraineté ne peut être représentée, par la même raison qu’elle ne peut être aliénée ; elle consiste, essentiellement, dans la volonté générale et la volonté ne se représente point : elle est la même ou elle est autre ; il n’y a point de milieu ». Aussi le peuple n’existe pas antérieurement à l’institutionnalisation de la représentation.
Elle s’interroge, alors, sur le paradoxe de la représentation politique de la modernité en ce qu’elle a pour fonction de rendre présente quelque chose qui est absent. La crise de la représentation peut s’expliquer, ontologiquement, dans la mesure où la démocratie est, pour reprendre une formule du philosophe Claude Lefort, est, non seulement, « un lieu vide du pouvoir » mais que ce dernier est, originellement, dans une dynamique de désincorporation. D’où, logiquement, un hiatus consubstantiel aux mécanismes du régime démocratique. La déliaison qui fonde l’institutionnalisation de ce dernier souligne ses apories inhérentes à ce que la société dont elle accouche a consacré l’indétermination et l’incertitude, à la fois, comme origine de ses fondements, horizon de sa réalisation, et étalon de son existence, de sorte de la représentation ne peut s’effectuer qu’à mesure qu’elle adoube la logique de séparation. Raison pour laquelle la représentation se manifeste par le paradoxe que le corrélat d’une forme d’unité du « commun » est alimenté par une dynamique de non-coïncidence de soi et aux autres.
Une représentation politique paradoxale
Myriam Revault d’Allonnes achève sa réflexion, à la suite de la philosophie hobbesienne en étayant que la théorie de la représentation procède du caractère paradoxal du processus de représentation puisque l’identité s’exprime dans la différence, usant de la métaphore théâtrale dont l’image de la persona permet d’opérer une unité du représentant et du représenté. Les troubles de la représentation politique moderne sont liés à la nature même de notre être en commun. Ce qui fait lien repose, pourtant, sur un paradoxe en cela, qu’elle dévoila la non- coïncidence à soi et l’épreuve de séparation. Il est, en effet, illusoire de penser que la représentation est susceptible de figurer la réalité de façon transparente ou adéquate. La métaphore théâtrale de la persona en témoigne. Ce masque couvre, certes, le visage de l’acteur, mais il laisse, toutefois, passer sa voix. Le peuple est, donc, l’auteur de la pièce que joue le représentant souverain
Le lien démocratique est fondé, dès son origine, sur la séparation. Elle abolit les similitudes. Sur quoi, en effet, désormais, s’agence l’identité du peuple : sur la race ? Sur l’histoire ? Le commun ne se donne à voir, en réalité, qu’à travers les bris de la division. Dès lors, que peut la représentation politique ? Comment comprendre la crise de la représentation ? Doit-on l’appréhender comme une impuissance du processus représentatif ? Ou comme une crise des instances juridico-politiques ? De fait, les formes institutionnelles sont perçues, crescendo, comme inadéquates et inopérantes. De là l’émergence d’une défiance citoyenne qui est susceptible, notamment, d’expliquer l’abstention. Elle met, aussi, en lumière, l’impuissance des représentants à incarner l’unité et à cristalliser une identité de la communauté politique. Les citoyens veulent, de plus en plus, d’autres modalités de représentation. La crise suppose, comme le souligne son étymologie, un état pathologique. Et, conséquemment, présuppose une altération d’un état « normal ». Par conséquent, comment définir la bonne représentation ? Doit-elle se concevoir comme une coïncidence entre les représentants et les représentés ? On voit que cette gageure relève de l’impossible. Raison pour laquelle apparaît la nécessité de l’imagination.
Pour conclure cet ouvrage, à la fois riche et original, la philosophe justifie la puissance spinoziste d’une représentation à la lumière des capacités et non des identités, en soulignant la fragmentation du social dans le monde contemporain, à mesure que les identités particulières ont tendance à s’affirmer et à se politiser. De là l’impossible d’une adéquation entre représentants et représentés si l’on pense la représentation comme une pure coïncidence à soi. La principale critique qu’on peut émettre est de ne pas illustrer sa réflexion par des exemples concrets. Son analyse est parfois trop abstraite et aurait mérité d’être alimentée par des figures politiques. Quid de Charles de Gaulle ou Nelson Mandela par exemple. Ne peuvent-ils pas être considérés, à certains égards, comme des contre-exemples du processus moderne de désincorporation du pouvoir politique ? Quand bien même sa lecture spinoziste est extrêmement puissante et pertinente dans notre modernité dont les logiques de fragmentation du corps social semblent indéniables, et appellent à dépasser le paradigme d’une représentation par identités par la médiation de l’imagination de sorte que les capacités soient la meilleure et, sans doute, seule modalité viable, de représenter, elle élude peut-être un idéal, à la fois individuel et collectif, de fonder la multitude dans ce que l’on qualifie souvent d’ « un-social ». À son analyse enracinée dans le champ de l’histoire des idées politiques, elle aurait dû probablement introduire dans sa réflexion de la psychanalyse et psychologie politique pour mettre en évidence une ambivalence et une tension dans le balancement entre les deux modalités de la mimesis. À cette seule réserve, son essai est d’une très grande richesse et clarté et n’entame aucunement la pertinence de sa thèse qui, en invitant à repenser celle-ci à l’aune de sa propension, via l’imagination, à engendrer de l’être en commun, permet de tracer une voie d’autant plus judicieuse dans l’appréhension de la représentation politique, que le multiculturalisme et la fragmentation des sociétés contemporaines appellent à s’arracher aux logiques identitaires susceptibles de ruiner le processus démocratique en ce que la pluralité de l’ethnos, dans sa tendance à se revendiquer comme force politique, met à mal la construction d’un démos et d’une société apaisée