Auteurs de plusieurs ouvrages sur les droites extrêmes, Stéphane François et Nicolas Lebourg sont chercheurs au CNRS et membres de l’Observatoire des radicalités politiques de la Fondation Jean Jaurès (ORAP). Ils ont publié en 2016 un ouvrage commun : Histoire de la haine identitaire. Mutations et diffusions de l'altérophobie . A l'heure où, en France et dans le monde, le repli sur soi et la haine de l'autre semblent être en train de regagner leur pleine vigueur, ils reviennent pour Nonfiction sur l'histoire plus longue d'où émerge le sens des violences physiques et verbales qui ponctuent l'actualité.
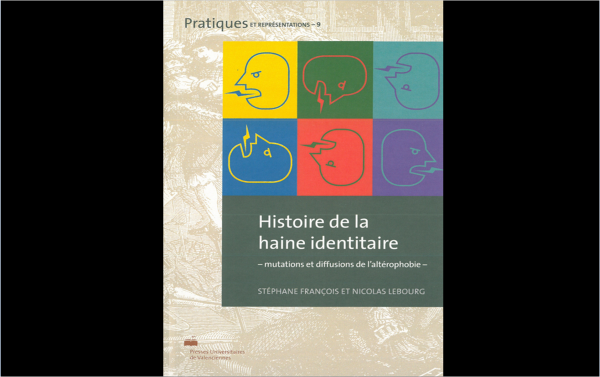
Nonfiction : Pourquoi avoir choisi le crime d’Anders Breivik comme point de départ de cette histoire de la haine identitaire? En quoi ce cas est particulièrement symptomatique d’un mouvement plus profond?
Stéphane François : C’est vrai que cette haine préexiste à l’acte de Breivik, mais avec celui-ci nous changeons d’échelle et de cibles : le nombre est impressionnant (77 morts et 151 blessés). Surtout, son auteur n’a pas ciblé des immigrés, mais des responsables de la société civile et de jeunes militants socialistes… En outre, Breivik, avant de passer à l’acte, s’est abreuvé d’une littérature identitaire et raciste, facilement disponible sur le Web depuis le 11 septembre 2001, et dont il a nourri son manifeste. Enfin, cet acte montre dans toute sa crudité et sa violence le rejet de la société multiethnique et multiculturelle.
Il est donc une sorte de propagande par le fait, théorisée par les anarchistes, un happening nihiliste d’un militant d’un parti populiste, fier de son action (il l’a d’ailleurs revendiqué lors de son procès). Cet attentat doit être vu comme une revendication identitaire : « si on ne fait pas le ménage, on disparaîtra sous le métissage ». En ce sens, effectivement, c’est le symptôme d’un mouvement plus profond : celui de la défense de l’identité blanche, victime des « hordes immigrés » destructrices. Ce thème de la substitution ethnique et culturelle était déjà proposé par des rescapés du nazisme, dans les années 1950. Ce n’est pas une nouveauté, mais une vieille antienne qui fait un retour fracassant.
Nicolas Lebourg : Breivik nous montre que les discours sur le « marxisme culturel », comme on disait jadis, habitent encore les dénonciations du « multi-culturalisme ». Son point de vue oscille entre le mainstream islamophobe de l'extrême droite néo-populiste et les strates doctrinales des extrêmes droites radicales. En cela il est un symptôme très éclairant. Et puis, il y a la question de la rationalisation. Car ce qui est intéressant c'est la réaction des médias : d'abord beaucoup attribuent par principe le crime à la nébuleuse islamiste, ensuite on se dit « ok, alors c'est un fou ». On a un discours étonnant qui, face à la violence politique, considère que l'on a affaire à une pathologie, et qu'une fois soignés les gens sont déradicalisés. Or, là on a bien quelqu'un avec un propos très construit, référentiel, et la foi en son idéologie. Notre incapacité à comprendre la motivation radicale, notre volonté de vouloir médicaliser la radicalité, me fait irrésistiblement penser à Desproges : « L'ennemi est bête : il croit que c'est nous l'ennemi alors que c'est lui ! ». La différence, c'est que cette incapacité n'est pas drôle.
Dans cet ouvrage très dense, vous replacez l’histoire de la haine identitaire dans le temps long à l’échelle de l’Occident. Ainsi, cela vous permet de déjouer le traitement « présentiste » du passé qui en est fait et d’éclairer ce qui sous-tend ses différentes manifestations. Vous introduisez à ce titre la notion d’alterophobie. Qu’est-ce qu’elle recouvre selon vous? Et qu’est ce qui la distingue du racisme?
NL : L'altérophobie, ce sont les péjorations induites par une permutation entre l'ethnique et le culturel, généralement le cultuel. Le terme vaut pour l'antisémitisme ; le mot naît en 1879 pour se différencier idéologiquement de l'antijudaïsme, mais le statut des juifs édicté par Vichy considère que l'on est de « race » juive selon les rites de ses ascendants. Cela vaut pour l'islamophobie, mot qui naît en 1910 et qui désigne la croyance en une négativité des mondes arabo-musulmans. Cela vaut pour le racisme, mot dont Grégoire Kauffman a trouvé une première occurrence en 1892, émis par un pamphlétaire craignant le remplacement des « gaulois » de la France du Nord par les « latins » de la France du sud. La question du racisme ne doit jamais être prise comme une simple raison biologique, c'est une synecdoque. Le principe américain qui vaut qu'une goutte de sang noir fasse que l'on est noir, nous renvoie à la limpieza de sangre de l'Espagne du XVIe et par-delà au droit médiéval qui veut qu'une goutte de sang de bas rang vaut ce niveau de naissance (la question des « bâtards ») : les problématiques du sang s'entremêlent aux questions juridiques, culturelles, matérialistes etc.
SF : On est aujourd'hui dans ce que Barker a appelé au début des années 1980 le « nouveau racisme », qui justifierait un communautarisme (la volonté de vivre entre soi est légitime, et il ne faut pas aller à l’encontre de ce choix, l’autre face de ce discours étant le renvoi de ces populations allogènes dans leur pays/aire culturelle). Il se manifeste également par l’ethno-différentialisme et la mixophobie. Le premier terme renvoie à l’idée d’un éloge de la différence poussé à un tel extrême qu’il se manifesterait par la mixophobie, qui est une peur du mélange, du métissage. Bref, il faudrait mettre les civilisations et cultures sous cloche afin qu’elles soient préservées de l’immixtion des autres, une idée qui vient des thèses d’Arthur de Gobineau. Les personnes professant cette idée ne sont pas forcément des racistes (enfin selon elles), mais il faut bien reconnaître que c’est quand même très utile pour énoncer un discours raciste sans tomber sous le coup de la loi….
Quels sont les liens que l’alterophobie entretient avec la modernité?
SF : L’altérophobie peut être vue comme un rejeton de la modernité, de sa volonté de tout uniformiser, de tout rationaliser : d’abord dans son propre pays, dans sa propre nation (pensons aux langues régionales en France par exemple), puis ensuite dans les Empires coloniaux (le fameux « nos ancêtres les Gaulois » enseigné aux enfants de l’Empire)… Il ne faut pas oublier que les discours racistes et les premières réflexions identitaires naissent aux XVIIe et XVIIIe siècles, dans le sillage des Lumières. Elle se constitue aussi, parallèlement, dans le sillage de penseurs, surtout allemands comme Herder, qui cherchent à donner une forme au nationalisme d’existence né dans la future Allemagne en rejet de l’occupation napoléonienne (qui ici joue le rôle de l’Autre rejeté). Quelque part, il s’agit de la face sombre des Lumières. Bref, l’Autre ne doit pas être Autre, mais être comme nous… Ce discours est visible tous les jours en ce moment, et ça en devient pénible : certains secouent péniblement le hochet de la République (sous sa Troisième version), mobilisant une conception particulière de la laïcité – loin du contenu de la loi de 1905, pour sommer les « musulmans » (je mets les guillemets car ce groupe essentialisé n’existe pas) à devenir plus Français que nos autres concitoyens…
NL : Le nationalisme en posant comme principe l'unité du « nous », l'autophilie, amène dans sa version droitisée à définir qui est exclu. Même si le code de l'indigénat lui est antérieur, il me semble que le moment de bascule est quand même surtout en 1870.
Les expressions de la haine identitaire semblent être liées originellement à la notion de pureté. Affaiblie par les tragédies de la seconde guerre mondiale, l’altérophobie version racialiste semble alors à bout de souffle. Comment va-t-elle parvenir à se réinventer? Quels sont les instigateurs de cette régénération?
SF : Je voudrai faire une remarque : on parle ici d’une « version raciste » et non pas « racialiste ». Je tiens à corriger. Le racisme, c’est le discours qui promeut une « race » supposée supérieure aux autres ; le racialisme, c’est le discours qui postule l’idée que la notion de « race » joue un rôle dans l’histoire des civilisations, sans pour autant mettre en avant une supériorité raciale (en gros, c’est une essentialisation : les Japonais ont donné naissance à tel type de civilisation, c’est dans leur essence –évidement sans prendre en compte les apports chinois ou alors pour montrer ce que le « génie » japonais a fait des matériaux culturels provenant de Chine–, sans pour autant affirmer la supériorité de la Civilisation japonaise sur celle des Chinois).
Cette précision étant faite, l’altérophobie se nourrit de thèses ethnologiques et de discours anticolonialistes. Elle transforme ces matériaux, en gardant certains éléments reconnaissables, pour les intégrer à sa propre ontologie, que nous pouvons résumer par « le mélange, c’est mal ». Quels sont les instigateurs de cette régénération ? Déjà des anthropologues comme Levi-Strauss (je sens la levée de boucliers) avec sa conférence « Race et culture » prononcée en 1971 à l’UNESCO, qui fait la promotion d’une forme de xénophobie, ou Robert Jaulin, avec son concept d’« ethnocide ». Les études postcoloniales ont également joué un rôle par leurs réflexions sur la race, l’ethnicité, le muticulturalisme : il faut regarder l’usage de ces théories dans les discours du Parti des Indigènes de la République…
NL : Pour ma part, je pense que « racialisme » s'il renvoie à cette conception de l'Histoire représente la théorie de l'inégalité des races. Le raciste rejette, le racialiste hiérarchise. Notre problème social a peut-être été de viser l'un en aidant l'autre. La loi dite antiraciste de 1972 sanctionnait des discours qui étaient marginalisés. Après elle, les extrêmes droites ont appris à parler de « l'identité » et du coût social de l'immigration plutôt que de la « race ». C'est un effet de modernisation exogène que je pointe depuis longtemps, et les récentes réflexions d'Anastasia Colosimo, ou le fait que Pierre Sautarel, le principal animateur du blog Fdesouche, ait l'intelligence dans l'ouvrage de Dominique Albertini et David Doucet sur la fachosphère, de bénir la loi Gayssot, en disant que sinon son camp serait encore à agiter des thèmes déphasés par rapport à l'opinion, me confirment que nous nous sommes collectivement trompés à un moment dans le combat anti-raciste.
On assiste depuis plusieurs années, dites-vous, à une mutation du discours altérophobe. Cette dernière, provoquée par la post-modernisation des sociétés européennes a accéléré la déconstruction du cadre commun au bénéfice d’un fourmillement de niches identitaires et d’individus atomisés. Un phénomène qui, en France, ne semble épargner aucune communauté et qui s’est accompagné d’une inflation du champ lexical de la haine identitaire; on pense notamment aux termes d’« islamophobie », de « judéophobie », de « négrophobie » ou encore de « racisme anti-blanc ». Qui sont donc les vecteurs de l’alterophobie en France ?
SF : Les trois premiers termes que vous citez montrent justement la fragmentation des revendications et des mémoires : chaque minorité estime être maltraitée par la majorité « blanche » française. Effectivement, il y a eu des rapports conflictuels, et un racisme manifeste, vis-à-vis de ces minorités, qui se sont repliées sur elles-mêmes. Ce repli à provoquer la recherche d’autres références culturelles et historiques, qui se manifeste par une concurrence mémorielle, somme toute pénible, du « j’ai été plus persécuté que toi ». On peut prendre l’exemple de la communauté noire qui estime que la traite négrière est un génocide de plus grande ampleur que le judéocide européen de la Seconde guerre mondiale. Certains membres parmi les plus radicaux de cette communauté vont même plus loin, postulant l’action des Juifs (notamment Français) dans le commerce triangulaire (thèse de Dieudonné reprise à des afrocentristes américains).
Concernant la dernière expression (« racisme anti-blanc »), elle est extrêmement piégée… Premier point, elle est instrumentalisée par l’extrême droite identitaire, notamment par Les Identitaires (anciennement Bloc Identitaire). Deuxième point, son idée a été formulée par une figure importante de cette extrême droite : Guillaume Faye, qui postulait au début des années 1980 qu’« Une société multiraciale est multiraciste ». Le meilleur moyen, selon lui, de l’éviter serait donc l’homogénéité ethnique… Au-delà de ça, la réflexion sur l’existence ou non du racisme anti-blanc doit être la suivante : existe-t-il des insultes du type : « Sale blanc » ? Si oui, il existe ; si non, il n’existe pas. Sachant qu’il existe un racisme antinoir chez les Arabes et les Maghrébins (voir le traitement des réfugiés subsahariens transitant par le Maroc et l’Algérie), je pense que oui. Cependant, pour l’instant, je n’ai guère vu d’études sur la question, à part celles instrumentalisées par l’extrême droite…
NL : Sur ce point soyons extrêmement rationnels, en différenciant idéologie et pratique. Dans les années 1960, quand le patron du MRAP disait qu'il était évident qu'il y avait racisme anti-Blancs comme anti-Noirs tout le monde en était d'accord. Il a fallu tout une rhétorique chargée d'écarter le réel par le biais d'arguties pour dire que « sale blanc » est moins raciste que « sale noir ». Maintenant, il y a eu une étude intéressante sur la pratique. 58% des sondés considèrent le racisme anti-Blancs comme « assez répandu », mais, dans une enquête effectuée auprès de 22 000 personnes, le taux des personnes concernées disant avoir été directement victimes de ce racisme s'élève à environ 15%. Il s'agit essentiellement d'injures. Or, le taux de personnes disant avoir été victimes de racisme est de plus de 50% chez les enquêtés originaires d'Afrique, et les actes se produisent dans le travail, ou l'accès aux administrations. Il y a donc une différence sociale qui n'est pas à confondre avec une différence de nature. La confusion intellectuelle de certains pans de la gauche post-colonialiste tient justement aux vecteurs de votre question : l'altérophobie se renouvelle dans les marges, en particulier des marges intellectuelles qui produisent contre-mémoires et contre-discours, puis s'épand. Ce second marché intellectuel est très friand de constructions théoriques tout à fait bancales.
Pourquoi dîtes-vous que l’alterophobie s’est normalisée et banalisée dans notre société? Notre arsenal législatif et juridique est-il trop limité pour la faire reculer? Quelle est la responsabilité des politiques dans cette inflation de la haine identitaire ?
SF : L’altérophobie s’est très largement répandue dans notre société : il suffit de se rappeler les polémiques de cet été, sans compter le dernier opus d’Houria Bouteldja ou la saillie de notre ancien président sur nos « ancêtres les Gaulois » (dans son cas, il s’agit d’une récidive, puisqu’il est à l’origine du très toxique débat sur l’identité nationale)… Je ne pense pas qu’on puisse faire reculer quoi que ce soit par un arsenal juridique ou législatif : si on empêche publiquement l’expression de certaines idées, on ne les éradique pas pour autant… On l’a bien vu avec les lois punissant le négationnisme : le discours persiste, mais son énonciation a changé. Les politiques ont joué un grand rôle dans la diffusion de la haine identitaire, de différentes façons, suivant les couleurs politiques de l’énonciateur : en encourageant le communautarisme ; en jouant sur la fragmentation mémorielle, en stigmatisant des populations. Pour des raisons électoralistes et démagogiques qui s’inscrivent à chaque fois dans des stratégies à courte vue. Plus guère d’entre eux cherche à créer du commun, à mobiliser des mythes fédérateurs (je ne parle pas du hochet « Troisième République » précité qui est plus uniformisateur que fédérateur).
Vous insistez également sur le fait que les discours des marges politiques tendent toujours à influencer le centre. Le processus de droitisation bien décrit par le politologue Gaël Brustier marque-t-il la victoire idéologique à retardement du discours de la Nouvelle Droite initiée dans les années 70 ?
NL : Je crois que justement Gaël Bustier signifie un point qui montre que cette affaire dépasse très amplement la question de la Nouvelle droite : le fait que l'occidentalisme soit une idéologie du déclin né du premier choc pétrolier, qui nous a fait découvrir que plus jamais la globalisation ne serait simplement l'occidentalisation du monde. Aujourd'hui l'Europe craint justement son orientalisation, c'est cette représentation qui est le moteur essentiel de notre droitisation, sachant que celle-ci est aussi un démantèlement de l'Etat social au bénéfice de l'Etat pénal, et un délitement des valeurs de l'humanisme égalitaire au bénéfice d'une ethnicisation des questions sociales. Ce mouvement conjoint à celui de la postmodernité et de la phase accélérée de la globalisation suractive les questions autophiles et altérophobes.
Pourquoi la gauche radicale, qui elle aussi a développé sa pensée dans les marges, n’est pas parvenue à imprégner durablement l’opinion ni à traduire son influence par les urnes ?
SF : Les valeurs prônées par les gauches radicales des années 1970 sont partout présentes : dans l’éducation, avec le « pédagogisme » tant décrié ; dans les mœurs, avec la promulgation du PACS puis du « mariage pour tous » ; avec l’omniprésence de l’écologie ; avec la victoire d’un féminisme modéré ; avec tant d’autres choses encore… Sa victoire a été plus culturelle que politique, c’est tout.
NL : Il me semble que lorsque la gauche radicale admet que la société industrielle est morte et qu'il faut donc s'inscrire dans un nouveau sens commun, produire une nouvelle offre culturelle et politique d'inclusion des secteurs paupérisés par la globalisation, elle se porte mieux que quand elle demeure dans les schèmes de l'époque industrielle. Après, il y a une césure entre les classes populaires et les cadres des gauches radicales sur les questions migratoire et identitaire, les premières estimant pour grande part qu'elles doivent être protégées de l'immigration en intégrant celle-ci aux problèmes de l'Etat pénal, quand les seconds pensent Etat social au nom de l'humanisme égalitaire. En clair : à gauche, les cadres ne savent pas répondre à la droitisation autrement que par la reddition ou le déni idéologiques.
Selon vous, l’ethocentrisme est une pathologie largement partagée qui crée un discours du « nous » contre « eux » qui n’est pas réductible à l’extrême droite mais vient se déployer chez un certain nombre de groupes exaltant les identités particulières. Vous rappelez à ce titre que la revendication identitaire est un système dialectique: « l’identification à un groupe se fait au contact de l’Autre qui nous renvoie à notre propre différence ». Pourquoi est-ce l’extrême droite qui récolte les fruits de ce différentialisme dans les urnes ?
SF : Aujourd’hui, nous sommes dans une logique de repli identitaire, liée à différents facteurs : mondialisation, crise économique, déclin de l’État-providence, etc., qui sont autant de thèmes porteurs pour les partis populistes occidentaux. Nous sommes dans une logique de ressentiment, plus que d’ouverture à l’Autre. L’accueil des « migrants », que je préfère appeler « réfugiés », le montre bien : personne ne veut de ces pauvres bougres. Les idées généreuses ne prennent plus sur la société. Au contraire, elles ne devraient fonctionner qu’en mode clos : l’un des slogans identitaires ne dit-il pas : « Aider les nôtres, avant les autres » ? L’altérophobie ne nous quitte pas.
NL : Selon moi, les extrêmes droites mutent selon l'ordre géopolitique : le national-populisme vient de 1870, le fascisme de 1918, le néo-fascisme de 1942, le néo-populisme de 2001. En quinze ans nous avons superposé les crises : 11 septembre, crise des subprimes, crise migratoire. On a une situation tout à fait favorable à la rencontre sur les marchés politiques de l'offre autoritaire d'enclosure et de la demande autoritaire de protection
