Les États-Unis s’apprêtent à élire leur prochain(e) président(e). Deux fois par mois, cet horizon sera l’occasion d’explorer, avec Pascal Mbongo, un pays dont les contrastes et les mutations ne lassent pas d'en agacer certains et d'en fasciner d'autres – parfois les mêmes.
Cette cinquième livraison de la série est consacrée à la « juridification » de la politique américaine, dont témoigne la présence significative de juristes dans la décision publique. Si l'on admet que ce trait caractéristique de la politique américaine a quelque chose de logique à plusieurs égards, ce qui est plus difficile à saisir c’est l’impact que cela peut avoir sur les politiques publiques.
La juridification, soit l’emprise universelle du droit, est l’une des caractéristiques les plus immédiatement observables de la société américaine. Du Los Angeles Times au Washington Post, en passant par le New York Times, le New Yorker, la New York Review of Books ou le Hollywood Reporter, sans parler des revues intellectuelles ou des médias locaux, les pages et les analyses juridiques sont comme une évidence. La juridification n’est pas moins reflétée par la culture populaire, depuis les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles jusqu’aux comédies musicales tirées de l’histoire constitutionnelle. Et elle se donne également à voir à travers les institutions politiques et administratives. Ainsi, le Congrès actuel est pour une importante part une sociabilité de juristes, avec 160 diplômés en droit parmi les 435 membres de la Chambre des représentants et 53 diplômés en droit parmi les 100 sénateurs. Et au Congrès, comme d’ailleurs dans les législatures d’État, il faut tenir compte des nombreux Legislative Attorney(s), ces fonctionnaires parlementaires qui sont authentiquement juristes. Comme beaucoup de gouverneurs, nombre de présidents des États-Unis sont donc aussi passés par une Law School.
Présidents juristes et juristes conseillers
« Je n’ai jamais pensé que c’était une bonne idée pour des avocats d’être président. Je pense que les avocats sont si occupés – vous savez, ils sont toujours portés à ratiociner sur toute chose, à soupeser toute chose. Ils sont toujours à défendre l’indéfendable et à chicaner… Je crois qu’il est peut-être temps … pour un homme d’affaires [de devenir président] ». Cette sentence avait été le fait du cinéaste Clint Eastwood (qui est Républicain) lors d’une intervention remarquée à la Convention républicaine de Tampa Bay le 31 août 2012.
Cet anti-juridisme et cette vision stéréotypique des avocats est paradoxalement ordinaire au « pays des avocats ». Et Hollywood semble avoir contribué à fixer ces représentations dans des conditions analysées de manière très intéressante par Michael R. Asimow dans une étude sur les cabinets d’avocats dans les œuvres cinématographiques hollywoodiennes. La déclaration de Clint Eastwood de 2012 fut d’autant plus cocasse que le discours qui suivait était celui d’un... avocat, Marco Rubio, alors sénateur républicain de Floride et que Mitt Romney, le candidat républicain à la présidence, a lui-même été formé au droit à Harvard sans être, à proprement parler, juriste. Et, si le président des États-Unis Barack Obama est Lawyer (juriste), il est moins certain qu’il ait été Attorney (avocat), comme le sous-entendait Clint Eastwood. La première catégorie est beaucoup plus large que la seconde : nombreux et de toutes sortes sont les lawyers qui ne sont pas attorneys. Bien que la qualité d’Attorney lui soit prêtée ici ou là, Barack Obama lui-même ne revendique pas avoir été formellement inscrit à un Barreau. Il revendique plutôt une qualité de juriste-conseil en droits civiques à Chicago. En toute hypothèse, il est le 25e président des états-Unis ayant eu la qualité de Lawyer. Cette longue liste de présidents juristes compte ainsi : ‒ John Adams ; ‒ Thomas Jefferson ; ‒ James Madison ; ‒ John Quincy Adams ; ‒ Andrew Jackson ; ‒ Martin Van Buren ; ‒ John Tyler ; ‒ James Polk ; ‒ Millard Fillmore ; ‒ Franklin Pierce ; ‒ James Buchanan ; ‒ Abraham Lincoln ; ‒ Rutherford Hayes ; ‒ Chester Arthur ; ‒ Grover Cleveland ; ‒ Benjamin Harrison ; ‒ William McKinley ; ‒ William Howard Taft ; ‒ Woodrow Wilson ; ‒ Calvin Coolidge ; ‒ Franklin Roosevelt ; ‒ Richard Nixon ; ‒ Gerald Ford ; ‒ Bill Clinton ; ‒ Barack Obama.
À ces présidents juristes, il faut ajouter les chefs de « départements ministériels » ‒ au-delà même de l’US Attorney General et chef du département de la justice (DOJ) dont on peut se demander comment, s’il n’était pas hautement qualifié en droit, il pourrait suivre le travail civil et pénal des procureurs fédéraux ou des polices fédérales relevant du DOJ. Il faut également compter avec ceux des collaborateurs et des conseillers les plus immédiats du président qui sont juristes. Si l’on s’en tient aux seuls White House Chief(s) of Staff (« chef de cabinet de la Maison-Blanche »), que certains aiment à présenter comme étant les « véritables vice-présidents », ils sont pour près de la moitié d’entre eux diplômés des Law Schools, depuis la création de la fonction en 1946.
C’est peut-être une évidence que de dire que cette emprise des juristes est en consonance avec la surface sociale des études de droit aux États-Unis, qui elle-même résonne de ce que l’Amérique est une nation contractuelle, comme aucune autre : il n’est pas anodin que les questionnements identitaires de l’Amérique soient articulés autour du langage constitutionnel lorsque ces mêmes questionnements sont articulés en Europe autour du concept de « vivre ensemble ».
Le président, grand pourvoyeur du Journal officiel (Federal Register)
Trois considérations peuvent encore éclairer l’hyper-présence de juristes de formation à la Maison-Blanche.
La première considération ressort de la fameuse proposition de Tocqueville : « il n’est pas de question politique, aux États-Unis, qui ne se résolve tôt ou tard en question judiciaire ». Aussi la Maison-Blanche est-elle un haut lieu de production et de circulation de notes juridiques. L’importance accordée aux débats constitutionnels entre conseillers du président dans The West Wing est à cet égard trompeuse dans la mesure où les termes constitutionnels des grandes guerres culturelles américaines (avortement, peine de mort, armes à feu…) sont plutôt balisés et que le quotidien de la Maison-Blanche est souvent fait de questions juridiques moins « fantastiques ».
En deuxième lieu, la diversité des actes juridiques (executive order, proclamation, directive, memorandum, presidential signing statement, veto) émanant de la Maison-Blanche et destinés au Congrès, aux administrations fédérales ou aux citoyens ne suppose pas seulement l’existence de juristes pour les commettre mais aussi une capacité plus ou moins significative de l’équipe présidentielle et du président lui-même à les valider : parce que ces écritures à travers lesquelles s’exerce le pouvoir politique du président (concurremment à celles produites par les « départements » et les « agences ») ont néanmoins chacune des statuts juridiques spécifiques. Si l’on s’en tient aux actes présidentiels les plus solennels et les plus « normateurs » (executive orders), Bill Clinton en a commis 308 en huit ans, George W. Bush 292 pendant la même durée. Cela fait en moyenne trois executive orders par mois. Comme Barack Obama en est à 238 au 15 avril 2016, il est vraisemblable que sa moyenne sera un peu inférieure à celle de Bill Clinton et de George W. Bush. L’on voit en tout cas ici que selon que l’on s’intéresse ou non aux executive orders, l’on ne raconte pas de la même manière l’histoire d’un président, du moins depuis la naissance de l’État administratif au début du XXe siècle.
Enfin, l’extrême codification juridique de la transition présidentielle qui a lieu entre le mois de novembre et l’entrée en fonctions en janvier du président élu a aussi, quoique ponctuellement, son importance : ce sont, au bas mot, une trentaine de textes plus ou moins complexes à l’application desquels il faut veiller pendant cette période. Aussi, chacun des deux candidats à l’élection présidentielle dispose-t-il d’un « directeur de la transition », qui est lui-même souvent juriste. Pour cause, ces deux mois de transition sont parmi les plus formalistes de la vie politique américaine : il faut faire « checker » par le FBI, notamment pour des raisons de sécurité nationale, les chefs de départements (les ministres) pressentis par la nouvelle présidence ; considération faite de la législation fédérale sur les conflits d’intérêts, il faut passer à la loupe leurs intérêts, revenus et patrimoines (ainsi que ceux de leurs conjoints) ; il faut être avisé des différents textes législatifs et réglementaires relatifs au déclenchement de l’état d’exception (catastrophes naturelles, terrorisme, etc.) pendant la transition présidentielle et à la continuité de l’État dans un tel contexte…
Si l’on admet que la présence significative de juristes dans la décision publique en Amérique a quelque chose de logique à plusieurs égards, ce qui est plus difficile à saisir c’est l’impact que ce profil particulier d’élites politiques et administratives peut avoir sur les politiques publiques, aussi bien en amont à travers la « mise sur agenda » de certaines questions politiques, qu’en aval à travers la fabrication et la mise en œuvre de ces politiques. Cette connaissance est d’autant plus difficile que la présence des juristes est concurrente de la présence prospère d’un autre profil, celui des diplômés en Public Affairs dont certains sont par ailleurs … diplômés en droit.
L’état de guerre juridique à la Maison-Blanche : l’Impeachment
C’est le 9 août 1974 que Richard Nixon démissionna de ses fonctions de président des États-Unis dans le cadre de l’affaire du Watergate. La démission de Richard Nixon fut précipitée par l’arrêt United States v. Richard Nixon par lequel la Cour suprême des États-Unis, le 24 juillet 1974, a décidé à l’unanimité l’obligation pour le président de communiquer aux enquêteurs les enregistrements secrets de ses conversations dans le Bureau ovale, des enregistrements dont Nixon soutenait qu’ils étaient protégés par le « privilège de l’exécutif ». L’arrêt de la Cour suprême rendait vraisemblable une mise en accusation de Richard Nixon et sa destitution dans le cadre de la procédure d’Impeachment .
Les maîtres mots de l’affaire du Watergate pour les Américains sont la Constitution et le droit. Et plutôt accessoirement le « journalisme d’investigation » incarné par Woodward et Bernstein. De bout en bout, le Watergate fut aussi une bataille juridique et judiciaire incarnée par une ribambelle de juristes : le procureur spécial Leon Jaworski qui fut le véritable tombeur de Richard Nixon ; les différents conseillers juridiques de la commission spéciale du Sénat ; les membres juristes de cette commission, dont le futur acteur Fred Dalton Thompson. Compte tenu de ce que l’Impeachment articule de la très haute politique à de la très haute juridicité, les conflits sont presqu’inévitables entre les juristes du président, spécialement entre ses avocats et ses propres conseillers. Ce ne fut pas moins le cas en 1999 avec le président Clinton qu’au moment du Watergate. À cette différence près que sous Nixon, les choses furent encore plus complexes parce que l’intéressé a cru devoir ajouter à son jeu de cartes les dirigeants du Département de la justice, au prix de l’affaire Robert Bork.
En 1973, c’est en effet Robert Bork qui a limogé Archibald Cox, le procureur spécial chargé d’enquêter sur l’affaire du Watergate. Il avait ainsi accepté de faire le « sale boulot » initialement demandé par le président Richard Nixon à l’U.S. Attorney General (ministre de la justice) Elliot Richardson, ordre présidentiel que ce dernier avait refusé d’exécuter, préférant démissionner de ses fonctions. Richard Nixon s’était alors tourné vers le Deputy Attorney General (vice-ministre de la justice) William Ruckelshaus qui lui aussi refusa et démissionna de ses fonctions. Robert Bork, qui était alors Solicitor general, s’était ainsi retrouvé ministre de la justice par intérim et avait exécuté la demande de Richard Nixon. Robert Bork raconte cet épisode rocambolesque dans son autobiographie sous le titre Le massacre du samedi soir (The Saturday Night Massacre, chapitre 5). Le fameux « massacre » semble avoir été décidé avec l’accord du plus célèbre et plus important des avocats de Richard Nixon dans l’affaire du Watergate : Charles Alan Wright, professeur de droit constitutionnel, avocat, auteur d’un traité qui continue de faire autorité (Federal Practice and Procedure). Or ses désaccords de stratégie juridique avec les conseillers de Nixon furent tels que Charles Alan Wright décida de « claquer la porte » de la défense du président. Les conseillers de Richard Nixon parvinrent néanmoins à le convaincre de revenir sur sa décision, parce que, prétendent Woodward et Bernstein, « il était un universitaire et [que] les plaidoiries devant la Cour suprême sont des exercices universitaires »…
À lire aussi sur nonfiction.fr :
Tous les articles des Chroniques américaines
Sélection bibliographique :
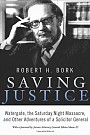 Saving Justice: Watergate, the Saturday Night Massacre, and Other Adventures of a Solicitor General
Saving Justice: Watergate, the Saturday Night Massacre, and Other Adventures of a Solicitor General
Robert Bork
Encounter Books, 2013.
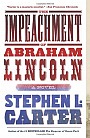 The Impeachment of Abraham Lincoln
The Impeachment of Abraham Lincoln
Stephen L. Carter
Alfred A. Knopf, 2012 [roman].
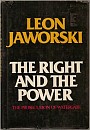 The right and the power: The prosecution of Watergate
The right and the power: The prosecution of Watergate
Leon Jaworski
Reader's Digest Press, 1976.
 The Nerve Center: Lessons in Governing from the White House Chiefs of Staff
The Nerve Center: Lessons in Governing from the White House Chiefs of Staff
Terry Sullivan (ed.)
Texas A&M University Press, 2004
 The final Days
The final Days
Bob Woodward & Carl Bernstein
Simon & Schuster, 2015
